Schopenhauer – la
métaphysique de l’amour
La
métaphysique de l’amour de Schopenhauer est un très beau et, fait peu courant,
très drôle morceau de la philosophie. Sur ce point je vous renvoie en passant
aux Consolations de la philosophie d’A. De Botton qui tisse quelques
sympathiques variations sur le thème. Ici on procédera à une analyse critique
de cette théorie de l’amour. Selon cette dernière, en effet, l’amour est une
illusion de l’espèce. Si, au-delà de son sens strictement freudien comme
inconscient psychique, on appelle « inconscient » l’ensemble des
forces non conscientes qui déterminent la conscience à son insu (à ce titre Alain Renaut
dans son Cours de philosophie paru en 2005 distingue trois formes
d’inconscients : un inconscient biologique, un inconscient psychique et un
inconscient social), on peut appeler inconscient biologique, l’ensemble des forces innées,
inscrites génétiquement en nous et inconnues de la conscience, qui déterminent
le champ et la tension propre de notre conscience vers son objet.
Prenons
donc au sérieux l’idée d’un inconscient biologique et analysons sa force
et le degré de sa validité dans le champ de ce qui constitue une expérience
majeure de la conscience, celle de l’amour. Dire que notre conscience de l’amour
est le produit d’un inconscient biologique (la déterminant à son insu) signifie
que la conscience que nous avons de l’amour serait intrinsèquement illusoire.
Que servirait-elle alors ? L’espèce, à notre insu. L’amour ne serait
ainsi que la manière illusoire dont apparaît à la conscience la tension
reproductrice de l’espèce, cette dernière tenant alors lieu de cet inconscient
essentiellement biologique qui déterminerait notre conscience. Telle
est la « métaphysique de l’amour » de Schopenhauer :
« L’égoïsme en chaque homme a des
racines si profondes, que les motifs égoïstes sont les seuls sur lesquels on
puisse compter avec assurance pour exciter l’activité d’un être individuel.
L’espèce, il est vrai, a sur l’individu un droit antérieur, plus immédiat et
plus considérable que l’individualité éphémère. Pourtant, quand il faut que
l’individu agisse et se sacrifie pour le maintien et le développement de
l’espèce, son intelligence, toute dirigée vers les aspirations individuelles, a
peine à comprendre la nécessité de ce
sacrifice et à s’y soumettre aussitôt. Pour atteindre ce but il faut donc que
la nature abuse l’individu par quelque illusion, en vertu de laquelle il voit
son propre bonheur dans ce qui n’est, en réalité, que le bien de l’espèce ;
l’individu devient ainsi l’esclave inconscient de la nature, au moment où il
croit n’obéir qu’à ses seuls désirs. Une pure chimère aussitôt évanouie flotte
devant ses yeux et la fait agir. Cette illusion n’est autre que l’instinct. (…)
L’enthousiasme vertigineux qui s’empare de l’homme à la vue d’une femme dont la
beauté répond à son idéal, et fait luire à ses yeux le mirage du bonheur
suprême s’il s’unit avec elle, n’est autre chose que le sens de l’espèce qui
reconnaît son empreinte claire et brillante et qui par elle aimerait se
perpétuer » (Schopenhauer, Le monde comme volonté et
représentation)
Analyse
détaillée
1)
« L’égoïsme en chaque homme a des racines si profondes… ».
Qu’est-ce donc que l’égoïsme ? C’est le fait de n’agir qu’en vue de ses
propres intérêts sans donner au point de vue de l’autre une valeur propre dans
ma prise de décision (altruisme) (ego = moi / alter = autre). Quelles sont donc
ces racines « si profondes» de l’égoïsme ? Elles sont biologiques
c'est-à-dire ancrées dans la vie – ce que Schopenhauer dit de l’homme peut
ainsi se généraliser à tout être vivant. Qu’est-ce qui caractérise, en effet,
de ce point de vue, un être vivant ? Un être vivant – de la bactérie à
l’homme – n’existe jamais que pour lui-même, percevant le monde à
partir de soi, visant des fins (nutrition, reproduction) dont il est
pour lui-même le centre. Aussi, écrit Schopenhauer, « chaque
individu, en dépit de sa petitesse, bien que perdu, anéanti au milieu d’un
monde sans bornes, ne se prend pas moins pour centre du tout, faisant plus de
cas de son existence et de son bien-être que de ceux de tout le reste »
(Le monde comme volonté et représentation). C’est vrai de mon chat - et
ici de Garfield – mais c’est déjà vrai
d’une
amibe, par exemple.
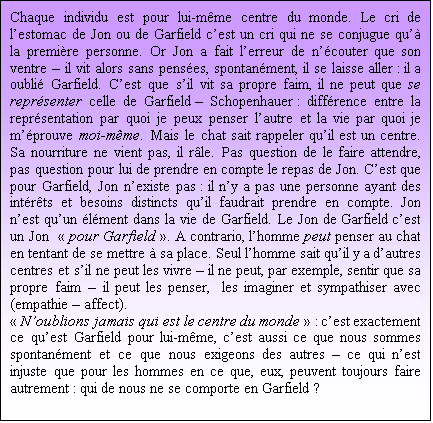


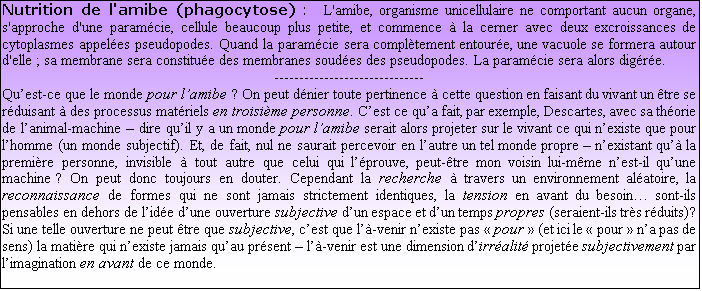

Dit
autrement, selon la catégorisation de Cornélius Castoriadis (Le monde
morcelé), tout être vivant est un sujet – non ici entendu comme cet
être libre cause de soi – mais comme un
être doté de la dimension subjective du « pour soi » :
contrairement à la simple matière qui n’est jamais qu’unidimensionnelle,
sans profondeur, ni dimension intérieure, tout être vivant serait : a)
autocentré – se vivant comme le centre de son monde ; b) autofinalisé
– mue par une tension interne qui fait un avec lui - tout
être vivant se fait et se vise; différence avec l’être matériel qui ne
connaît de causes qu’extérieures ; c) doté d’un monde propre – le
monde de la plante, de la mouche, du chien… Avec le vivant apparaîtrait ainsi
un « mode d’être étranger aux soleils, aux planètes, aux
atomes » (Hans Jonas, cf. tableau résumant sa
philosophie de la vie), celui d’un être toujours en tension, se visant
et se faisant lui-même dans la lutte précaire pour exister.
On
comprend dès lors la raison de la profondeur des racines de l’égoïsme
humain : c’est « dans l’égocentrisme de l’unicellulaire ou déjà l’individu contingent,
périphérique, éphémère, se pose, le bref instant de son existence, au centre de
son univers »
(E. Morin, La vie de la vie) que ce dernier s’enracine. Je ne peux,
de fait, faire autrement que de me vivre au centre de mon monde – même si je
peux penser au-delà ; tout réveil le matin, toute pensée, toute
perception… partent de ce point premier, de ce site autocentrée que j’occupe
toujours ; une douleur aux dents en tant que je l’éprouve et que je suis
le seul à l’éprouver est plus terrible pour moi que n’importe quel
génocide ; de l’autre côté, la douleur de l’autre n’est jamais pour moi
qu’une représentation (image ou idée) à laquelle je puis bien compatir mais que
je ne peux réellement vivre : la baffe que reçoit le voisin est toujours
moins douloureuse et humiliante pour moi ; pour agir il faut enfin
que j’y sois intéressé, c'est-à-dire que les fins que je me
propose me touchent d’une certaine façon – sans une telle condition, pas
d’action possible : on n’agit pas pour rien, sans aucun motif – il
faut que j’éprouve un intérêt pour telle action.


2)
Si, cependant, l’individu vivant est pour lui-même son propre centre,
s’il n’agit que s’il y ressent un intérêt propre, on se demande alors
comment l’espèce peut bien vivre et se reproduire. Une telle
reproduction ne nécessite t’elle pas le sacrifice de l’individu –
comme, à l’extrême limite, ces mâles immolés après l’accouplement par la mante
religieuse ? Pour que l’espèce survive ne faudrait-il pas que l’individu
soit altruiste – c'est-à-dire agisse pour les autres en faisant
abstraction de soi ? Or, du fait de la structure subjective
autocentrée du sujet vivant, c’est ce qui ne se peut. Comment donc l’espèce se
reproduit-elle ? En se servant de l’individu à son insu, nous dit
Schopenhauer : « pour atteindre ce but il faut donc que la nature
abuse l’individu par quelque illusion, en vertu de laquelle il voit son propre
bonheur dans ce qui n’est, en réalité, que le bien de l’espèce ;
l’individu devient ainsi l’esclave inconscient de la nature, au moment où il
croit n’obéir qu’à ses seuls désirs ». Tel est l’instinct et ici le désir
sexuel – l’éros. Eros, ce désir qui, pour le moins qu’on puisse dire,
inonde la conscience, serait le moyen par lequel à mon insu – et à l’insu de
tous les animaux – l’espèce se reproduit. Qu’est-ce qui permet à Schopenhauer
de poser une telle priorité de l’espèce sur l’individu ?
3)
Tout d’abord, un jugement de la raison sur la position relative de
l’individu à l’égard de la nature puis à l’égard de l’espèce. « L’individu est un
quantum d’existence, éphémère, discontinu, ponctuel, un
« être-jeté-dans-le-monde » entre ex nihilo (naissance) et in nihilo
(mort), et c’est en même temps un sujet qui s’auto-transcende au-dessus du
monde. Pour lui, il est centre de l’univers. Pour l’univers ce n’est qu’une
trace corpusculaire, un froissement d’onde. Pour lui il est sujet, pour l’univers
il est objet » (E. Morin, La vie de la vie, p.194). Celui qui
se prend pour un centre n’est, matériellement parlant qu’un vent de mouche dans
le grand univers. De même, celui qui vit le temps et l’espace comme restreint
autour de sa personne, n’est aussi, en tant que membre de l’espèce, que
le nième produit de telle espèce donnée (la 3041003ème fourmi de la
grande fourmilière) ; elle-même étant encore, du point de vue de la vie –
alors même que l’on peut, peut-être, cf. + loin (4), parler d’un sujet collectif
que serait l’espèce – un produit temporairement fixé de l’évolution des vivants
(alors même que telle espèce tend à se reproduire en tant qu’espèce – et à
s’opposer à telle autre espèce, produit de la même évolution). Face à de telles
considérations, notre raison doit redresser l’ordre des choses et
remettre les perspectives tendant à se poser comme autant d’absolus (le sujet
individuel, l’espèce elle-même puis l’évolution du vivant dans la grande
matière) à leur place – et ce, c’est l’immense difficulté, sans réduire
cependant une réalité sur une autre, sans abolir ce qui a une dimension réelle
(par exemple le vécu de l’individu). Aussi, préfigurant un tel programme,
Pascal écrit-il dans ses pensées : « chacun est un tout à
soi-même, car, lui mort, le tout est mort pour soi. Et de là vient que chacun
croit être tout à tous. Il ne faut pas juger de la nature selon nous, mais
selon elle ». Juger de la nature selon elle – c’est tenter par notre
raison, de resituer les perspectives particulières dans les ordres naturels
dont elles dépendent et qui les co-déterminent. Ainsi, du point de vue
de l’espèce, pouvons-nous dire que la mort individuelle n’est rien – alors
qu’elle est tout pour nous - celle-ci n’étant que le moyen par lequel l’espèce
se continue (et ainsi, peut-être, de la mort de l’espèce du point de vue
de l’évolution).
4)
Si donc l’espèce peut être considérée par Schopenhauer comme ontologiquement
(du point de vue de l’être) première par rapport à tel ou tel individu, c’est
qu’aucun individu vivant ne s’est créé lui-même – l’individu en tout son être
est traversé par le genos (« race » en grec) c'est-à-dire par
les lois de l’espèce qui vit à travers lui. Produit de membres de
l’espèce, il reproduit dans son individualité – sa forme, ses facultés,
ses pulsions - la structure de l’espèce. Celle-ci inscrite en lui sous la forme
des gènes est une mémoire – celle de l’évolution – que fait revivre à
chaque instant en lui l’existant singulier pour se former et se re-former. Tous
les actes de l’individu vivant ont ainsi pour condition la formidable
complexité organisationnelle des structures de l’espèce. Aussi, notre regard
délaissant les individualités vivantes pour saisir le flux de leur reproduction
par milliers, millions, milliards, pouvons-nous saisir à travers ce flux même,
une réalité, celle de l’espèce, qui se perpétue. De ce point de vue,
l’individu apparaît comme une simple manifestation, un simple exemplaire de
l’espèce, réalité véritable sous-tendant l’apparence phénoménale de la diversité
individuelle. C’est dans cet ordre d’idée (schopenhauerien) que le biologiste
Dawkin a pu récemment écrire que « l’individu est l’instrument par
lequel les gènes se reproduisent » (Le gène égoïste). Un
inconscient biologique gouvernerait à notre insu la conscience que nous avons
de nous-mêmes.
5)
Mais si n’existent jamais que des individus (je ne vois que des chevaux, êtres
subjectifs, irréductibles en ce que ne pouvant occuper le même site ontologique
– cf. l’impartageabilité d’une douleur -, jamais le cheval), comment la
« pulsion » générique de l’espèce se manifeste t’elle au sein de la
subjectivité vivante ? Schopenhauer fait de « l’instinct »
– et ici de l’éros - le point
de jonction à l’intérieur de l’individu entre le subjectif (éprouvé, ressenti
à la première personne) et la réalité générale et générique de l’espèce. C’est
que l’éros est, en effet, une tension subjectivement éprouvée et de très
forte intensité. Mais, en même temps, c’est une tension folle, une ivresse
d’une puissance telle qu’elle emporte l’être qui l’éprouve et semble le
dominer. Cette puissance semble s’imposer avec la quasi-nécessité d’une loi de
la nature. « Deux bêtes, deux chiens, deux loups, deux renards, rôdent par
les bois et se rencontrent. L’un est mâle, l’autre femelle. Ils s’accouplent.
Ils s’accouplent par un instinct bestial qui les force à continuer la race,
leur race, celles dont ils ont la forme, le poil, la taille, les mouvements et
les habitudes. Toutes les bêtes en font autant sans savoir pourquoi ! Nous
aussi… » (Maupassant, un cas de divorce). Il faut donner à
cette puissance sa juste place dans la nature : « ce n’est pas
seulement dans les armes des hommes à l’égard des belles créatures qu’Eros fait
sentir sa puissance. Il a beaucoup d’autres objets et règne aussi sur les corps
de tous les animaux, sur les plantes, en un mot sur tous les êtres »
(Platon, Le banquet, discours d’Eryximaque) allant jusqu’à donner chez
Maupassant l’image d’une nature emportée dans un rut universel. A
travers un tel rut, hommes et bêtes mêlés accompliraient à leur insu la loi
de la nature. Et,
en effet, à bien regarder les êtres de notre espèce, une multitude de gestes et
de mots semblent pris dans la tension d’éros : approche de
séduction, propos grivois, fantasmes à tout va… « Ils ne pensent qu’à
ça ». Une tension plus forte que nous – « c’était plus fort
que moi » - semble nous conduire inéluctablement de l’attirance à la
jouissance. Ce pourquoi beaucoup s’y laissent prendre – avant, sens calmés et
l’œuvre de la nature à leur insu réalisée, de retrouver leurs esprits et de
« réaliser ».
Ainsi chez Maupassant de la
jeune fille d’Une partie de campagne, séduite et emportée, qui juste
après l’extase fond en sanglots ; ainsi encore de l’amant de la mante chez
qui l’amour aveugle se paye par après de quelque désillusion.
L’absence d’une telle chaîne
d’obsessions chez l’enfant (cf. dessin de Quino) (il en a d’autres, cf. Freud),
sa (relative) disparition chez le vieillard et son explosion dès la puberté,
marquent la nature biologique de cette force d’éros qui envahit notre
conscience.

6) Ainsi par la force d’éros
serions-nous les pantins d’une pièce qui se jouent derrière nous. La beauté
d’une femme, l’idéal amoureux – de Roméo à Arlequin, les poèmes chantant
l’amour … « pures chimères » envoûtant la conscience et puis
qui disparaissent avec la jouissance. L’ennui des vieux amants, les scènes de
ménage et la vaisselle cassée… marqueraient ainsi pour le vieux Schopenhauer,
la fin de l’illusion, parmi une ribambelle d’enfants pleurnichards près,
dès l’adolescence, à reprendre le fleuron…
7) Mise en relation des concepts sous-jacents
de : sujet – liberté – désir – conscience – inconscient – nature.
Alors que la conscience semblait faire de nous des sujets maîtres de leur vie
c'est-à-dire libre vis-à-vis de la nature, Schopenhauer pense ici cette
conscience comme essentiellement illusoire. Elle serait en réalité mue par un
désir reflétant la tension inconsciente propre de l’espèce.
L’arrachement de l’homme à la nature qui définit la
liberté ne serait dès lors que l’illusion par laquelle la nature réalise sa
visée, l’homme n’ayant conscience que de ses désirs mais non des causes qui le
poussent à désirer (Spinoza) – tel serait ainsi l’inconscient biologique,
puissance de l’espèce se manifestant à travers l’illusion d’un désir propre à
soi.
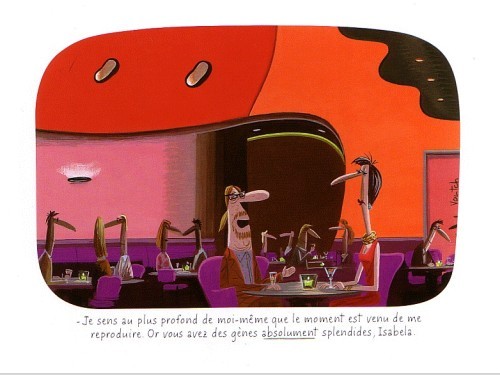
Conclusion
et critique
.
Il est indéniable qu’éros est une force corporelle sexuelle ;
commune aux vivants dont la reproduction nécessite le rapprochement de deux
individus ; qui s’ancre ainsi dans la tension de la reproduction de
l’espèce ; que tout être vivant porte en lui du fait de son
origine dans le genos commun engendrant une nature corporelle
d’exemplaire particulier d’une espèce donnée. C’est indéniable – mais l’amour
humain s’y réduit-il ? Autrement dit : sans nier l’ancrage de l’amour
dans notre nature biologique – n’y a-t-il pas spécifiquement dans l’amour
humain des dimensions qui échappent à une telle
réduction ?
.
C’est notamment le thème d’une profonde nouvelle de Maupassant, L’inutile beauté. En voici la trame : une
belle femme de trente années ayant passé toute sa jeunesse a tenir le rôle biologique
de génitrice imposé par les pulsions sexuelles et jalouses de son mari, se révolte
contre une telle condition. Elle échappe aux étreintes sexuelles de ce dernier
en lui faisant croire que, parmi ses enfants et sans lui dire lequel, un n’est
pas de lui : incapable de vivre dans le doute, le mari quitte alors le
foyer. On retrouve alors cette femme, magnifique de splendeur, libérée du poids
de la grossesse, c'est-à-dire de son corps naturellement animal non pour porter
un corps mortifié et qu’il faudrait nier (cf. la religieuse et l’idéal
ascétique : se libérer du corps biologique par la négation de tout ce qui
rappelle et appelle le désir) mais un corps transfiguré, élevé, magnifié,
d’un érotisme sublime, une beauté inutile et mystérieuse… Un corps qui se
révèle ainsi au regard soudain ouvert de son ancien mari :
« Il
la regardait bien en face, si belle, avec ses yeux gris comme des ciels froids.
Dans sa sombre coiffure, dans cette nuit opaque des cheveux noirs luisait le
diadème poudré de diamants, pareil à une voie lactée. Alors, il sentit soudain,
il sentit par une sorte d'intuition que cet être-là n'était plus seulement
une femme destinée à perpétuer sa race, mais le produit bizarre et mystérieux
de tous nos désirs compliqués, amassés en nous par les siècles, détournés de
leur but primitif et divin, errant vers une beauté mystique, entrevue et
insaisissable. Elles sont ainsi quelques-unes qui fleurissent uniquement
pour nos rêves, parées de tout ce que la civilisation a mis de poésie, de luxe
idéal, de coquetterie et de charme esthétique autour de la femme, cette statue
de chair qui avive, autant que les fièvres sensuelles, d'immatériels
appétits »
Là
où, fait dire Maupassant à l’un de ses personnages, la nature (ici appelée
ironiquement « divine providence ») fait de nous de simples
reproducteurs stupides, nous avons à nous construire dans une dimension que
ne connaît pas la nature, celle de la poésie, de l’idéal, du sens :
« Tout
l’idéal vient de nous, et aussi toute la coquetterie de la vie, la toilette des
femmes et le talent des hommes qui ont fini par un peu parer à nos yeux, par
rendre moins nue, moins monotone et moins dure l'existence de simples
reproducteurs pour laquelle la divine Providence nous avait uniquement animés.
Regarde ce théâtre. N'y a-t-il pas là-dedans un monde humain créé par nous,
imprévu par les Destins éternels, ignoré d'Eux, compréhensible seulement par
nos esprits, une distraction coquette, sensuelle, intelligente, inventée
uniquement pour et par la petite bête mécontente et agitée que nous
sommes ? »
Maupassant
renverse ainsi la thèse de Schopenhauer. Là où l’art - la poésie,
les toilettes, les fards, l’érotisme, les jeux subtils de la séduction… -
n’était qu’un artifice, une apparence ayant la fonction illusoire
de masquer l’essentiel à savoir ce qui se joue dans la nature,
soit la reproduction de l’espèce, Maupassant insiste sur la dimension
nouvelle instaurée par l’homme, celle de la culture, véritable pied
de nez jeté à cette nature stupide et aveugle (que nous sommes certes aussi)
qui ne nous promet qu’un cycle répétitif de besoins et nulle autre issue que la
mort. Profondément inutile, la beauté n’a pas d’utilité masquée –
ce n’est pas le moyen apparemment inutile mais en réalité fort utile par lequel
l’espèce attire entre eux les sexes – comme il le semble encore dans
l’éthologie animale (ou comme on la lit et la construit…) – elle est le
contraire de toute fonction, le gratuit, le « pour rien »
par quoi se révèle le désir humain de hauteur, le refus de la pesanteur
(nature) et, mue par un tel désir, la capacité créatrice de
l’imagination qui sur le corps animal sculpte un corps sublime, sur son cri le
chant, sur ses gestes saccadés la danse… - sur la nature, la culture.
.
Et, en effet, Schopenhauer opère un ensemble de réductions qui le rendent incapable
de penser la spécificité humaine. Réduisant la culture à la nature,
la signification des discours à l’absence de sens d’une pulsion générique, la
poésie au prosaïque, la conscience à l’inconscient, l’individu à l’espèce, le
corps humain au corps animal… il suppose - certes pour de suite les dénier -
des réalités (l’individu, la conscience, la poésie, le sens, la culture…) que
son discours pourtant ne peut pas expliquer. Car qu’éros se thématise chez
l’homme en discours et en sens, qu’il faille « mettre les formes »
et donner un sens à ce qui chez l’animal est vécu sur le mode immédiat d’une
pulsion muette et aveugle, voilà précisément ce qu’il faut expliquer. Le chien
y met un peu moins de fioritures – c’est le moins qu’on puisse dire. Autrement
dit, c’est précisément cette distance – serait-elle apparente -
vis-à-vis de l’immédiateté de la pulsion muette dont il faut comprendre la
possibilité. A la réduire sans l’expliquer, depuis la hauteur (celle de la
vie) où se situe ici Schopenhauer, c’est le jeu de la mise en scène dans
ses multiples variantes créatrices – jeu individuel des hommes pouvant
inventer de nouvelles manières de dire et de faire l’amour – jeu social des
cultures – créant de nouvelles manière de cultiver éros… qui sont proprement
incompris.
.
Le fait supplémentaire et hautement significatif que l’individu, dont on fait
pourtant un agent de l’espèce, puisse chez l’homme détourner la finalité
reproductive de la sexualité au profit du plaisir (invention même de l’érotisme
comme art du plaisir, utilisation de la contraception…) ne marque t’elle pas
qu’avec l’homme éros change profondément de sens ?
.
Or ce n’est pas en expulsant éros de l’humain (en faisant de ce dernier un être
éthéré) mais en creusant sa spécificité humaine que l’on est saisi de son étrangeté
à la simple animalité. Chez l’homme, en effet – et pour quelles
raisons ? – tout semble indiquer une défonctionnalisation du désir
érotique. Alors que, dans l’immense majorité des cas, la sexualité animale est
réglée sur les rythmes de l’espèce (pas de sexualité hors des cycles de
reproduction), l’homme a pour spécificité d’avoir une sexualité débridée -
débridée (libérée) des chaînes de la fonction biologique. Ainsi que le dit un
des personnages de Beaumarchais à qui une dame quelque peu guindée reprochait
la bestialité (c'est-à-dire l’animalité – l’ancrage dans la nature) :
« faire l’amour à tout va et boire sans soif, tel est justement le
propre de l’homme ».
.
Autre caractère d’éros chez l’homme, c’est la totalité du corps qui
devient potentiellement zone érogène – c'est-à-dire source de plaisir (de là
l’art de la caresse). A comparer à la limitation (et à la fixité) de
l’érogénéité du corps animal. Si l’on sait, de plus, qu’une telle érogénéité du
corps n’est pas séparable de la signification de la caresse (qui ?,
comment ? quand ? où ? de quelle manière ?) c'est-à-dire
d’un halo imaginaire de sens dont elle dépend entièrement (cf. une
réponse variable à la question « avec qui ? » peut faire
passer la caresse du magique à l’horreur – notez qu’alors même que
matériellement parlant la caresse est la même, identité des stimuli, c’est le
sens imaginaire donné à cette épreuve corporelle qui la transforme en
expérience sublime ou répugnante), il faut dire que le corps érogène de l’homme
est un corps doté d’une dimension inconnue de l’animal, un corps imaginant
et signifiant.
. Résumons donc la critique que
l’on peut établir de la thèse d’un inconscient biologique déterminant à son
insu notre conscience en faisant du sujet une illusion et un jouet de
l’espèce : c’est la différence spécifique de l’homme et de l’animal qui ne
peut être ainsi réduite. Aucune réduction ne permettra de passer de ce qui est
une nécessité aveugle et muette à l’inventivité des gestes et des discours
poétiques, à la compréhension de l’érogénéité potentiellement totale d’un corps
imaginant et signifiant, aux jeux de l’amour humain. Eros, trace générique
en nous de notre nature animale, dépôt ancré dans le corps individuel de
l’évolution de l’espèce, devient dans et avec l’homme autre chose –
autre chose qui suppose tout au moins, l’apparition d’un mode d’être inconnu
de l’animalité, à savoir l’instance imaginaire psychique créatrice de
significations. Cette dernière est donc non déductible depuis une nature qui
ne saurait la contenir : si un simple « je t’aime »
n’existe pas pour mon chien cela ne signifie pas, sauf à nous réduire à un
chien, que ça n’a pas de sens – mais, tout au contraire, qu’une autre
dimension est ouverte, celle du sens – serait-il mensonger -
inexistante pour l’animal, dimension qu’il s’agit de penser dans sa
spécificité.