Le
Bonheur
I) Le
bonheur est-il le souverain bien ?
Texte
d’Aristote
« S'il
est exact qu'il y ait quelque fin de nos actes que nous voulons pour elle-même,
tandis que les autres fins ne sont recherchées que pour cette première fin
même, s'il est vrai aussi que nous ne nous déterminons pas à agir en toutes
circonstances en remontant d'une fin particulière à une autre - car on se
perdrait dans l'infini et nos tendances se videraient de leur contenu et
deviendrait sans effet -, il est évident que cette fin dernière peut être le
bien et même le bien suprême. [...] Puisque toute connaissance et toute
décision librement prise vise quelque bien, quel est le but que nous assignons
à la politique et quel est le souverain bien de notre activité ? Sur son nom du
moins il y a assentiment presque général : c'est le bonheur, selon la masse et
selon l'élite, qui suppose que bien vivre et réussir sont synonymes de vie
heureuse [...] Ce qui se suffit à soi-même, c'est ce qui par soi seul rend la
vie souhaitable et complète. Voilà bien le caractère que nous attribuons au
bonheur [...] puisqu'il est la fin de notre activité. » (Aristote,
Ethique à Nicomaque, Livre I)
. Que nous dit
Aristote ?
a) Toutes nos
activités supposent la liberté d’un choix en fonction de raisons
portant sur ce que nous jugeons être préférable
. Considérez vos
activités quotidiennes : le réveil sonne vous vous levez, vous vous faites
un café et beurrez trois biscottes, vous vous lavez, vous habillez, vérifiez
que la dissertation sur laquelle vous avez travaillé toute la nuit est bien
dans votre sac ; vous rêvassez un peu et songez à quelque événement
marquant d’hier ; d’un seul coup, vous regardez l’heure et remarquez que
vous êtes en retard, vous sautez dans vos baskets, sortez dehors et vous
mettez à courir dans la rue après le bus qui déjà s’enfuit au loin ; vous
vous décidez alors à faire le chemin à pied ; arrivé au lycée, vous
rencontrez Manuella ; vous tapez la discut’ : « t’as fait la
dissert ? etc. ». D’un coup, la sonnerie : vous montez les quatre
étages, arrivez en cours et c’est parti pour la journée ; vous écoutez
scrupuleusement, recopiez les phrases au tableau, interrogez sur des notions
obscures… etc.… puis vient le soir, vous arrivez enfin chez vous, vous vous
allongez et mettez votre disque préféré ; vous songez : « encore
deux jours et c’est le week-end ! ». Et vous pensez surtout à
samedi soir, « samedi, c’est la fête… » ; enfin –
j’abrège - vous descendez pour manger, regardez un peu la télé et puis vous
endormez. Et c’est reparti pour un tour…
. Pourquoi avez
vous donc fait tout cela – effectué chacun de ces gestes, développé
chacune de ces pensées ? Parce que vous n’aviez pas le choix ? C’est
faux : vous pouviez tout à fait sécher les cours, prendre votre sac sur le
dos et vous envoler en stop en direction de je ne sais où. Vos actions en tant
qu’actions humaines n’ont ainsi rien d’aveugle ni d’instinctif. Elles
sont toujours le fruit d’un choix, certes sous des contraintes que vous
ne choisissez pas, celles du réel, et motivées par des raisons pour
lesquelles vous jugez préférable de faire ceci ou cela. « Juger
préférable » c’est agir en fonction de ce que nous considérons comme
le meilleur parmi les biens et les maux ouverts à notre action. Ainsi si
vous avez décidé d’aller à l’école plutôt que de rester au lit c’est que,
peut-être, vous avez jugé préférable premièrement de ne pas subir le
bâton des parents et de l’administration, deuxièmement d’avoir votre bac, la
condition en étant dans l’assiduité et le travail quotidien, au plaisir
immédiat de se reposer. Nos actions sont ainsi toujours le produit d’un choix
selon des raisons propres.
b) La plupart
de nos activités visent des biens relatifs, soit des biens qui n’ont pas de
valeur en soi, mais en ce qu’ils permettent l’obtention d’autres biens
. Or ce qui
motive ultimement ce choix, dit Aristote, c’est le bonheur.
Certes se lever, se laver, manger mes tartines, courir après mon bus, écrire
toute la journée… ne me rend pas heureux. Et pourtant si je les choisis et les
juge préférables à de toutes autres actions c’est que j’en escompte un bien ou
tout au moins un moindre mal. Aristote pourrait dire ainsi qu’ « être
debout », « être propre », « avoir l’estomac calé »,
« attraper le bus », « réussir mon contrôle »…
sont des biens relatifs c’est à dire des biens qui sont fait
relativement à autre chose, qui ne sont donc pas fait pour eux-mêmes :
on ne se lève pas pour se lever mais pour faire autre chose – par
exemple aller au lycée ; on ne va pas au lycée pour aller au lycée – mais
pour faire autre chose – par exemple travailler ; on ne travaille
pas, pour travailler – mais pour autre chose, par exemple faire plaisir aux
parents ou bien réussir, etc. ; on ne réussit pas pour réussir – mais
parce qu’on en escompte un bien, par exemple le fait d’être admiré et d’être
riche, etc. Où s’arrête t’on ? Il se pourrait que l’on ne s’arrête jamais
– telle est l’hypothèse d’une vie absurde.
c) Une vie
absurde serait une vie qui ne se dirigerait que de biens relatifs en biens
relatifs sans jamais viser ni atteindre un bien absolu
. « S'il
est vrai aussi que nous ne nous déterminons pas à agir en toutes circonstances
en remontant d'une fin particulière à une autre - car on se perdrait dans
l'infini et nos tendances se videraient de leur contenu et deviendrait sans
effet », dit ainsi Aristote. Or est-ce vrai ? Ne se peut-il
pas, en effet, que nous soyons pris dans un cycle sans fins d’actions
dont aucune n’a de valeur en soi de telle manière qu’à chaque fois que nous
arrivons à nos fins c’est toujours dans le but de faire autre chose et ainsi à
l’infini ? Nous prenons le métro pour aller au boulot, nous allons au
boulot pour gagner de l’argent, nous gagnons de l’argent pour acheter de quoi
vivre, nous achetons de quoi vivre pour vivre. Et pour quoi vivons-nous ?
Pour prendre le métro et aller au boulot, etc. « Métro-boulot-dodo ».
Parfois nous nous rendons compte de l’absurdité d’une telle vie, d’une telle
course en avant qui n’a plus d’autre sens que de courir pour rien. C’est alors
la crise, la dépression du désespoir : notre vie perd son sens,
nous n’avons plus le goût à rien de tout cela – l’élan de vie qui accompagnait
toutes nos activités s’est éteint.
. Or, selon
certains philosophes que par ironie j’appelle « joyeux drilles »
(parmi lesquels Pascal et Schopenhauer), cette révélation d’une absence de sens
de la vie (ou en termes aristotéliciens de la seule existence de biens
relatifs), somme toute assez rare au cours de l’existence, ferait apparaître la
vérité de notre condition : nous serions des êtres absurdes courant
toujours après des biens futurs sans jamais pouvoir atteindre quelque bien
substantiel (ayant une valeur en soi, voulu pour lui-même et non pour autre
chose). Ainsi écrit Pascal :
« Nous ne nous tenons jamais au temps
présent. Nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour hâter son
cours; ou nous rappelons le passé, pour l'arrêter comme trop prompt : si
imprudents, que nous errons dans les temps qui ne sont pas les nôtres, et ne
pensons point au seul qui nous appartient ; et si vains, que nous songeons à
ceux qui ne sont rien, et échappons sans réflexion le seul qui subsiste. C'est
que le présent, d'ordinaire, nous blesse. Nous le cachons à notre vue, parce
qu'il nous afflige ; et, s'il nous est agréable, nous regrettons de le voir
échapper. Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et pensons à disposer les
choses qui ne sont pas en notre puissance, pour un temps où nous n'avons aucune
assurance d'arriver.
Que chacun
examine ses pensées, il les trouvera toutes occupées au passé ou à l'avenir.
Nous ne pensons presque point au présent ; et, si nous y pensons, ce n'est que
pour en prendre la lumière pour disposer de l'avenir. Le présent n'est jamais
notre fin : le passé et le présent sont nos moyens; le seul avenir est notre
fin. Ainsi nous ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre; et, nous
disposant toujours à être heureux, il est inévitable que nous ne le soyons
jamais. » (Pascal,
Pensées).
. Si, en effet,
nous visons toujours à l’avenir, cherchant toujours un bien en vue d’un autre
bien futur et ainsi à l’infini, nous ne vivons jamais dans le présent de la
jouissance d’un bien durable et substantiel mais, peut-être dans la seule
espérance, illusoire, de ce dernier. Avant de terminer une pelletée de terre
sur la tête, dirait Pascal en gai luron. Quel bonheur !
d) Une vie
sensée suppose au contraire la visée et la réalisation d’un bien substantiel et
absolu (qui se suffit à lui-même)
. De cette
analyse suit ainsi l’exigence d’un bien absolu – bien sans lequel la vie
n’est qu’une course absurde. Si, en effet, tout bien relatif nous renvoie vers
un autre bien lui aussi relatif, et si la vie n’est pas ou ne doit pas être
une course absurde de moyens en moyens sans atteindre aucune véritable fin
alors il faut bien que tous ces biens convergent vers un bien qui ne soit, lui,
plus relatif à autre chose que lui-même mais un bien désiré pour lui-même,
un bien en soi, un bien absolu. Aristote appelle un tel bien le souverain
bien. Le souverain bien c’est le bien au-dessus de tous les biens
particuliers et relatifs, en vue duquel nous cherchons ultimement ces derniers.
. Or, disais-je
un peu plus haut, un tel bien c’est, pour Aristote, le bonheur. Pourquoi
donc ? « On peut dire, en effet, de toutes les choses du monde,
qu'on ne les désire jamais que pour une autre chose, excepté toutefois le
bonheur ; car c'est lui qui est le but » (Aristote). Si, en effet,
nous étions heureux qu’aurions-nous donc encore à désirer ? A la question
« pourquoi voulons-nous être heureux », nous répondons :
« pour être heureux » et il nous semble que cela suffit et se
justifie de soi-même. Autrement dit : le bonheur semble ce bien absolu
et souverain en vue duquel toutes nos activités prennent sens et poids.
Celui qui travaille, qui court après cette femme, qui va s’acheter sa jolie
voiture… ne le fait-il pas parce qu’il suppose que ces activités sont, d’une
manière ou d’une autre, préférables relativement au bonheur qu’elles
sont censées construire ? Elles ne donnent pas le bonheur mais seraient des
moyens (des biens relatifs) pour y accéder.
e) Le bonheur
comme souverain bien rentre en concurrence possible (et peut-être apparente)
avec le bien moral, la vérité et la liberté
. Mais le
bonheur est-il véritablement le souverain bien ? Est-il la seule
fin dernière et absolue en vue de laquelle nous pouvons agir et
penser ? Trois concurrents semblent cependant s’opposer à une telle
position : le bien moral, la liberté et la vérité.
. La morale
tout d’abord. Une vieille dame tombe sur la route déserte devant moi alors même
que je suis très pressé, m’en allant à un rendez-vous amoureux que je ne puis
raté sans perdre mon amour. Si le bonheur est le souverain bien et si ce
dernier, comme il me semble, réside dans cet amour alors je dois lui sacrifier
la vieille dame. Je la laisse par terre et je m’en vais sans même appeler les
pompiers. Que m’importe sa détresse ? Et pourtant, une voix au fond de moi
– la conscience morale - ne me dit-elle pas qu’on ne peut pas négocier avec ses
devoirs ? Que je dois sacrifier mon bonheur égoïste au bien moral,
c’est à dire au bien de l’autre ? Or si tel est le cas le bien moral
n’est-il pas pour moi le souverain bien ? Pour le savoir il suffit de
décliner la question en un choix fondamental : accepterai-je d’être un « salaud » heureux
? Si non c’est que le Bien au sens moral du terme est pour moi le souverain
bien, non le bonheur puisque je lui sacrifie ce dernier, jugeant le Bien moral
préférable.
. En ai-je pour
autant fini avec le bonheur comme souverain bien ? Peut-être pas
car : 1) la morale est peut-être un souverain bien illusoire – c’est
la thèse de Spinoza ou Nietzsche; 2) la conscience d’être un salaud – la
culpabilité - peut gâcher mon bonheur – auquel cas bonheur et morale
pourraient bien se rejoindre; 3) faire et voir le bien autour de soi peut,
peut-être, être un ingrédient essentiel du bonheur – me donnant peut-être ces
deux types de joies : joies de
voir le bonheur autour de soi ; joie d’avoir le sentiment d’être la cause d’une bonne action, soit d’une
diminution du malheur des autres ; 4) Enfin la morale n’est peut-être pas
l’ennemie du bonheur, puisqu’elle vise finalement le bonheur de tous, au
détriment de ce qui n’est peut-être qu’une conception égoïste et peut-être
aveugle du bonheur. Tout cela demande analyse et exige de répondre à la
question de la juste relation à l’autre impliquée par un bonheur vrai.
. La vérité
et la liberté ensuite. Accepterai-je de faire le choix de Cypher dans Matrix
I : qu’on endorme ma conscience et me plonge dans l’illusion, le rêve
éternel, d’une vie heureuse abolissant ainsi tant ma conscience du vrai
que mon exigence d’être le maître de moi-même ? Quel choix ferai-je ? Celui de Néo, celui de la pillule
bleue qui m’ouvre les portes d’une vérité affreuse et d’une liberté douloureuse
ou bien la pillule rouge qui me renferme tel un esclave dans une illusion
bienheureuse ? S’il s’avérait que je choisisse la vérité contre un bonheur
tissé d’illusions alors le bonheur ne serait plus le souverain bien. La vérité
serait le bien suprême. Un tel choix n’est pas abstrait : c’est celui que
nous faisons lorsque nous ne voulons pas entendre des vérités qui
dérangent (que nous sommes mortels, que nous sommes égoïstes, que nous
sommes malades, que nous sommes nuls, etc. ); c’est, selon Nietzsche et Freud, celui
que fait le croyant religieux lorsqu’il
préfère le cocon formé par les songes d’une croyance qui donne un sens au monde
et expulse la mort (cf. cours / La vérité
- raison, croyance et expérience) au dur contact d’un monde qui n’est pas fait
pour nous ; c’est encore celui que fait celui qui boit ou se drogue pour
ne pas voir et oublier. Alors : bonheur ou vérité comme souverain
bien ?
. Mais là encore
il se peut que l’alternative soit un peu trop rigide. Car : 1) Un bonheur
illusoire n’est-il pas fragile ? Celui qui tisse autour de lui un monde
d’illusions ne doit-il pas s’attendre à le voir craquer ? Et, par exemple, à
suivre Freud et Nietzsche, la croyance religieuse peut-elle se relever d’une
interrogation sur ses fondements propres (cf. discussion en classe :
« Dieu existe t’il ») ? De fait, l’alternative des deux
pillules n’est simplement pas possible : nous ne pouvons pas, sauf une
folie que nul ne contrôle, nous enfermer dans le rêve. Ainsi, écrit Descartes,
« je n'approuve point qu'on tâche à se tromper, en se
repaissant de fausses imaginations ; car tout le plaisir qui en revient, ne
peut toucher que la superficie de l'âme, laquelle sent cependant une amertume
intérieure, en s'apercevant qu'ils sont faux. » (Lettre
à Elisabeth). 2)
De plus il n’est pas certain que les équations bonheur = conscience
illusoire et conscience du réel = malheur soient vraies. Certes l’analyse
du réel m’apprend peut-être l’inéluctabilité de la mort et l’absence de sens du
réel tout entier (conviction athée) mais encore faudrait-il prouver qu’une
telle conscience est nécessairement cause de malheur pour l’homme. Un bonheur
lucide n’est-il pas possible ?
. Conclusion
sur ce point : si vivre pour la liberté, la vérité, le bien moral et
le bonheur apparaissent à première vue comme des choix sensés, chacun de ces
biens pouvant prétendre à la position de souverain bien, soit de biens absolus
préférables à tous et donnant un sens à la vie, on ne peut pourtant les dire en
concurrence sans analyser la nature profonde et vraie du bonheur. Peut-on être
heureux et méchant ? Peut-on être esclave et heureux ? Peut-on être
aveugle (au monde et à soi) et heureux ? Il se peut, en effet, comme nous
l’avons suggéré qu’une conception qui oppose le bonheur tant à la vérité, qu’à
la liberté et à la morale soit une conception simplement apparente et peut-être
illusoire du bonheur. Peut-être, en effet, le véritable bonheur implique t’il
tant la moralité, la vérité que la liberté.
Pour savoir ce
qu’il en est, il nous faut donc maintenant plonger dans l’analyse du
caractère propre du bonheur.
II. Qu’est-ce
qu’être heureux ?
Qu’est-ce tout
d’abord que le sentiment de malheur (la peine) ? Pour dégager son
sens, demandons-nous ce qu’ont en commun une mère qui perd son fils, un
individu qui échoue à un examen, l’annonce d’une maladie ? C’est le sentiment
douloureux d’une étrangeté radicale de l’état du monde à nos plus profonds
désirs. Que désirons-nous, en effet ? Qu’il vive, réussir, être en
bonne santé. Et que nous dévoile le monde ? Le contraire. Nous ne sommes
pas chez nous dans ce monde et c’est pourtant le nôtre : malheur.
Lorsqu’un tel
sentiment porte sur l’avenir, que nous voyons celui-ci comme radicalement
étranger à nos désirs, que nous sentons que nous ne pourrons jamais nous
y réaliser, c’est le désespoir. L’espoir, au contraire, est une
confiance en l’avenir, un consentement au temps.
Si le sentiment
de malheur est ponctuel (localisé dans le temps), qu’est-ce donc qu’une vie
malheureuse ? C’est, bien sûr, une vie dans laquelle le sentiment de
malheur est prépondérant, une vie qui, dans le meilleur des cas peut-être, n’a
jamais pu se réaliser, c’est à dire trouver dans le monde l’objet de ses
désirs, et, dans le pire des cas, qui y a trouvé l’exact contraire (conditions
de vie insupportables). Ainsi nous semble (à tort ou à raison) la vie
d’un malade incurable, d’un esclave et, plus généralement, des « damnés
de la terre » (nom que l’on donne à tous les rejetés, miséreux,
exploités qui survivent sur la Terre – c’est, dans l’histoire, la plus grande
partie de l’humanité).
Qu’est-ce donc a
contrario que le sentiment de bonheur ? Son autre nom est la joie.
C’est le sentiment joyeux d’une adéquation de l’état du monde à nos plus
profonds désirs. Je regarde le monde et je me regarde – et je me dis que
tout est pour le mieux.
Une vie heureuse
c’est donc une vie qui se considère comme réalisée, qui a su trouvé ou
construire dans le monde l’objet de ses désirs.
Maintenant
connaissons-nous une telle vie ? Force est de constater, que, le plus souvent,
nous ne sommes ni vraiment malheureux, ni vraiment heureux – nous avons des
moments de malheur compensés par des moments de bonheur sans que, pour la
plupart, nous puissions dire si notre vie est globalement heureuse ou
malheureuse. Nous sommes dans une sorte d’entre-deux.
Hors les
quelques moments de malheur et de bonheur profonds – moments sur lesquels il
faudra revenir - qu’est-ce que cet entre-deux ? C’est l’état d’un
être insatisfait du présent qui, cependant, espère le bonheur
c’est à dire voit dans le présent les signes d’un bonheur futur. C’est
l’état très courant que décrivait Pascal plus haut (cf. I.c) : nous ne
nous tenons jamais au temps présent, nous faisons tout en vue d’un avenir que
nous espérons heureux. Dans un tel cadre, le temps présent est une parenthèse
qui me sépare du bonheur – que n’aimerions-nous pas hâter son cours ! Si
nous supportons le présent c’est ainsi, le plus souvent, parce que nous espérons
cet avenir et goûtons déjà par imagination le bonheur au futur. Tel
l’enfant qui rêve devant son magazine de jouets. Tel le marin, séparé de sa
belle, qui sait que, dans un mois, il retourne au port, etc.
Rappelons ici
nos acquis antérieurs (I) : avec Aristote, nous avons distingué bien
relatif (ayant une valeur relative, désiré en vue d’autre chose que
lui-même) et bien absolu (ayant une valeur absolue, désiré pour
lui-même). En suivant Pascal, nous avons, de plus, montré que ce qui faisait
l’insatisfaction propre d’une vie passée à quérir des biens relatifs c’est que
chacun de ces biens ne se suffit pas et renvoie à l’imagination d’une
jouissance future qui n’arrivera peut-être jamais. Aussi, courant toujours vers
ailleurs, ne connaissons-nous jamais de bonheur au présent. Deux caractères se
dégagent donc de l’exigence de bonheur : celui-ci doit être fondé sur un bien
(une chose, un acte, une rencontre) qui a les caractères de l’absolu,
offrant ainsi une jouissance pure ayant un sens en elle-même sans renvoi à un
ailleurs ; il doit, de plus, être l’objet d’une possession présente.
Sinon, en effet, comme dit à peu près Pascal, nous ne vivrons jamais, nous
espérons de vivre, nous ne serons jamais heureux, nous espérons de l’être.
Quel type de
bien peut ainsi être appelé bien absolu offrant une jouissance
au présent ? C’est, au minimum, un bien qui ne déçoit pas dont
l’obtention est suivie d’une effective et durable joie.
Or – voilà le
problème - ce qui fait le fond de la vie de la plupart des hommes, c’est
cependant la déception. Combien de fois n’avons-nous pas été déçu de
l’obtention de l’objet après lequel pourtant nous aspirions de toutes nos
forces ? « Si j’avais su… », répètent-ils en cœur. Pour
nous rendre compte de cela, il faut opérer sur la vie des hommes, ces tests-ci
:
- Test 1 :
« Si tu devais recommencer ta vie, prendrais-tu les mêmes chemins,
ferais-tu les mêmes choix ? ». S’il s’avérait, comme il est plus
probable, que la réponse soit négative, ce test révélerait que ma vie présente
est globalement une erreur, une déviation du juste chemin, bref un échec. A
contrario, le critère d’une vie heureuse et réussie n’est-il pas celui
d’un être qui, à tout prendre et pour l’essentiel, adhérerait à sa vie
passée et choisirait de suivre les mêmes sentiers.
- Test
2 : « Aimerais-tu retourner en arrière, retrouver le temps de ta
jeunesse ? ». Là encore, on le conçoit, si la réponse est
positive c’est que le temps qui sépare celui qui y répond de sa jeunesse est un
temps globalement négatif, une perte plus ou moins pure et non un
accroissement, un progrès, un enrichissement. A contrario, on conçoit que celui
qui répondrait par la négative concevrait le temps d’une toute autre façon
comme le temps positif et consenti d’un enrichissement.
- Test 3 : « Si je te donnais la vie
éternelle, sous la condition que tu reste éternellement le même, connaissant le
même type de vie – mais désormais sans ailleurs et sans progrès, accepterais-tu
le change ? ». Si je réponds non à une telle question, c’est que ma
vie telle que je la vis n’est pas une vie heureuse. Si la répétition sans
progrès à l’infini de ma vie fait apparaître le cercle infernal de l’ennui,
cela révèle que je suis manifestement insatisfait de ma vie présente – que
celle-ci est essentiellement attente, appel vers, transition vers une vie
future que j’espère être meilleure. A contrario, selon Nietzsche, la
marque d’une vie réussie serait qu’elle consentirait éternellement à
la répétition d’elle-même en sa totalité (test 1) et de l’instant
présent. « Cette vie, telle que tu la vis et l'a vécu,
il te faudra la vivre encore une fois et encore d'innombrables fois ; et elle
ne comportera rien de nouveau [...] L'éternel sablier de l'existence est sans
cesse renversé, et toi avec lui, poussière des poussières. [...] Ne te
jetterais-tu pas par terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui
parla ainsi ? Ou bien as-tu vécu une fois un instant formidable où tu lui
répondrais : « Tu es un dieu et jamais je n'entendis rien de plus divin ! »
(Nietzsche, Le Gai Savoir, 1882, §341).

Or s’il s’avère que, comme la plupart des hommes, peut-être,
j’échoue aux trois tests précédents, alors c’est que, choisissant mes chemins
et jugeant celui-ci ou celui-là préférable à d’autres, je me suis
peut-être finalement trompé. Or si je choisis des biens relatifs en fonction de
ce que je considère comme un bien absolu assimilable pour moi au bonheur, et si
cependant j’échoue à trouver en lui un quelconque bonheur, c’est peut-être que l’objet qui prétendait
au rang de bien absolu n’en était pas véritablement un. Quels sont donc les
prétendants au bonheur ?
Ce sont les
trois biens désirés par tous et toujours : la richesse, l’amour et
la gloire.
III) Les
chemins du bonheur : l’amour, la richesse, la gloire
Les tests
précédents nous indiquent assez sûrement que nous ne sommes pas heureux. Si
nous ne sombrons pas dans le désespoir, c’est que nos désirs nous poussent vers
des biens que nous considérons comme des candidats au bonheur. Tels sont
l’amour, la gloire, la richesse. Analysons donc ces trois biens et voyons si
la promesse de bonheur qu’ils contiennent est un leurre ou bien une
vérité.
A lire les
écrits religieux, nombre de grands romans et textes philosophiques, il semble
bien qu’une très lourde critique tombe sur les objets de désir de la plupart
des hommes. Le bonheur promis à l’horizon de l’amour, de la gloire et de la
richesse serait une illusion. Le « happy end » des mauvais
contes (« ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants », les
princes et princesses, etc.), films (Pretty woman, etc.) et romans
(Arlequins, etc.) – mariage heureux, réussite sociale, richesse – masquerait ce
qu’il y a après la fin du film, soit le temps sans bonheur de la
désillusion.
Qu’en est-il
d’une telle critique ? Marque t’elle la position de dépressifs
chroniques, incapables de vivre dans le monde et de goûter ses joies ?
On comprendrait alors pourquoi ils se vengent en propageant leur venin sur ce à
quoi ils n’ont pas accès – le pauvre déteste le riche et vomit la richesse
qu’il désire secrètement ; le laid l’amour ; le raté la gloire, etc.
Ou bien l’amour, la gloire et la richesse sont-ils en eux-mêmes incapables
d’apporter le bonheur que pourtant ils promettent ?
Dans toute
analyse de ce type, il faudra éviter le piège consistant à faire passer nos
croyances pour des raisons. C’est que – cf. cours sur la raison et la
croyance – nous avons tendance à poser pour vrai ce qui nous fait plaisir.
Aussi, si je veux être dans le vrai – autrement dit si devant le choix de
Cypher (Matrix) je choisis la vérité à un bonheur tissé d’illusions – je dois
toujours me poser cette question : qu’est-ce qui fait que je tends vers
cette conception ? Qu’est-ce qui fait, par exemple, que je tends à
mépriser l’amour ou bien à déclarer comme nulles les raisons qui portent à
mépriser l’amour, etc. ? Rien n’est plus difficile sur de tels sujets,
auxquels tout notre être est structurellement attaché, que de conquérir une
attitude objective, condition de la liberté de notre esprit et d’un accès à la
vérité.
Pour répondre,
il faut partir d’un fait - fait qu’il faut voir et analyser : la rareté
du bonheur. Au trois tests précédents, c’est l’échec qui, le plus
souvent - mais peut-être pas toujours et il faudra aussi analyser comment et
pourquoi – se manifeste dans l’histoire des hommes. Pourquoi donc ?
Quelles sont donc les natures respectives de l’amour, de la gloire et de la
richesse pour peut-être engendrer de telles déceptions ?
A) L’amour
1) Tous
recherchent et espèrent l’amour, le prince ou la princesse charmant(e) qui
viendra, espère t’on, donner un sens profond et intense à la vie. De
fait, on ne parle que de ça (dans les cours de récré, au téléphone, à la télé,
au cinéma, dans les magazines, etc.) – ou presque. Quel est donc ce sens
(signification, direction, valeur) tant désiré ?
2) « Tomber
amoureux » c’est véritablement entrer dans une autre dimension de
l’existence. Avant tout était plat, prosaïque, banal et insipide. L’amour
qui vient nous frapper, d’un seul coup, fait apparaître dérisoires tous nos
buts antérieurs. Nous n’avons plus goût à rien de ce monde, « nous
sommes ailleurs » : nous sommes amoureux. De là des comportements
inédits, irréductibles à la logique calculatrice et rationnelle de la
quotidienneté : le financier dilapide ses biens ; l’égoïste est près à
tout sacrifier (cf. Rogojine dans L’idiot de Dostoïevski). L’amour, dit
Platon, est bien une sorte de délire et d’ivresse qui nous fait
perdre cette raison qui nous ancrait dans le monde commun. Par l’amour nous
faisons ici-bas l’expérience d’une toute autre existence et d’un tout autre
monde que le monde ordinaire dont nous croyions pourtant qu’il était le
seul monde. Et il nous semble alors que le vrai monde et le seul qui vaille
n’est pas le monde ordinaire et plat de l’existence quotidienne, mais ce monde
solaire ouvert par l’amour.

3) Or ce vécu si
intense de l’amour, cette expérience d’un autre monde et d’une autre existence,
est indissociable de croyances fortes : si nous ne mangeons plus,
si nous aspirons tout entier à la (le) voir c’est que nous croyons savoir
qu’elle (il) est celle (celui) dont l’amour réciproque, les caresses, les
baisers vont donner un sens plein à ma vie, me « combler »
de telle façon que j’aurai tout, ne manquant plus de rien, n’ayant plus
rien à désirer. C’est, de fait, ce que dit le langage populaire qui
cherche « l’âme sœur » - soit l’union de deux âmes faites
l’une pour l’autre - « sa moitié » - soit l’autre partie de
soi qui fera des amants une totalité close et satisfaite, un cocon, un nid de
bonheur - « le prince charmant »,
« l’homme (ou la femme) de mes rêves » - la perfection qui me manque et au contact de
laquelle je pourrais enfin (vraiment) vivre.
4) Et pourtant
tout semble indiquer que l’amour ne dure pas. C’est là un fait
statistique recouvrant l’immense majorité des cas : tous ? Peut-être
pas. Mais enfin regardez vos parents et les gens qui vous entourent ! Où
est passé cet amour qui, jadis, les a sûrement embrasé ? Il faut parier
que s’ils restent ensemble c’est pour de toutes autres raisons que la passion
amoureuse : l’habitude, l’intérêt, le leur et celui des enfants, la peur
de la solitude et, dans le meilleur des cas, la tendresse et l’amitié. Combien
alors ne rêvent-ils pas d’un nouvel amour et de nouveaux amants ? C’est ce
constat que fait ici Rousseau :
« Les
amants ne voient jamais qu’eux, ne s’occupent incessamment que d’eux, et la
seule chose qu’ils sachent faire est de s’aimer. Ce n’est pas assez pour des
époux, qui ont tant d’autres soins à remplir. Il n’y a point de passion qui
nous fasse une si forte illusion que l’amour : on prend sa violence pour
un signe de sa durée ; le cœur surchargé d’un sentiment si doux l’étend
pour ainsi dire sur l’avenir, et tant que cet amour dure on croit qu’il ne
finira point. Mais, au contraire, c’est son ardeur qui se consume ; il
s’use avec la jeunesse, il s’efface avec la beauté, il s’éteint sous les glaces
de l’âge ; et depuis que le monde existe on n’a jamais vu deux amants en
cheveux blancs soupirer l’un pour l’autre. On doit donc compter qu’on cessera
de s’adorer tôt ou tard ; alors, l’idole qu’on servait détruite, on se
voit réciproquement tels qu’on est. On cherche avec étonnement l’objet qu’on
aima ; ne le trouvant plus, on se dépite contre celui qui reste, et
souvent l’imagination le défigure autant qu’elle l’avait paré. Il y a peu de
gens, dit La Rochefoucauld, qui ne soient honteux de s’être aimés quand ils ne
s’aiment plus. Combien alors est à craindre que l’ennui ne succède à des
sentiments trop vifs ; que leur déclin, sans s’arrêter à l’indifférence,
ne passe jusqu’au dégoût ; qu’on ne se trouve enfin tout à fait rassasiés
l’un de l’autre ; et que, pour s’être aimés amants, on n’en vienne à se
haïr époux ! »
Rousseau, La nouvelle Héloïse
. Analysons
rapidement le texte : tout d’abord l’amour fou, les corps qui se mêlent,
désirent s’unir et se fondre en un tout, le sentiment d’éternité (« le
temps des toujours toujours, le temps des serments d’amour » (Barbara,
Le temps du lilas).
. Puis, le temps
passant – quelques mois, quelques années seulement – l’amour s’éteint. De fait,
rappelle Rousseau, « depuis que le monde existe on n’a jamais vu deux
amants en cheveux blancs soupirer l’un pour l’autre ». Que s’est-il
donc passé ? Comment interpréter ce passage du temps, cette singulière
alchimie qui semble transmuer l’éternité d’une totalité unifiée (toi et moi ne
faisant qu’un éternellement) en coexistence de solitudes déchirées ?
. C’est, nous
dit, assez durement Rousseau, que cet amour-là n’était finalement qu’illusion.
En quel sens ?
. Rappelons
qu’en son sens ultime et profond, le sentiment amoureux consiste dans le vécu envoûtant
d’une autre existence et d’un autre monde polarisés autour de l’autre aimé
perçu comme celui qui nous manque essentiellement et dont l’union
avec nous apporterait tout ce que nous désirons, soit le bonheur
total et éternel.
. Or vivre une
autre existence comme réelle c’est ce que nous faisons chaque nuit lorsque nous
rêvons. Le rêve est, en ce sens le prototype de l’illusion s’il consiste
essentiellement à tenir pour réel un monde imaginaire. Notons, de plus, avec Freud,
que le rêve semble, le plus souvent (toujours pour Freud), la manifestation et
la réalisation d’un désir (serait-il inconscient). L’illusion consisterait donc
à croire réelle une production de notre imagination ancrée dans notre désir.
. Mais, dira
t’on, quel lien avec l’amour si, à la différence du rêve, nous sommes, dans
l’amour, éveillés et conscients ? Celui-ci, peut-être, que l’amour serait un
rêve éveillé. C’est ce que suggère Rousseau : loin de dissoudre un
amour essentiellement vrai, le temps de la vie commune, soit de la
confrontation avec la résistance du réel à nos rêves, ferait apparaître
l’illusion sur laquelle serait construit cet amour. Jugeons-en, en effet :
le « prince charmant », « l’âme sœur »,
« ma moitié », sont-ils vraiment tels que je les
perçois ? N’est-ce pas précisément en leur absence réelle, que le
sentiment amoureux est le plus intense ? Juliette éloignée, Juliette
interdite et le cœur de Roméo se déchire. Et ainsi de Tristan vis à vis
d’Iseult. N’est-ce pas dans la distance, dans la non-possession que notre amour
est le plus grand et que nous sentons que l’union avec l’aimé serait à même de
nous combler ? N’est-ce pas ainsi dans la mort, lorsque l’aimé a définitivement
disparu que l’amour est peut-être le plus intense, aucune réalité ne pouvant
plus s’opposer à nos fantasmes (projection imaginaire de l’objet de notre désir
sur un objet du monde) ? De même, la plupart des mauvais films, contes et
romans ne nous racontent guère que le début de l’amour : le film se termine
avec un : « ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ».
Mais que se passe t’il après ? Que sont les années de mariage ? Nous
parle t’on des colères, des déceptions, de la vaisselle cassée, de la haine
ordinaire, de l’ennui commun, des amants et amantes ? N’y a t’il pas dans
de telles images un singulier mensonge ?
. Aussi peut-on
faire l’hypothèse que les quelques mois ou années que semble durer la passion
amoureuse sont le temps nécessaire pour que se dissipe l’illusion. Se heurtant
au terre à terre quotidien, aux paroles et aux gestes de l’autre, le voile
imaginaire que je projetais sur l’aimé se disloque peu à peu. « Alors, écrit
Rousseau, l’idole qu’on servait détruite, on se voit réciproquement tels
qu’on est ». Tel que l’on est ? Que sommes-nous en vérité ?
Pour peu que nous soyons un peu lucide, nous savons bien que nous ne sommes pas
merveilleux. Comment l’autre le serait-il ? Et pourquoi
m’élirait-il moi ? C’est sûrement qu’il se trompe. Et je me trompe aussi.
Dans la passion amoureuse, on voit précisément l’autre tel qu’il n’est pas, à
l’image de nos désirs et de nos rêves. L’autre alors n’est que le support de
mon fantasme, il n’est pas vu en
lui-même et pour lui-même, mais en ce qu’il semble être la
matérialisation de mes plus profonds désirs.
. La révélation
du fait que l’autre n’est jamais à l’image de mes profonds désirs (« qu’il
m’aime moi », « que je sois son tout », « qu’il soit
parfait », etc. ) est toujours une épreuve douloureuse, telle celle
de cette femme dans l’œuvre de Maupassant – c’est la révélation de notre être solitaire et
de l’illusion que recèle toute union :
« Elle
comprit. Elle comprit que même entre les bras de cet homme, quand elle s’était
cru mêlée à lui, entrée en lui, quand elle avait cru que leurs chairs et leurs
âmes ne faisaient plus qu’une chair et qu’une âme, ils s’étaient seulement un
peu rapprochés jusqu’à faire toucher les impénétrables enveloppes où la
mystérieuse nature a isoler et enfermer les humains. Elle vit bien que nul
jamais n’a pu ou ne pourra briser cette invisible barrière qui met les êtres
dans la vie aussi loin l’un de l’autre que les étoiles du ciel. Elle devina
l’effort impuissant, incessant depuis les premiers jours du monde, l’effort
infatigable des hommes pour déchirer la gaine où se débat leur âme à tout
jamais emprisonnée, à tout jamais solitaire, effort des bras, des lèvres, des
yeux, des bouches de la chair frémissante et nue, effort de l’amour qui
s’épuise en baisers pour arriver seulement à donner la vie à quelque autre
abandonné. » (Maupassant).
Concluons
donc sur ce point : celui qui croit trouver le bonheur, soit le sentiment
d’adéquation de soi à soi, de soi à l’autre et de soi au monde, à travers un
tel amour semble se leurrer gravement. La réalité la plus courante de l’amour
semble bien plutôt être la déception. Ce ne serait pas à travers la passion
amoureuse que l’on pourrait se réaliser : celle-ci projetterait devant nos
yeux un voile illusoire voué, un jour ou l’autre, à être déchiré. Est-ce à dire
qu’il faut être dépassionné ? Vivre mollement ? Qu’aucune relation
forte à l’autre ne peut véritablement exister ? Qu’aucun amour puissant et
non illusoire ne serait donc possible ? C’est là une hypothèse qu’on peut
difficilement garder calmement devant nos yeux. « Non, non »,
a t’on peut-être envie de dire, « ces analyses là ne valent rien et si
elles valent pour les autres, elles ne valent pas pour moi ». Mais qui
parle ici ? Notre désir ou notre raison ? C’est néanmoins par la
raison qu’on tentera de penser la possibilité d’un véritable amour dans la
quatrième partie. Ce qui est cependant très probable c’est qu’une forme de
l’amour, la forme la plus courante, semble vouée à l’échec.
B) La
gloire
Le deuxième objet d’amour des hommes, c’est
la gloire soit le désir de supériorité sur et de reconnaissance par
les autres hommes. Combien sont-ils ceux qui rêvent de dominer une parcelle
voire le tout du monde ? Devenir juge, avocat, médecin, être sur le
podium, « devenir calife à la place du calife » (Iznogoud)… -
voilà des positions qui apparaissent intensément désirables. Beaucoup y
travaillent et y
dépensent
l’effort de leur vie. Le sens de cette activité, c’est bien entendu, là encore,
le bonheur escompté. Mais, encore une fois, l’expérience de l’humanité semble
nous indiquer qu’en la gloire nul bonheur ne se trouve. Pourquoi ?
Ce qu’il
semble : de loin, c’est à dire d’en bas, la position de celui qui est
plus haut que nous, qui semble vivre d’une vie reconnue et publique nous semble
intensément désirable. Alors que nous nous sentons enfermé dans une existence
privée, que nous ne sommes reconnus par personne, que nous sommes en
ce sens « personne », il y a là-haut, ceux qui sont, ceux
qui existent vraiment dans la lumière publique. Au premier échelon
de la réussite il y a aujourd’hui ceux que l’on
appelle « maître », « docteur »,
« professeur », « colonel », etc.
dont on valorise et distingue
le nom générique de celui des hommes plus communs. Puis, en haut de l’échelle,
ceux qu’on appelle « les peoples », qui ne sont plus
simplement les représentants d’une classe supérieure commune (les avocats, les
médecins, etc. ) mais qui ont aussi un nom singulier et qui semblent reconnus
pour tels : sous les éclats de la reconnaissance publique – plateau de
télévision, journaux, éclairs dans les regards…- il nous semble que ces gens-là
vivent une toute autre existence, existence sensée d’une vie de lumière.
N’est-ce pas là une forme de bonheur ?


2) Témoignages
et analyse. Il faut cependant toujours distinguer entre ce qui semble de
loin, lorsque nous imaginons et nous imaginons possédant l’objet du
désir que nous ne possédons présentement pas (cet amour, cette place, cette
auto, etc.) et la réalisation du désir, soit non plus l’imagination à distance de la possession mais l’épreuve
réelle de cette dernière. Or, à lire les témoignages qui courent dans
l’histoire, ce n’est guère le bonheur que semble atteindre celui qui suit les
sentiers de la gloire.
Sur le chemin
d’abord :
la vie de celui qui veut réussir sur la scène publique est une vie de travail,
de lutte et de concurrence : l’ambitieux bave d’envie en regardant ceux
qui sont plus haut que lui – et il y en a toujours ; comme les places
sont limitées, que la lumière (les grands) ne se voit
qu’en
contrastant avec l’ombre (les petits), il faudra compter sur la concurrence,
donc la haine – vis à vis des concurrents, des concurrents vis à vis de soi –
la tromperie et l’envie (des plus bas que soi). Certes alors, on pourra jouir
de sa position vis à vis des plus faibles (cf. dessin de Quino), mais ce n’est
là qu’une compensation car l’imagination de l’ambitieux va naturellement vers
ce qui est plus haut que soi et s’attriste de sa position inférieure. Voilà
pourquoi, par exemple, tel grand ambitieux, qui semble un modèle digne d’envie
pour les autres, ne voit essentiellement dans sa position que ce qu’il
n’est pas encore : partout à tous les échelons sociaux, le ministre rêve
d’être président, le certifié agrégé, l’inspecteur recteur, le sous-chef chef,
le caporal sergent, etc. De fait, nous sentons bien plus ce que nous n’avons
pas que ce que nous possédons, tel l’enfant entouré de jouets qui ne rêve
que de celui qui lui manque (cf. aussi la santé).
Tout en haut
ensuite
puisque c’est là le but : l’Ecclésiaste dans la Bible,
devenu roi de Jérusalem et possesseur des plus grandes richesses, déclare que
« tout est vanité ». Le vizir d’Iznogoud tout ainsi que les
maîtres romains arrivés au sommet de leur gloire s’ennuient. Les magazines
« people », à leur tour, nous content les malheurs propres des
vedettes (de là les débauches, la drogue, les suicides…). Encore imaginons-nous
qu’il y a un « tout en haut » : le fait qu’il y a
toujours des autres en concurrence avec nous rend beaucoup probable le fait que
nous n’atteindrons jamais le sommet et serons ainsi toujours en chemin.
Quelle est donc l’illusion
propre de l’ambitieux ? C’est l’illusion selon laquelle telle
situation, telle place aurait une valeur propre (bien absolu) et serait
susceptible de combler son désir.
Mais c’est ce
qui ne se peut car : a) La valeur d’une place est
toujours relative : à ce que les autres ont et à ce qu’ils n’ont
pas. La bonne position sociale du médecin généraliste vis à vis de l’ouvrier
devient mauvaise vis à vis du chirurgien. De là, du fait de la concurrence de
tous, une nécessaire insatisfaction; b) La vie de l’ambitieux est, par
conséquent, celle d’une course en avant mue par un désir sans fin qui ne
peut jamais se réaliser; c) Qui n’apporte aucun plaisir substantiel, aucun
véritable bien parce qu’il est fondé sur une simple image (l’image que je
me fais de ma propre position vis à vis des autres), finalement extérieure à
moi et donc superficielle. De là le changement de valeur de cette image au gré
du vent de mes humeurs et de l’opinion.
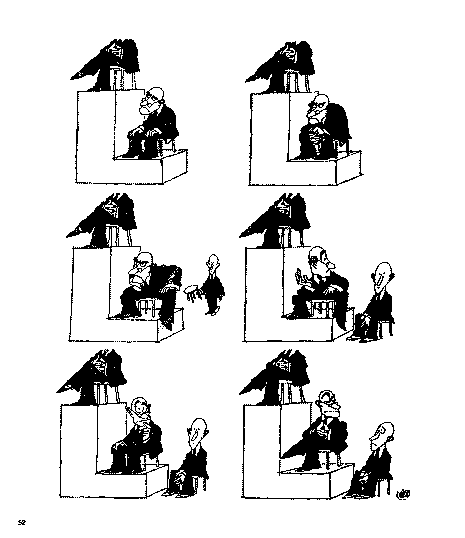

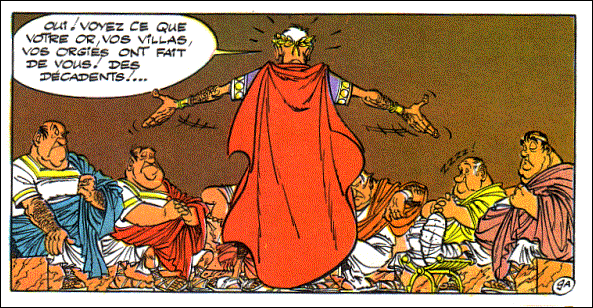
Conclusion :
là encore, celui qui croit que telle situation et telle place dans la
lumière sociale (gloire, honneurs, réussite, situation sociale) peut lui
apporter le bonheur, soit l’adéquation joyeuse de soi à soi et de soi au monde,
semble se leurrer, pour les trois raisons précédentes . Faut-il en conclure
que, pour être heureux, il vaut mieux vivre reclus, éloigné de toute quête de
reconnaissance ? Vivre seul pour être heureux?
Peut-être. Peut-être aussi la critique précédente ne porte t’elle que
sur des formes aliénées (non libres) de reconnaissance. Peut-on
au contraire penser une véritable reconnaissance, une véritable relation à
l’autre et aux autres, comme un ingrédient du bonheur ? C’est ce que nous
éluciderons dans la dernière partie.
3) La
richesse
Le dernier objet
d’amour des hommes c’est enfin la richesse. Là encore, tout comme l’amour et la
gloire, la richesse – soit l’accumulation ou la possibilité d’accumulation de
biens rendant possible une vie luxueuse libérée de la nécessité – semble un but
en soi. « Pourquoi veux-tu faire ce métier ? ».
« Pour gagner de l’argent », répondent beaucoup, supposant
ainsi que la richesse matérielle est un bien absolu, qui vaut en
lui-même en ce qu’il permet directement d’accéder au bonheur.
Accordons que
bien vivre suppose, en effet, de pouvoir assouvir les besoins élémentaires (se
nourrir, se loger, se vêtir…) et que, pour ce faire, il faut pouvoir accéder à
une certaine somme de biens matériels. Celui dont la vie se réduit à la
nécessité – à l’assouvissement des besoins primaires sans autre perspective de
vie (esclave, travailleur à la chaîne, sdf…) - ne saurait, semble t’il, être
heureux. Le bonheur en ce sens est un luxe de l’existence qui suppose sa
part de biens matériels (donc de travail et d’effort). On conviendra aussi que,
ces besoins élémentaires étant limités, ainsi en est-il des biens qui
permettent de les combler.
Mais ce n’est
pas ce qui est ici en question : notre question est de savoir si la
richesse matérielle peut-être qualifiée de bien absolu, c’est à dire de
voie privilégiée d’accès au bonheur. Or trois faits et raisons, là encore, nous
font répondre par la négative :
a) Tout d’abord un
fait : là encore l’expérience privilégiée est celle de la déception.
Le jouet dont l’enfant rêvait tant, qui était source de tant de rêves lorsqu’il
était encore non possédé sur le catalogue finira bien vite par terre,
abandonné, avec tous les autres : « ce n’était donc que ça ! »,
finissons-nous par dire. Même chose chez celui qui est supposé grand,
l’individu moderne soupirant auprès des mille biens inutiles dont il est
entouré et qui ne lui donnent pas la satisfaction promise. Les rois – et les
roitelets que sont les modernes consommateurs - s’ennuient au sein de
l’abondance. De là une course en avant auprès de nouveaux biens supposés
combler ce manque sourdement ressenti qui fait le fond de la vie commune.
Certes, dira t’on, il y a bien quand même quelques satisfactions. Le jeu n’est
pas totalement à somme nulle. Mais enfin, si nous passons notre vie à
travailler et si notre temps libre est occupé à jouir et à acheter de tels
gadgets, qui pourra dire que sa vie a réellement un sens ? On
pourra pour se convaincre sur ce point répéter les trois tests de la
deuxième partie.
b) Pourquoi
donc, au final, une telle insatisfaction ? C’est tout d’abord qu’il
ne s’agit que d’avoir et que de tels avoirs sont extérieurs à
notre être. C’est bien là le sentiment de celui qui se découvre nul et vide au
milieu des richesses matérielles ; c’est le sentiment propre de celui qui
s’ennuie : « rien de
tout ça n’est
vraiment moi, vraiment conforme à mon désir ». C’est une telle confusion de
l’avoir et de l’être que dénonce Montaigne : « Nous
louons un cheval de ce qu’il est vigoureux et adroit, non de son harnais ;
un lévrier de sa vitesse, non de son collier (…) Pourquoi de même
n’estimons-nous un homme par ce qui est sien ? Il a un grand train, un
beau palais, tant de crédit, tant de rente : tout cela est autour de lui,
non en lui (…) Pourquoi, estimant un homme, l’estimez-vous tout enveloppé et empaqueté?
Il ne nous fait montre que des parties qui ne sont aucunement siennes, et nous
cache celles par lesquelles seules on peut vraiment juger de son estimation.
C’est le prix de l’épée que vous cherchez, non celui de la gaine : vous
n’en donnerez à l’aventure pas un quatrain, si vous l’avez dépouillé. Il le
faut juger par lui-même non par ses atours » (Essais, I, XLII).
Un étron recouvert d’or reste un étron. Et comment en serait-il heureux ?
c) Or si nous
cherchons à être davantage en ayant davantage ce n’est pas seulement parce que
l’objet nous promet une jouissance privée, c’est aussi parce que sa valeur
est indissociable d’un paraître soit de la relation qu’il entretient
avec la possession et le regard des autres. C’est ce que nous montre Marx
et, à suite, le dessinateur Quino. « Qu’une maison soit grande ou
petite, tant que les maisons d’alentour ont la même taille, elle satisfait à
tout ce que, socialement, on demande à un lieu d’habitation. Mais qu’un palais
vienne à s’élever à côté d’elle, et voilà que la petite maison se recroqueville
jusqu’à n’être plus qu’une hutte. C’est une preuve que le propriétaire de la
petite maison ne peut désormais plus prétendre à rien, ou à si peu que rien.
[…] Ses habitants se sentiront toujours plus mal à l’aise, toujours plus
insatisfaits, plus à l’étroit entre leur quatre murs, car elle ne cessera de
devenir plus petite à mesure que grandira le palais voisin, et dans les mêmes
proportions. » (Karl Marx, Travail salarié et capital).

L’illusion de bonheur de celui qui
obtient son « 4 » ou sa maison consiste, précisément dans l’oubli de
la nature relative de la valeur du bien qu’il possède. Quelqu’un possède t’il un « 6 » ou
un château, mon « 4 » ou ma maison, en restant pourtant
matériellement et utilitairement parlant identiques, perdent leur valeur de
bonheur. Si tous ont des Nike, mes Nike ne valent plus rien. On comprend ainsi
que dans une telle course concurrentielle nul ne peut atteindre l’objet de son
désir et ainsi, croit-il, être heureux, puisque à mesure de l’obtention par moi
de nouveaux biens, les autres en font de même dévalorisant ainsi les miens dans
une course sans fin. De fait, aujourd’hui, nous vivons communément dans une
richesse matérielle inconnue de nos arrières grands-parents. Pouvons-nous, pourtant,
nous dire plus heureux ? Il est bien entendu que non. Car, allons-nous
voir, le bonheur dépend de toute autre chose – et bien plus de nous-mêmes
que de l’état des choses.
Conclusion de la troisième partie
Gloire,
amour, richesse apparaissent comme les trois biens susceptibles d’apporter le bonheur.
Voilà pourquoi ils constituent les objets de désir des hommes et tout le sens
de leur activité. Mais, avons-nous vu, tout semble indiquer que la promesse de
bonheur n’est pas tenue. L’amour, la gloire et la richesse réels ne
seraient donc pas ces biens absolus, ayant une valeur en soi et apportant une
pure joie. Selon les analyses précédentes, ils ne seraient que des biens
relatifs, vacillants, finalement en eux-mêmes inconsistants et par là-même
incapables d’apporter le bonheur promis. Le joyeux drille
Schopenhauer disait ainsi que « la vie de l’homme oscille comme un
pendule de la douleur à l’ennui », douleur lorsque l’on n’a pas
l’objet de notre désir et que nous souffrons de la séparation, ennui lorsqu’enfin
on l’obtient et que l’on découvre qu’il ne saurait nous satisfaire. Nos vies
seraient ainsi des courses absurdes et vaines après des objets
vides. Le diagnostic de Schopenhauer a certainement sa validité. Beaucoup –
la plupart ? - avons-nous vu (II), ont véritablement raté leur vie.
Peut-on y remédier ? Que faire de ce temps limité de vie qui nous est
imparti sans tomber dans les pièges d’un bonheur promis, d’un bonheur en
image qui ne survient jamais ? C’est à cette question que répondent ce
qu’on peut appeler les philosophies du bonheur.
IV) Philosophie
du bonheur
Rappelons nos
acquis : 1) Le bonheur est un état durable d’accord avec soi et le
monde ; 2) Il ne peut être construit qu’en acquérant des biens absolus ou
substantiels (qui ont une substance solide, qui ne s’enfuient pas au gré
du vent du hasard); 3) Tels semblent l’amour, la gloire et la
richesse ; 4) Mais l’expérience et l’analyse nous ont fait saisir que de
tels biens n’étaient qu’illusoirement absolus et substantiels ; 5)
Celui qui choisit et construit sa vie autour de ces trois biens ne connaîtra
donc pas, semble t’il, le bonheur mais la déception et l’insatisfaction.
Comment donc
construire une vie heureuse ? Conformément à la pensée d’Aristote (cf. I),
il faut que celle-ci s’ancre dans la recherche d’un bien absolu et
substantiel – non relatif et évanescent (fuyant, éphémère, variable). Que
peut donc être un tel bien ? Nous avons vu que l’illusion de la plupart
des hommes est telle qu’ils pensent trouver ce dernier dans la gloire, l’amour
et la richesse. Aussi si nous sommes spontanément jetés vers des faux modèles
du bonheur, la première condition à son accès semble être la connaissance
qui nous permet de discerner le vrai du faux.
A) Connaissance
et bonheur
« Quand
on ignore qui on est, pourquoi on est né, dans quel monde et avec quels
compagnons on vit, ce qu’est le bien et le mal, le beau et le laid, quand on ne
connaît rien à la démonstration ni au raisonnement ni à la nature du vrai et du
faux, quand, incapable de les distinguer, on ne se conforme à la nature ni dans
ses désirs, ni dans ses aversions, ni dans sa volonté, ni dans ses intentions,
ni dans ses assentiments, ses négations ou ses doutes, on tourne de tout côté
comme un sourd et un aveugle, on croit être un homme et l’on n’est personne.
Depuis que la race humaine existe, toutes nos fautes, tous nos malheurs ne
sont-ils pas nés d’une pareille ignorance ? » (Epicure)
. Nous sommes
jetés dans un monde social et historique et, par l’éducation, nous faisons
corps avec lui : nos idées, nos désirs, nos sentiments ne sont pas
premièrement nôtres et irréductibles mais ceux de tous et de chacun (« la
coutume est notre seconde nature » (Montaigne) – cf. cours sur la
Culture et la liberté). Aussi croyons-nous savoir qui nous sommes, ce
qu’est le monde, le bien, le mal et quel est le sens de la vie – la valeur, la
direction et la signification que nous devons lui donner.
. Mais,
avons-nous montré à travers l’analyse de l’amour, de la gloire et de la
richesse, les biens vers lesquels nous nous dirigeons spontanément ne sont pas
des biens véritables (absolus et substantiels). Aussi, dit Epicure, errons-nous
de la douleur à l’ennui sans savoir ce qui est véritablement – et ici pour
nous, ce qu’est le vrai sens de la vie, soit selon son vocabulaire, le sens
conforme à la nature (c’est à dire ici à ce qui est et doit véritablement
être).
. Le remède est
donc dans la connaissance. Si, en effet, je connais la nécessité et
l’origine de mes maux, ne puis-je m’en guérir ? C’est ce que fait le
médecin avec les corps. C’est ce que nous devons faire avec les maux de l’âme.
Il ne s’agit pas de la connaissance abstraite et théorique du savant mais de
cette connaissance concrète que nous prétendons tous détenir et à
laquelle, de fait, nous participons - plus ou moins bien - lorsque nous
(nous) jugeons. La sagesse n’a pas nécessairement à être celle d’un théoricien.
C’est celle, plus ou moins puissante, plus ou moins éclairée, de celui qui,
jeté dans le monde, a compris et comprend là où la plupart des hommes
sont le jouet de forces aveugles. Cf. « j’ai compris que je devais le
quitter » ; « j’ai compris qu’il fallait que je change de
métier », etc. – cette compréhension est un certain éclairage sur
nous-mêmes et sur le monde.
. Si donc la
connaissance de l’origine de nos malheurs est la condition pour que nous nous
en libérions, on conçoit qu’un bonheur solide est indissociable de la vérité.
Un bonheur tissé d’illusions n’est-il pas en lui-même fragile ? Celui qui
croit que le bonheur adviendra avec l’obtention de telle médaille, salaire ou
baiser – si, conformément à l’analyse précédente (III), de tels
biens ne sont qu’illusoirement des biens substantiels ou absolus – n’est-il
pas, par nature, destiné à subir la désillusion ? A contrario, en
connaissant la nature de ces illusions, je peux ouvrir à mon désir d’autres
chemins vers un bonheur plus solide et vrai.
. Quel est donc
le bien absolu par delà tous les biens insubstantiels et illusoires qui
sont ouverts à notre désir ? Notre première hypothèse sera celle-ci qu’il
s’agit du plaisir. Eprouvons-là :
B) Le
plaisir
. Si, en effet,
l’amour, la richesse et la gloire sont des biens imaginaires qui ne résistent
pas au dévoilement de l’illusion sur laquelle ils reposent peut-être, que reste
t’il de positif et plein qui semble ne reposer sur aucune illusion ?
Certains, désillusionnés de la vie, répondent : le plaisir. Même si
l’amour, par exemple, est une illusion, le plaisir qui naît du mélange des
corps, lui, éprouvé au présent, ne, reposant, semble t’il, sur aucune illusion,
n’est pas, pense t’on, susceptible de s’évanouir. Aussi conviendrait-il, pour
peut-être être heureux, de faire l’amour en renonçant à aimer (la passion
amoureuse étant, selon certains, une torture de l’âme sans but véritable, cf. III.A).
C’est ce que propose l’épicurien Lucrèce :
« Ces simulacres d’amour sont à
fuir, il faut repousser tout ce qui peut nourrir la passion ; il
faut distraire notre esprit, il vaut mieux jeter la sève amassée en nous dans
les premiers corps venus que de la réserver à un seul par une passion exclusive
qui nous promet soucis et tourments. L’amour est un abcès qui, à le
nourrir, s’avive et s’envenime ; c’est une frénésie que chaque jour
accroît, et le mal s’aggrave si de nouvelles blessures ne font pas diversion à
la première, si tu ne te confies pas encore sanglant aux soins de la Vénus
vagabonde et n’imprimes pas un nouveau cours aux transports de ta passion.
En se
gardant de l’amour, on ne se prive pas des plaisirs de Vénus ; au
contraire, on les prend sans risquer d’en payer la rançon. La volupté véritable
et pure est le privilège des âmes raisonnables plutôt que des malheureux égarés. Car dans l’ivresse même de
la possession l’ardeur amoureuse flotte incertaine et se trompe ; les
amants ne savent de quoi jouir d’abord, par les yeux, par les mains. Ils
étreignent à lui faire mal l’objet de leur désir, ils le blessent, ils
impriment leurs dents sur des lèvres qu’ils meurtrissent de baisers. C’est que
leur plaisir n’est pas pur ; des aiguillons secrets les animent contre
l’être, quel qu’il soit, qui a mis en eux cette frénésie. Mais Vénus tempère la
souffrance au sein de la passion et la douce volupté apaise la fureur de
mordre.
Car l’amour
espère que l’ardeur peut être éteinte par le corps qui l’a allumée : il
n’en est rien, la nature s’y oppose. Voilà, en effet, le seul cas où plus nous
possédons, plus notre cœur brûle de désirs furieux. Nourriture, boisson,
s’incorporent à notre organisme, ils y prennent leur place déterminée, ils
satisfont aisément le désir de boire et de manger. Mais un beau visage, un
teint éclatant, ne livrent aux joies du corps que de vains simulacres, et le
vent emporte bientôt l’espoir des amoureux. Ainsi, pendant le sommeil, un homme
que la soif dévore mais qui n’a pas d’eau pour en éteindre l’ardeur s’élance
vers des simulacres de sources, peine en vain et demeure altéré au milieu même
du torrent où il s’imagine boire. En amour aussi, Vénus fait de ses amants les
jouets des simulacres : ils ne peuvent rassasier leurs yeux du corps qu’ils
contemplent, leurs mains n’ont pas le pouvoir de détacher une parcelle des
membres délicats et elles errent incertaines sur tout le corps. » (Lucrèce, De la
nature, livre quatrième)
. Selon Lucrèce,
en effet, les amants fous d’amour, se laisseraient aveugler par des simulacres
(des images dont la réalité à laquelle elles se réfèrent serait inexistante).
Voilà pourquoi ils erreraient sans bonheur (cf. III.A). Mieux vaudrait alors
goûter le plaisir pur (de fantasmes, d’illusions, de simulacres) de la jouissance
corporelle ! Au moins le corps, lui, pense t’on, ne nous trompe pas !
Aussi la philosophie d’Epicure nous propose t’elle d’apprendre à savourer les
biens de cette vie, en nous dégageant des buts illusoires, des désirs vains
gorgés d’un imaginaire irréalisable, qui, nous projetant sans cesse vers un
futur inexistant, nous empêcheraient de goûter aux plaisirs de la vie.
. Rappelons, en
effet (cf. I.), que le bonheur doit être fondé sur un bien (une chose,
un acte, une rencontre) qui a les caractères de l’absolu, offrant ainsi
une jouissance pure ayant un sens en elle-même sans renvoi à un ailleurs ;
qu’il doit, de plus, être l’objet d’une possession présente. Sinon, en
effet, comme dit à peu près Pascal, nous ne vivrons jamais, nous espérons de
vivre, nous ne serons jamais heureux, nous espérons de l’être. Or, tel
semble, en effet le plaisir dont nous parlent Epicure et Lucrèce :
faire l’amour, manger un bon plat, goûter une conversation animée, écouter de
la belle musique… cela semble bien avoir un sens en lui-même sans
renvoyer aucunement à un ailleurs. Par conséquent, une vie heureuse
serait, dans ce cadre, une vie qui cultive le maximum de plaisir et évite, par là-même, le maximum de
peines.
. Or si la
formule en semble simple, la réalisation n’en est nullement automatique. C’est
qu’il y a un art de (bien) vivre qui ne peut se construire et se
déployer qu’en évitant les pièges ordinaires. Le premier tient, semble t’il, à
la nature du désir qui, avons-nous vu, nous projette sans cesse vers quelque bien
futur dont nous imaginons qu’il nous donnera la satisfaction espérée. Ici, nous
désirons être ailleurs : sans Rosalie, avec Rosalie ; puis avec
Rosalie, avec nos amis, etc. ; et quand nous sentirions-nous bien avec
elle, nous pensons déjà au temps de la séparation qui donne un goût amer au
plaisir présent. Or, notons-le encore une fois, ce qui nous empêche de goûter
au plaisir du présent, c’est toujours le désir d’un bien absent et imaginaire
(l’imagination de la présence de Rosalie, puis de nos amis, etc.). Il y aurait
donc une certaine sagesse à renoncer à la tension vers cette irréalité
imaginaire qui nous empêche de vivre au présent. C’est tout le sens du « carpe
diem » (cueille le jour) d’Horace. Seul existe ce jour-ci, demain
n’est rien et sera de toute manière tout autre que ce que tu en imagines. Vis
donc au présent et apprend à goûter aux plaisirs bien réels de la vie !
. Certes, mais comment faire, demandera t’on,
si bien malgré moi mon imagination s’envole vers ailleurs ?
Premièrement : la pensée de la vanité (cf. III) des objets communs du
désir et de l’irréalité de demain par rapport au présent en lequel seul
j’existe, libère un espace de pensée et une force de désir pour la visée
d’autre chose (nous ne sommes plus, au moins l’instant de cette pensée-là,
obsédés par la chose) – arrêt pour un instant du flux de l’imagination et du
trépignement sur place - « bon d’accord, tout cela est peut-être vain
et puis je suis ici pour un moment autant le vivre le moins mal possible». Deuxièmement :
je peux, par là-même, concentrer mon attention sur le seul présent – au lieu
d’être ailleurs par la pensée, je peux m’absorber dans la contemplation des
couleurs du printemps comme des feuilles d’automne, apprécier les odeurs
multiples de la nature comme des plats que je goûte, me rendre attentif à la
parole et aux gestes des autres… Et ceci, peut-être presque partout. Dans le
train, le métro ou le bus, pendant ce temps contraint pour rentrer chez soi ou
aller au travail, il y a toujours à contempler, à s’étonner et à
connaître – les manières d’être des hommes, leurs relations invisibles,
les détails inédits… Et de même à l’école, au lieu de bailler et de
trépigner : se rendre attentif et participer activement au discours
scolaire – tant il est vrai que nous sommes largement responsables de notre
propre ennui. Se dire : « Comme je sui,s de toute façon ici,
autant que cela se passe le moins mal possible » - il y a, de fait,
deux manières d’accueillir ce qui est nécessaire (ce qu’on ne peut
changer) : le désir d’évasion impossible de la colère et du trépignement
ou bien, sous une forme ou une autre, le consentement.
. Cela
suffit-il, pour autant ? On conviendra qu’il vaut mieux encore que nous nous
libérions de la contrainte. Or ce n’est peut-être pas impossible si beaucoup de
ces contraintes sont, en réalité, les conséquences de nos propres choix. Si je
travaille tant, si je fais des heures supplémentaires, si je passe tant
d’heures dans les transports, etc. – c’est certes que je dois bien vivre – mais
c’est aussi souvent parce que j’ai des besoins tels qu’ils exigent ce temps
contraint. Combien d’étudiants, en effet, qui travaillent « à Mac
Do » non simplement pour vivre (ce qui est, dans ce cas, pure nécessité)
mais pour s’acheter voiture, portable, etc. ? Or de tels biens sont des
biens de luxe et si l’on trouve, peut-être un plaisir à les consommer (plaisir
limité cependant, cf. III.3), la contrepartie de leur obtention est l’enchaînement
d’une grande partie du temps libre de ma vie à leur quête. Il y a, de fait, un
piège du désir : à posséder des biens de luxe, disait à peu près Epicure,
on s’habitue à un certain train de vie qui : 1) exige de nous un temps
contraint (cf. les heures supplémentaires) où nous ne trouvons nul
plaisir ; 2) ne nous donne pas le plaisir espéré puisque l’habitude de
jouir des biens efface la jouissance. Lorsque, par exemple, nous allons tous
les jours au restaurant, nous en perdons le plaisir que nous goûtons lorsque le
restaurant est un « extra », parfois imprévu, et non une
habitude. Il y a de fait une loi du plaisir qui est celle selon laquelle
la jouissance obtenue diminue avec la quantité (de plus en plus de gâteaux, de
moins en moins de plaisir – la première bouchée, elle, est un délice). Mais
cette habitude qui finalement n’apporte pas un très grand plaisir nous enchaîne doublement :
1) par le temps contraint passé à la satisfaire ; 2) parce que perdre
l’objet auquel nous sommes habitués est un déchirement : celui qui a
toujours roulé en BMW et qui est, pour cause de licenciement, contraint de
rouler en 106 ou de marcher à pied en souffre énormément. Ce qui est, dans ce
cadre, très intéressant est que, interrogés sur le salaire minimum pour vivre
décemment, chaque catégorie de revenu de la société (sauf les très bas
salaires, bien entendu) répond en gros en affichant son propre revenu,
serait-il très élevé : c’est qu’ils sont habitués à un certain train de
vie, qui est désormais ancré dans leurs désir (contingent) qu’il prennent
désormais pour un besoin (nécessaire).
. Par
conséquent, dirait Epicure : autant pour bien vivre, nous mettre le
moins de chaînes possibles afin de pouvoir jouir de plaisirs qui, restent des
« extras » ; ne pas enchaîner le temps de nos vies à la
contrainte nécessaire pour obtenir des biens de luxe (inutiles et, au final,
peu satisfaisants) ; garder le maximum de temps libre pour jouir du temps
présent ; enfin, ne pas sacrifier notre vie future à un petit plaisir
présent (cf. drogues, etc.). On pourrait formuler ainsi la sagesse
d’Epicure : « Jouis le plus et le mieux possible des biens de ce
monde dans le temps présent sans y aliéner (perdre, enchaîner) ta
liberté qui est la condition de ta jouissance ».
Conclusion : ainsi le plaisir,
pour qui sait le goûter au présent en évitant les pièges du désir, semble t’il être
ce bien substantiel et absolu qui donne sens à la vie. Mais cela
suffit-il, pour autant ? On conviendra que ce n’est pas rien et qu’il y a,
en effet, une sagesse qui consiste à savoir bien vivre et jouir des biens de ce
monde. Mais enfin, en refaisant les trois tests précédents (cf. II),
pouvons-nous être pleinement satisfaits d’une telle vie ? Comment, en
effet, le jouisseur qui vieillit pourrait-il consentir au temps qui passe et
l’entraîne vers la mort ? Ne doit-il pas, un jour ou l’autre, se
dire : « qu’ai-je fait, qu’ai-je construit dans ma vie ?
» et se désespérer d’une vie de jouissance qui ne laisse nulle trace et où
le temps de la jouissance passée est un temps définitivement aboli ? Deux
voies semblent à même de résoudre cette question dans un sens positif : la
voie du désintéressement qui est celle du véritable amour (différence
avec l’amour vain, cf. III.A) et celle de l’ambition bien comprise qui,
contrairement à la vaine quête de la gloire (cf. III.B) est le chemin de la construction
de soi.
C) L’amour
– le désintéressement
. A « l’amour
passion » qui est, selon l’analyse précédente, un amour illusoire
(puisque fondé sur ce qu’on imagine et projette sur l’autre, bien plutôt que ce
sur ce qu’il est vraiment), on peut opposer un amour véritable : aimer
véritablement quelque chose ou quelqu’un, ce n’est ni aimer mes propres
fantasmes, ni le plaisir égoïste qu’il me procure, c’est l’aimer pour lui-même
et y trouver sa joie. « Aimer c’est trouver sa richesse hors de soi »,
écrit le philosophe Alain – autrement dit, c’est découvrir que je ne me suffis
pas, et qu’il y a du merveilleux autour de moi à la source duquel ma vie peut
se nourrir.
. Or, il n’y a
rien d’évident dans un tel amour qui suppose toujours le dépassement de
l’égocentrisme (je = centre) et de l’égoïsme (mes intérêts, mon plaisir avant
tout). Il y aurait donc deux manières d’aimer et deux sens de ce verbe. On peut
aimer quelque chose pour soi (par intérêt, par plaisir) – ou l’aimer pour
lui-même. Ainsi d’une musique, d’un enfant, d’une femme, de fleurs ou même d’un
plat : je peux aimer cet enfant parce que c’est le mien, cette femme parce
que je la possède, ce plat pour le plaisir immédiat qu’il me procure – ou bien
parce qu’il est lui et parce qu’elle est elle. La distinction n’est certes pas
facile à effectuer puisque les deux amours sont mêlés dans la plupart de nos
amours : cette femme aime t’elle son enfant parce qu’il est le reflet de
lui-même, un produit de sa chair ou bien parce qu’il est simplement
lui-même ? Sûrement un peu des deux et c’est sur la part respective de
l’un et de l’autre que se joue le sens véritable de cet amour-là. Combien, en
effet, de parents qui ne voient en leurs enfants que le fantasme qu’ils y
projettent (la réussite que je n’ai pas eu, etc., cf. dessin de Quino
ci-dessous) ? Et l’acceptation de la réalité de l’autre – du fait que,
parce qu’il est un autre et non une marionnette, il ne répond jamais à mes
fantasmes et désirs – est souvent difficile.

Mais accepter ou
tolérer ce n’est pas encore aimer. Aimer est difficile car cela suppose que
l’on trouve sa joie dans l’existence de l’autre lui-même, hors de moi, de mes
désirs et de mes fantasmes. Que vis à vis d’un autre que soi, par exemple, on
s’émerveille de sa liberté, de sa créativité, de sa grâce sans ressentir une
seule seconde comme une offense le fait qu’il ne nous reconnaisse pas, sans
projeter nos fantasmes sur lui et nous lire à travers lui, sans être blessé en
retour par le sentiment de notre propre nullité – bref et pour tout dire, en s’oubliant
dans sa contemplation.
. Un tel amour
suppose ainsi une certaine libération de l’ego. C’est, en effet, dans la
distance et le désintéressement de la contemplation que peut s’éveiller
l’attention à la vie (cf. cours sur l’art, la technique et la vérité).
Or celle-ci exige que nous renoncions quelque peu à nous-mêmes, à ce regard
avide qui lit et réduit le monde à ses petits intérêts, n’aimant en ce dernier
que ce qui y correspond et délaissant le reste. Il y a ainsi deux manières de
goûter un bon vin (ou plat) : soit le réduire à notre propre ivresse et
l’avaler tout rond, soit le faire rouler dans la bouche, afin d’éveiller et de
se rendre attentif à ses saveurs propres qui ne se donnent ainsi que dans la
distance prise vis à vis de notre désir de boire et de réduire. On est alors dans
le vin, dans son monde propre et, tout en le goûtant et en le faisant
nôtre, c’est en lui que nous voyageons. Cet art de boire distingue tout
entier le gourmet, capable de s’oublier dans les mondes culinaires, du glouton
ou du goinfre, qui réduit la nourriture au plaisir immédiat et sans profondeur
de son ventre. Le premier aime le vin en et pour lui-même, s’y oublie et y
trouve sa joie ; le second n’aime du vin que les frustres sensations
immédiates qu’il procure. Dans la distance désintéressée de l’attention au
monde (ce qui ne signifie pas sans intérêt pour, cf. cours sur l’art et la
vérité, II.) nous goûtons la présence et le présent de la chose même. Il y
a ainsi tout un art d’être présent au monde qui a pour condition quelque oubli
de soi.
. Lorsqu’alors
dans l’amour ou dans l’amitié vrais, le sujet de notre amour est une autre
existence et qui, par miracle, nous aime en retour, c’est dans une autre
sphère de vie que nous sommes projetés : nos échanges de mots et/ou de
caresses nous ouvrent des mondes inédits dont nous sommes co-créateurs et qui
remplissent de sens nos vies – mondes désormais non plus mensongers et
illusoires (cf. III.A) mais tissés de l’amour réciproque d’êtres réels pour
leur réalité.
Conclusion :
pour celui qui s’est ainsi détaché de ce rapport immédiat, réducteur et
prédateur au monde qui caractérise le petit ego ; pour celui qui s’est, au
moins partiellement, libéré de l’égoïsme et de l’égocentrisme toujours
insatisfaits ; pour celui qui a ainsi reconnu qu’ « il y a
plus grand que moi » dont la contemplation suffit à sa joie ;
pour celui-là sa vieillesse et sa mort ne sont plus des catastrophes. Car ce
qui disparaît ce n’est que moi et l’essentiel, se dit-il, ce que j’aime,
cette nature infinie, ce terroir, cette ville et puis tous ceux que j’aime,
après moi seront toujours là. Dans et par cet amour, au seuil de la mort la vie
ne perd pas tout sens puisque l’essentiel se continue hors de moi. Aussi
peut-on, dans une certaine mesure, se réconcilier avec cette mort qui pour le
petit ego équivaut à la fin absurde et catastrophique du monde et lui fait, à
bon droit, douter du sens de sa vie. L’amour, en ce sens, semble être un
candidat bien plus solide que le seul plaisir (qu’il ne s’agit évidemment pas
de négliger mais de situer dans une hiérarchie – il y a l’essentiel, et le
reste auquel on donne aussi sa place) pour teinter de sens la vie en faisant de
celle-ci une vie riche et heureuse.
D) La
construction de soi – l’ambition et le travail
. Il y a
cependant un second chemin, une seconde voie vers le bonheur, dont on peut
penser qu’une vie bien conduite doit suivre la direction : cette voie
n’est plus celle de l’amour, soit du dépassement des désirs limités et limitant
de l’ego dans l’ouverture à la richesse du monde, mais, tout au contraire,
celle de l’intensification du désir et des puissances (capacités, pouvoirs) de
le réaliser.
. Ce qui
fait le malheur ou le non-bonheur commun, peut-on, en effet, analyser
c’est – premièrement, comme le dit le stoïcien Epictète dans son Manuel,
que les hommes font dépendre leur vie de ce qui ne dépend pas d’eux. En
centrant leurs désirs sur la richesse, l’amour-passion ou la gloire, ils se
condamnent à faire dépendre leur vie du hasard (puisque la richesse, la
réussite et l’amour des autres – dont dépend entièrement la réalisation du
désir, cf. III.A - ne sont pas en mon pouvoir) et ainsi à errer dans
l’insatisfaction et la frustration : s’il se trouve, en effet, par
l’alliance de la chance et de l’opiniâtreté que le désir semble se réaliser
(ex. obtenir tel poste de ministre), le bonheur fondé sur la quête illusoire
d’une image vacillante, lui n’est pas au rendez-vous (cf. III.A :
ce n’est pas si merveilleux que je l’imaginais). Tel est le second
point qui explique le malheur commun : se mettre en quête de ce qui n’est
qu’une image (tissée de mille fantasmes communs). Enfin, en dernier
lieu, la vie de beaucoup d’hommes est une vie dispersée, faite
d’occasions, de « jour le jour », de projets à court terme
sans grande unité – de là une existence qui ne construit pas grand chose de
solide et sans ligne de progrès continu. L’union de ces trois facteurs d’échec
– vie dispersée, dépendant du hasard de ce qui ne dépend pas de moi, centrée
sur des images - entraîne une réponse globalement négative aux « tests
de bonheur » (cf.II).
. A ce qui ne
dépend pas de nous (la richesse, la gloire), Epictète oppose ce qui dépend
de nous, c’est à dire ce qui est en notre puissance. Si faire dépendre ma
vie de ce qui ne dépend pas de moi (ma position vis à vis des autres, les
fluctuations de vaines apparences) me condamne à l’échec, construire cette
dernière sur mes propres puissances c’est, au contraire, lui donner des assises
solides. Or qu’est-ce qui est en ma puissance (pouvoir, capacité) ?
Penser, imaginer, voir,
entendre, sentir, danser, tailler…tout ce qui est action
(de l’esprit comme du corps) au présent. Aussi conviendrait-il de
renoncer à la rêverie – « j’aimerais être… » - pour l’action.
Mais comme une action, contrairement à une simple image, est confrontation
avec une réalité qui résiste à mon désir – je veux danser et mon corps ne suit
pas, écrire et les mots ne viennent pas… – celle-ci est toujours premièrement
échec et insatisfaction. Seul le travail c’est à dire l’exercice de mes
capacités se confrontant à la résistance du monde peut, en développant
et éduquant mes puissances, me permettre de dépasser mon
impuissance et mon insatisfaction premières. Or un tel progrès s’accompagne de
la joie. «La joie, en effet,
écrit Spinoza, est le passage de l’homme d’une moindre à une plus grande
perfection » (Ethique III, déf. 2) : le tennisman qui
arrive enfin à passer son service, le musicien qui invente une nouvelle phrase,
le mathématicien qui réussit une démonstration difficile, le menuisier qui
réussit son chef-d’œuvre, l’alpiniste qui atteint le sommet… tous ressentent
une joie, qui n’est pas un plaisir venant de l’extérieur, mais le sentiment
d’être plus puissant, plus capable, plus fort, le sentiment d’avoir progressé
et la fierté légitime de soi.
. Or celui qui
prend en main sa vie en tentant de construire cette dernière autour de ses
propres puissances en progrès semble s’assurer une vie heureuse. En
effet : a) La joie ressentie à une activité propre est d’autant plus
intense que nos puissances d’agir sont élevées : le grand musicien,
tennisman, penseur, menuisier… jouit bien davantage de son action que le
néophyte qui, de l’extérieur, ne comprend pas comment on peut passer sa vie à
cela. De là le fait qu’il y passe, de plus en plus, son temps – alors même
qu’il en était incapable autrefois et qu’il n’en avait pas le désir. Où l’on
saisit la différence centrale de la joie et du simple plaisir : de plus en
plus d’activité, de plus en de joie (plaisir provenant de moi-même) / de plus
en plus de consommation, de moins en moins de plaisir (plaisir provenant de
l’extérieur) (cf. IV.B) ; b) Si de l’extérieur, on ne peut pas comprendre
la joie que celui qui maîtrise une activité ressent, c’est que l’on n’a pas
accès au monde qui s’ouvre aux puissances du premier. Le grand musicien a accès
à un monde d’harmonies et de mélodies auxquels le médiocre est sourd, le grand
tennisman à un monde de nuances, de coups et de stratégie que le petit ne voit
même pas, le menuisier à une perception du bois, de ses qualités et des formes
possibles auxquelles nous sommes radicalement aveugle. Aussi avec le
développement de ses puissances, celui qui agit s’ouvre sans cesse devant lui de
nouveaux mondes et fait-il ainsi, sans sortir de sa sphère d’activité, de nouveaux
voyages. De fait, nous ne percevons du monde que ce que nous pouvons
en percevoir et nos pouvoirs ne sont pas les mêmes ; c) Ensuite, celui qui
dirige l’essentiel de sa vie sur le progrès de ses puissances assure à celle-ci
l’unité d’une vie en progrès (non la vie dispersée d’une répétition ou d’une
dégradation) dont il peut être légitimement fier ; d) Enfin, par-delà
lui-même, il ressent le désir de dire et de transmettre quelque chose de cet essentiel
que ses puissances lui ont permis de construire et d’atteindre : s’il peut
féconder d’autres désirs, tout, après lui, ne disparaîtra pas puisque le
monde de la musique, du tennis, de la pensée, du bois… que ses puissances lui
ont appris à construire, contempler et aimer se continuera au-delà de son
existence.
. Si ainsi le
non-bonheur est l’inadéquation de soi à soi et de soi au monde (je ne suis
pas et le monde n’est pas tel que je le désire) – en se changeant soi et en
changeant le monde à notre mesure, nous pouvons, par le travail qui rend possible
l’accroissement de nos puissances, construire un véritable bonheur : je
deviens tel que je le désire et je fais, dans la mesure des possibles, de ce
monde un monde mien.
Conclusion générale -résumé
1) Le bonheur est un état
durable et joyeux d’accord avec soi et le monde.
2) Il ne peut, avons nous
vu, être construit qu’en acquérant des biens absolus ou
substantiels (qui ont une substance solide, qui ne s’enfuient pas au gré
du vent du hasard) – une vie passée de biens relatifs en biens relatifs
sans jamais atteindre un bien ayant valeur en lui-même est une vie absurde.
3) Or, amour, gloire et
richesse, objets communs du désir des hommes, sont de tels prétendants à la
place de bien absolu garantissant le bonheur.
4) Mais l’expérience et
l’analyse nous ont fait saisir que de tels biens – reposant sur la concurrence
de tous avec tous et sur de vaines images - n’étaient, semblait-il, qu’illusoirement
absolus et substantiels.
5) Par conséquent celui qui
choisit et construit sa vie autour de ces trois biens ne connaîtra donc pas,
semble t’il, le bonheur mais, par-delà les menus plaisirs de la vie, la
déception et l’insatisfaction.
6) Si donc les hommes ne
sont généralement et communément pas heureux, la connaissance des causes
du malheur, en mettant en lumière les illusions communes, peut permettre,
apparemment, de s’en libérer pour enfin diriger nos vies vers des biens non
trompeurs.
7) L’analyse nous a ainsi
ouvert à la pensée de trois chemins en direction du bonheur, le premier étant
celui, épicurien, d’un plaisir lucide et bien conduit, le second étant
celui du véritable amour et du désintéressement, le troisième de la
puissance et de la réalisation de soi.
8) En évitant le piège des
habitudes consistant à désirer et jouir de biens de luxe qui, en nous donnant
de nouvelles chaînes (travail et habitudes), nous font aussi perdre l’intensité
du plaisir ; en gardant le maximum de temps libre pour jouir du temps
présent ; en pondérant, enfin, le plaisir en ne sacrifiant pas notre vie
future à l’intensité fugace d’un plaisir présent – une philosophie
d’inspiration épicurienne dessine les contours sympathiques d’un art de
vivre qui serait un art de bien jouir de la vie. On peut, cependant,
le juger insuffisant pour donner un sens plein à la vie (trois tests, cf. II).
9) En nous libérant des
désirs avides et toujours insatisfaits de l’ego, l’amour véritable comme
ouverture joyeuse à la richesse du monde, nous est apparu comme une autre
voie possible vers une vie heureuse. Celui qui vit et voit qu’il y a
plus grand que soi au contact duquel il trouve sa joie, parce qu’il est
libéré des chaînes réductrices du petit ego, ne se désespère plus ni sa
petitesse, ni de sa mortalité : l’essentiel est dehors et au-delà de
moi. Aussi trouve t’il son bonheur et sens plein à sa vie à se donner
pour ce qu’il aime.
10) La dernière voie, enfin,
consiste, tout au contraire, par l’effort et le travail, à intensifier et
accroître ses puissances de vie. Ainsi peut-on dans la joie, construire une vie
unitaire et en progrès de laquelle on peut légitimement être fier.
11) Qu’est-ce donc qu’une
vie réussie ? Pour être heureux, il ne s’agit, évidemment pas, de
sacrifier tous les plaisirs et les divertissements (nous avons aussi besoin de
cela) – mais de hiérarchiser et de disposer chaque activité à sa juste place en
faisant en sorte que l’essentiel (la plus grande part et la plus
importante) de notre temps de vie soit constitué par la quête et la
construction de ces biens absolus que l’amour et l’accroissement de nos
puissances de vie, par ce qui est toujours une forme de don de soi, permettent
d’acquérir. Telle semble bien la voie d’une vie heureuse.