Etude du Contrat
social (1762), livre I de Rousseau
Politique,
société, Etat, justice, droit, liberté, devoir, raison, morale, l’histoire
(Textes à la
fin)
Introduction : explication du sous-titre
« principes du droit politique »
1) Les deux sens du mot «droit ». Texte de Kant :
la question «qu’est-ce que le droit ?» met le juriste dans
l’embarras. Cause = ambiguïté constitutive de la notion de droit. Deux sens =
a) droit positif (« posé », institué) = ensemble des lois telles
qu’elles sont instituées dans une communauté à une époque précise = le droit de
fait b) droit en tant que norme supérieure à la loi (=ce qui est) dictant ce
qui doit-être. La question se modalise ainsi en deux types de
questions : a) « Que sont les lois ici et maintenant? » =
domaine du juriste, réponse empirique (empeiria=expérience) b)
« Quels sont les critères/juger de la justice ou de l’injustice des lois
instituées? » = question philosophique. a) Droit positif : m’informe
de la légalité et illégalité des actes. b) Second sens :
m’informe de la légitimité ou de l’illégitimité de la loi. Or la
seconde question est redoutable (Kant) : juger un acte comme le fait le
juge (juriste) suppose d’apprécier sa +/- grande conformité/loi (= le critère),
la difficulté étant d’appliquer la généralité de la loi / particularité de
l’acte (activité de jugement = peser : la justice positive et le symbole
de la balance) ; mais à partir de quel critère va-t-on juger de la
justice de la loi? Pour juger la loi, il faut un critère extérieur et
supérieur à la loi = la recherche de Rousseau.
Enjeu = pouvoir de contestation et
de construction. Contestation = pouvoir de contester telle loi, tel système
juridique, tel régime politique. De là ces questions subversives : dois-je
désobéir à une loi injuste ? La violence (=illégale) peut-elle être légitime?
Construction : construire l’idée d’un système politico-juridique juste
ayant valeur de norme pour la réalité (ce que nous devons faire).
Mais contestation et construction supposent un
savoir = ce qu’est le droit comme norme transcendante (vocab :
transcendant/immanent = ce qui est au-dessus, au-delà de, sur un autre plan,
supérieur / immanent = sur le plan des faits, de ce qui est). Danger :
hors d’un tel savoir, l’arbitraire de purs rapports de force ne peut-il pas
s’imposer sous le masque de la justice – contre la loi ou avec la loi ? =
problème de la légitimité tant des révoltes et révolutions que des régimes
politiques. Problème : peut-on par la seule raison découvrir une
norme transcendante (Idée de justice) permettant de juger les lois existantes ?
Le contrat social se prétend une telle réponse, déduction rationnelle
de l’idée de Justice.
2) « Principes du droit politique ».
a) « droit politique ». Politique = organisation, par des lois,
de la cité (polis)= notre être-ensemble. Droit politique =
l’organisation de droit = juste = tel qu’elle doit être - de notre
être-ensemble. Cette organisation juste repose sur des principes. b) Principes
= fondement = premier, fondamental : le sol sur lequel construire. Comment
trouver un tel sol premier ? Par la raison. Qu’est-ce que la raison ?
(rappel du cours, La raison, nature et exigence – à relire ici).
L’homme est un être qui a deux dimensions :
empirique et rationnelle. Empirique (empeiria :
expérience) : dimension du fait, de l’histoire, du donné : il se
trouve que l’homme, et chaque homme, a un corps, des désirs, une culture
particulière… qui sont le produit aveugle et involontaire d’une histoire
de fait. Mais, contrairement à la chose ou l’animal, l’homme n’est pas qu’un
être empirique c’est un être qui a une dimension rationnelle : il
parle. Or parler ce n’est pas simplement proférer des sons qui sont autant
de cris, manifester (exprimer) sa simple situation de fait et l’ordre empirique
de nos désirs (langage animal), c’est 1) viser une sphère commune 2) où
l’ordre de fait est dépassé, interrogé et intimé de se justifier.
Explicitation :
2) l’homme n’est pas seulement un être de fait, il est
celui qui interroge le fait. Il ne fait pas que constater et se
constater – il demande la raison de ce qu’il constate. Deux questions de
la raison humaine cherchant à rendre raison du fait : «qu’est-ce
que c’est ?» et «pourquoi ?». Or par la raison, l’homme dépasse
l’ordre du fait, de l’empirique. Ex : démonstration mathématique. «La
somme des angles d’un triangle est égale à deux droits» (180°) : on
peut le constater sur tel ou tel triangle, en mesurant. On voit mais on ne sait
pas pourquoi : le fait apparaît contingent (il aurait pu être
autrement). Mais un tel constat ne satisfait pas notre raison : nous
voulons savoir pourquoi = pourquoi il en est nécessairement ainsi. De là
la démonstration : en substituant au triangle tracé de pures relations
spatiales (pures de matière sensible : épaisseur, couleur, grandeur
particulières), nous comprenons par construction rationnelle pourquoi la somme
des angles est nécessairement égale à deux droits. Or un tel ordre rationnel
nécessaire accessible à travers les questions de notre raison est un ordre
transcendant qui dépasse l’ordre immanent du fait. Nous savons
maintenant que tout triangle empirique, tout triangle constaté dans l’infinité
du temps et de l’espace (totalité et infinité dont nous n’aurons jamais
l’expérience en tant qu’être empirique) aura nécessairement les
propriétés démontrées. La raison nous fait accéder à une dimension non
empirique qui ne dépend plus du fait (toujours particulier = ceci, ici,
maintenant) mais qui est intemporelle (la démonstration = valable
éternellement) et universelle (vaut pour tout triangle et – on va le voir –
pour tous).
1) Universalité de la raison : je la suppose en
tous (Texte de Malebranche). Je suppose que chacun est susceptible de
comprendre mes raisons, ce qui est supposé dans toute prise de parole = un
horizon commun de compréhension : en tant qu’être de raison,
nous sommes les mêmes (texte de Marc-Aurèle). Alors qu’en tant qu’êtres
empiriques nous sommes différents et séparés les uns des autres - par
notre vie, nos désirs, notre corps, nos forces, notre histoire, notre culture…
= autant d’hommes et d’humanités différentes, produits de fait d’une certaine
histoire, de la contingence du fait – en tant qu’êtres raisonnables nous
sommes fondamentalement unis participant à une même raison que nous
supposons en tous dès que nous nous mettons à parler.
Or une vue sur l’histoire humaine, loin de nous faire
saisir une telle union, montre conflits, violence, rapports de force. L’espoir
de la philosophie – et ici de la philosophie politique – est de prendre
appui sur la raison humaine pour tenter de substituer à l’arbitraire et à
la contingence des purs rapports de force qui font la trame de l’histoire, un
ordre raisonnable, nécessaire et approuvé par tous, porté par la capacité de
l’homme à parler. De là la quête des principes par Rousseau = les
fondements premiers que toute raison doit reconnaître, à partir desquels
construire un ordre politique non plus violent et arbitraire mais légitime car
reconnu par chacun en sa propre raison. Le principe = ce qui met fin à la
chaîne des questions : «pourquoi ?» - questions que je pose à
l’arbitraire contingent du fait, par quoi je le refuse et m’y oppose. Ce que
l’on espère ainsi trouver = «des
lois dont le caractère peut-être reconnu a priori [= sens
kantien : avant, en dehors et au-dessus de toute expérience / s’oppose à a
posteriori : après en avoir fait l’expérience = contingence] par
la raison. Elles constituent des principes immuables sur lesquels doit être
fondée toute législation positive » (Kant, Doctrine du droit).
Lien à la liberté : une telle quête
coïncide avec celle de notre liberté. La dignité de l’homme c’est, en
effet, d’être un être libre. Etre libre c’est être son propre maître, soit
diriger consciemment (ce qui ne se peut sans la lumière de la raison) sa
vie en se donnant à soi-même les lois (rationnelles) de sa conduite
(autonomie : auto (soi-même) / nomos = les lois). C’est donc
refuser que notre vie soit guidée par des lois que nous n’avons pas choisies
(hétéronomie : hétéro = autre) = par un maître (l’opinion
– ce qui se dit, ce qui se fait ; tel ou tel individu…). Politiquement,
le problème de l’autonomie = comment vivre ensemble de telle manière que nous
choisissions lucidement et en conscience les lois de notre organisation et de
notre devenir commun? S’oppose à l’hétéronomie d’un ordre social guidé et
structuré par des lois que nous n’avons pas choisies (lois du capitalisme,
tyrannie politique…). La quête des principes du droit politique= de ces lois
fondamentales / structurer et diriger librement (puisque chacun les
reconnaît sans contrainte par sa propre raison) l’ordre de notre
être-ensemble.
Préambule du livre I
a) 1er §. Quête de Rousseau =
ensemble de règles et d’institutions légitimes et efficaces (« sûres »)
/ réguler l’être-ensemble des hommes. Nature de ces règles / réalité?
Difficulté = à la fois transcendantes au réel (nécessité pour juger la
réalité d’un lieu extérieur à) et lien/réel = possibilité d’être
appliquées. « Prendre les hommes tels qu’ils sont et les lois telles
qu’elles peuvent être » : ancrage dans le réel = dans la nature
des hommes tels qu’ils sont (et ici comme êtres égoïstes et parlant).
Sinon = discours déconnecté et irréalisable. Critique implicite des
« utopies » (absence de « lieu » = de réalisation possible)
et refus de l’ « angélisme » : il ne s’agit pas – chose
impossible – de changer la nature humaine (de faire de l’homme un ange). Défaut
de telles utopies : leur impossibilité sert de justification à
l’arbitraire de l’état de fait politique (cf. « ce serait beau, mais vous
êtes un rêveur…»). Il faut donc que la justice politique soit possible :
ancrage dans l’intérêt humain (lier « justice et utilité » :
trouver en l’homme un moteur tel qu’il puisse désirer une telle
justice : y trouver son intérêt – que ce soit s’intéresser à, ou
s’intéresser pour). Deux risques : une justice déconnectée de
l’intérêt humain = impuissante. Une utilité déconnectée de la justice =
injuste. Pb = lien théorique / pratique.
b) 2ème §. Répond à une
objection : qui est Rousseau (et qui sommes-nous) pour se permettre de
réfléchir sur une norme permettant de juger toute réalité politique?
N’est-ce pas présomptueux ? Le droit, les lois, la justice n’est-ce pas le
domaine propre et obscur des dirigeants, des rois, des princes ? Comment un
individu, seul et sans titre, soumis aux lois de l’Etat, duquel il dépend et dont
il n’est qu’une partie, peut-il les juger ? Rousseau suppose ainsi deux
choses : 1) que la politique n’est pas un domaine à part appartenant aux
dirigeants mais notre propre affaire 2) que la partie peut juger le tout,
l’individu la société. 1) Le premier point = l’objet du Contrat social (cf.
plus bas, analyse du 3ème §). 2) Que suppose le second ? Qu’alors
même que nous sommes les produits d’une culture donnée, d’une éducation sans
laquelle nous ne serions rien, qui nous donne forme humaine et cette forme-ci
(cf. textes d’Aristote et Malson) – nous pouvons – et devons – à tout instant nous
arracher de ces déterminations pour poser aux lois qui nous font la
question de leur légitimité, c'est-à-dire les mettre en question. Autrement
dit : l’individu est transcendant à la société (il ne s’y réduit
pas) et cette transcendance est valeur. Les droits de l’homme au fronton de la
Constitution signifient : les lois doivent être faites pour l’individu
– les individus - en vue de leur seule liberté – et non pour la Nation,
l’Etat, la Société ou une quelconque entité collective extérieure et
supérieure aux individus. Deux risques - souvent dénoncés - d’une telle
position : l’artificialisme et l’individualisme. 1) Artificialisme :
substituer des lois fondées sur la seule volonté humaine (artificielles=crées
par l’art humain) à la lente et impersonnelle formation des us et coutumes
n’est-ce pas risquer de renverser l’ordre irréductible (au choix, à l’individu)
de la société par lequel seul les hommes peuvent vivre ensemble ? Critiques
réactionnaires de Bonald et De Maistre contre la Révolution française et la
Terreur engendrée selon eux par cette folie de vouloir refaire artificiellement
une société que l’impersonnalité des siècles avaient faite.
Question : dans quelle mesure pouvons-nous légiférer sur la société qui
nous fait, substituer notre volonté à la lente maturation de l’histoire ?
Reprise de ces critiques aujourd’hui par Hayek défenseur du capitalisme
et de la limitation de l’intervention (= artificielle) : l’ordre marchand
serait dans son extraordinaire complexité (réseaux sans centre) bien plus
efficace que - et surtout, irréductible à - toute intervention
volontaire : une autorégulation. Actualité de cette question :
discours du parti socialiste comme des gens de droite – fins des grands
projets : « on ne peut – presque - rien faire »,
l’ordre mondial capitaliste est trop complexe, des effets pervers imprévus
suivent immédiatement de pratiques interventionnistes – il faut donc s’adapter,
tout volonté artificielle de refaire le monde étant vouée à l’échec : realpolitik
= gestion de l’état de fait et des rapports de pouvoir existant = oubli de
la justice. Transformation en question : pouvons-nous donc agir, de
l’extérieur, sur la complexité des réseaux socio-historiques sans dérégler
un ordre supposé autorégulé ?
Individualisme : situer l’individu au centre de la loi comme
sa source, son but et le juge de sa légitimité, cela ne risque t’il pas de lui
faire oublier ce qu’il doit à ceux qui l’entourent et le précèdent.
L’aveuglement de l’individualisme, cette tendance de l’homme (ici, contemporain)
à se refermer sur soi-même (dépolitisation) et à se considérer comme un centre
a-social (« sentiment réfléchi et paisible qui dispose chaque citoyen à
s’isoler de la masse de ses semblables et à se retirer à l’écart avec sa
famille et ses amis (…) [les hommes de notre temps] s’habituent à se
considérer toujours isolément. Ils se figurent volontiers que leur destinée est
toute entière entre leurs mains (…). [Ils] ne doivent rien à personne, ils
n’attendent rien de personne » (Tocqueville)) = oubli de ce par quoi il est : la
culture, l’éducation, les lois (Cf. Platon, Criton). Question ici
au centre du Contrat Social : comment penser un devoir citoyen dans le
cadre d’un droit fondé sur la liberté? = éminemment actuel : comment
faire pour que, volontairement et sans contraintes, nous nous intéressions
au bien commun? (cf. l’école et les tentatives de remettre la « citoyenneté »
au goût du jour, les exhortations – inefficaces - des hommes politiques à ce
que nous votions… / constat aujourd’hui d’une privatisation de la
société et d’un désinvestissement de la sphère publique).
Dernier
point justifiant la position de Rousseau qui, simple individu, entend
traiter des fondements de la politique : il est le mieux placé pour le
faire : un politique agit et ne pense pas, il n’en n’a pas le temps. Les
nécessités de l’action : être sur le « qui-vive »,
répondre dans l’instant à des situations nouvelles, décider dans l’urgence =
une intelligence pratique mais qui n’a pas le temps de penser aux principes de
son action. Au contraire le philosophe = n’agit pas : contemplation
(théorie) / action (pratique) ; on ne pense pas dans l’urgence : pour
penser - une vie contemplative, libérée des impératifs de l’action. De là une
dramatique coupure entre le philosophe et le politique : il faut que
l’Idée de justice inspire la pratique, donc que le politique écoute le
philosophe (cf. Robespierre qui brandit le Contrat social) sinon la possibilité
d’un ordre juridique juste s’évanouit. De là cette question : comment
assurer une telle position de la pensée comme guide de l’action dans le champs
politique? Comment faire pour que la politique ne soit pas le règne du plus
fort (démocratie : le plus fort = le plus grand nombre) et de l’opinion
(sans fondement, irrationnelle) mais vise effectivement par l’exercice de la
pensée le bien commun (justice) ?
c) 3ème §. Si ensuite Rousseau parle
de politique c’est qu’il en a le devoir et le droit. Le droit : là encore
deux sens. Le droit : la loi de fait le lui autorisait. Rousseau =
citoyen de Genève (République libre depuis le XVIème siècle,
citoyens libres et égaux – en réalité le pouvoir effectif appartenait au
« Petit-conseil » dont les membres se recrutaient toujours dans les
mêmes familles (oligarchie) dont celle de Rousseau). En tant que citoyen, droit
effectif de participer à l’élaboration de la loi et donc de réfléchir dessus.
Mais même si a) il n’appartenait pas à de telles familles b) il est, par après,
exclu de la citoyenneté (à Genève, et partout en Europe, le Contrat social
– ouvrage séditieux et dangereux - sera brûlé en place publique), il se
considère membre de droit de la République (cf. chp. V : la
République = société où le pouvoir législatif appartient à un peuple
c'est-à-dire à une association fondée sur la volonté de vivre ensemble) :
Genève est en droit (ce qu’elle doit-être) une République et Rousseau,
membre de droit, même si en fait – selon les lois existantes – ce n’est plus ou
pas le cas Rousseau présuppose ici ce
qu’il va montrer : la politique est l’affaire de tout homme en tant que
citoyen c'est-à-dire membre de droit de la République, partie du
souverain (celui qui exerce le pouvoir législatif = qui décide les lois) – ce
pourquoi au sein d’une tyrannie je peux en appeler au droit contre la force.
Note sur le corollaire d’un tel droit : le devoir de penser :
avoir le droit de vote impose une responsabilité : si je décide de
la loi je dois réfléchir à la politique et faire de la philosophie
politique : comment voter si on ne s’interroge pas sur ce qu’est une loi juste
? De là ce problème afférent – pour y réfléchir encore faut-il avoir le
temps et les capacités. D’où l’enjeu d’une éducation et d’une libération du
temps /ordre économique afin de rendre possible l’exercice effectif de
la citoyenneté.
Chapitre premier : « Sujet de ce premier
livre »
a) 1er §. «L’homme est né
libre » : affirmation de la liberté naturelle de l’homme. La
liberté de l’homme c’est ici sa liberté / ses instincts qui le distingue de
l’animal : l’homme seul peut se guider, il a une volonté libre (cf.
texte de Kant sur les Lumières) : il y a chez tout individu
naissant un potentiel, une puissance qui excède tout enfermement, toute
définition (ex. « tu es un esclave » : toujours
possibilité d’échapper à un tel enfermement par la révolte). Et pourtant «partout,
il est dans les fers » c'est-à-dire esclave, soumis à la domination
d’un maître (XVIIIème=despotisme, absolutisme). Constat :
disjonction fondamentale entre ce qu’est l’homme essentiellement (libre) et ce
que font de lui la société et l’histoire (asservissement). Le discours sur
l’origine de l’inégalité (1755) tente d’éclairer les causes d’un tel
passage en partant de la fiction d’un état de nature (hommes en
l’absence de toute société organisée par des lois) jusqu’à la formation des
formes sociales inégalitaires : en rentrant en société les hommes, posés
comme premièrement indépendants et quasi-indifférents (modèle
quasi-animal : absence d’amour-propre (Rousseau) = de conscience et
d’amour de son image / autres) vont se transformer, devenir dépendants les uns
des autres et passionnés (passion = état de soumission affective et mentale de
l’homme à un objet de sa propre pensée. Ex : l’avare / l’or ;
l’ambitieux / image de sa réussite…). C’est la passion qui explique (condition
de possibilité) la séparation homme/esclave : ce que veut le maître c’est
le pouvoir, c'est-à-dire la représentation (l’image) de sa propre
puissance. C’est pourquoi Rousseau affirme que le maître est encore plus serf
que les esclaves. On pourrait croire, en effet, que le maître, parce que sans
dépendance apparente, est le modèle même de la liberté. Mais contrairement à
l’homme naturel, indépendant, n’ayant nul besoin des autres, il a besoin tant
des biens que lui procurent ses esclaves (ses besoins ne sont plus ceux de l’animal,
ils sont socialisés) que du regard des autres (il jouit de la
représentation de sa puissance qu’il lit dans le regard de ceux qu’il
domine) : il est esclave de sa passion de pouvoir – et, contrairement à
l’esclave, inconscient de son propre esclavage. Cependant, la question
empirique – historique du passage d’un homme supposé naturellement libre à
l’état universellement répandu de domination et de servitude est évacuée ici
par Rousseau (« je l’ignore ») : sa démarche n’est pas
ici historique, elle est a priori (Kant) (= indépendante de l’expérience
/ a posteriori = qui vient de l’expérience). Ce qui l’intéresse ici ce
ne sont pas les causes de la servitude et de la domination (susceptibles d’une
analyse empirique) mais la question – atemporelle, anhistorique – de la légitimité
ou de l’illégitimité d’un tel état de fait. Disjonction fondamentale entre
l’empirique et l’a priori : même si jamais l’Idée de justice ne
s’incarnait dans des situations réelles, même si l’histoire était vouée à être
rapports de force, cela n’enlèverait rien à la valeur de l’Idée. Néanmoins, le
problème de Rousseau est d’opérer un tel passage du droit au fait : le
constat d’une disjonction entre ce que l’homme est essentiellement (être
libre) et sa condition politique historique va engendrer ce
problème fondamental : comment faire pour que le fait - arbitraire dans
son état historique actuel de servitude - puisse s’aligner sur le droit = sur
ce qui doit-être / comment faire pour que l’Idée de justice ne reste pas
désincarnée ? Il ne s’agira nullement de revenir à l’état quasi-animal
de nature (indépendance, vie privée : absence de communauté), mais en
prenant l’homme comme il est (socialisé) et peut-être, de penser les conditions
politiques de sa liberté.
b) 2ème §. Exposition dogmatique
(sans démonstration) de la théorie de Rousseau et ébauche du plan du livre I.
Premier point : du point de vue de la force (point de vue du fait, de
l’histoire comme dynamique de rapports de pouvoir), il n’est question que de
rapports de force et pas de droit. Irréductibilité du
droit et de la force et opposition à des théories
qui refusent au peuple le droit de désobéir aux rapports de force en
présence : objet des chapitre II, III et IV. Faut-il donc renoncer à
l’ordre politique (soumission des individus à des lois) ? cf.
anarchisme et Q : « une société sans lois est-elle possible »
? Rousseau : « ordre social = droit sacré » :
sous-entendu : les lois = nécessaires malgré tout et l’absence de lois =
pire (cf. + loin : guerre de tous contre tous). Mais cela n’entraîne pas
l’équivalence de toute loi : quelles lois? Des lois légitimes = de
droit. Quel est donc le fondement du droit? Ce n’est pas la nature (l’ordre
du fait et de la force : chapitre III), mais la convention = institutions
produites par des volontés libres. Le contrat social est une telle
convention fondatrice du pacte politique (chapitres V à IX).

Pathologie de l’éducation, chp. II
Il n’y a que deux choses importantes dans la
vie, Marcello : toujours aimer sa maman ;
et ne jamais croire les bobards des
psychanalystes.
Plan du livre I
I) Chapitre II – IV : examen des fausses
légitimités qui dissimulent les plus abjects abus de pouvoir.
A) Fausses légitimités fondées sur la nature
. Chapitre
II : la théorie paternaliste
. Chapitre III : le droit du plus
fort
B) Fausses
légitimités fondées sur la convention
. Chapitre IV : l’esclavage.
II) Intermédiaire : Chapitre V : le
problème du fondement du droit que toutes ces théories n’ont pas examiné.
III) Chapitres VI – IX : la théorie
rousseauiste de la légitimité.
. Chapitre VI : le pacte social,
définition du fondement de la légitimité.
. Chapitre VII – IX : explication et
implications.
I) Examen des fausses légitimités dissimulant les
plus abjects abus de pouvoir
A) Les fausses légitimités fondées sur la nature
Chapitre II : Critique de la théorie
paternaliste
Théorie paternaliste : de même que le père est le
maître naturel de ses enfants, de même le roi vis-à-vis de son peuple, le
maître vis-à-vis des esclaves. Intérêt : s’ancrer dans un modèle
naturel et donc incontestable (la nature, formidable alibi du
pouvoir : qui irait contre la nature ? Nature = être et valeur,
essence et norme : cf. un fils peut bien tuer son père, mais ce n’est –
nous semble t’il – pas naturel (contre-nature) = contraire à ce qu’est un fils
essentiellement et donc à ce qu’il doit-être). De même que les enfants ont besoin
de leur père (nécessité naturelle : indiscutable, il ne peut pas en être
autrement – la question (au nom de quoi ?) de l’indépendance ne se
pose donc pas, de même que celle d’un enfant), le peuple a besoin de son
maître. Modèle naturel : le lien du sang (s’impose, ne se discute pas; le
«sang bleu» des aristocrates = supérieur et indiscutable : le sang des
maîtres) ; Staline = « le petit père du peuple » ;
ambiguïté des discours sur la nation et le droit du sang, la «mère
patrie», «les enfants de la patrie».
Rousseau va montrer le sophisme (faute logique ayant
pour ambition de tromper) inhérent à une telle position. La famille est bien,
en effet, une société naturelle, «la plus ancienne» et la plus simple.
Une société : association (societas) d’êtres vivant ensemble.
Naturelle : tout enfant naît d’un père et d’une mère et est sous leur
dépendance nécessaire. L’enfant a besoin de ses parents : il ne peut
survivre sans, ils subviennent à ses besoins vitaux. Le père a des sentiments
naturels pour ses enfants et l’enfant pour son père. Mais, note Rousseau, la
famille est la seule société naturelle. Pourquoi? Cela tient aux limites
même de la famille comme association naturelle : le lien nécessaire du
père à l’enfant ne vaut que tant que l’enfant est physiologiquement dépendant
du père. Une fois que l’enfant devient capable de subvenir à ses besoins, la
domination du père n’est plus justifiable par l’incapacité naturelle de
l’enfant à se gouverner soi-même. De là – point fondamental – le lien
parents/enfant devient non plus nécessaire (il ne peut en être autrement) mais conventionnel :
il repose entièrement sur la volonté de rester ensemble
(choix=contingence, ce qui peut être autrement). Convention = accord entre
plusieurs parties = fondée sur la volonté des contractants. S’oppose à la
nature = nécessité, qui s’impose, ne se discute pas.
Quelle est donc l’erreur des théories paternalistes?
Considérer les hommes comme d’éternels enfants et oublier que le lien familial
entre adultes est un lien conventionnel et donc volontaire. De plus le but d’un
père : faire en sorte que son enfant devienne majeur (éducation) = capable
de se diriger soi-même. Si le père s’impose c’est pour ne plus avoir à
s’imposer. Au contraire une éducation infantilisante (cf. texte de Kant sur les
Lumières) = que l’homme reste mineur (pathologie de l’éducation). Or le
but d’un pouvoir politique paternaliste n’est pas l’autonomie (capacité de se
donner ses propres lois) future de ses «enfants » mais le maintien dans la
minorité. A ceci s’ajoute le fait que le sentiment d’amour du père pour
l’enfant – le père agit pour l’enfant et y trouve sa joie – est chez les
puissants simple désir de pouvoir et de commandement sans que l’intérêt du
peuple y prenne une quelconque part. La comparaison père/enfant = roi/peuple ne
tient donc pas.
La suite du texte est une critique des théoriciens
politiques antérieurs. Leur principale erreur : établir le droit par le
fait. En ceci = les gardiens de l’ordre établi, de l’arbitraire du pouvoir
de fait : font, par leurs écrits, de l’usurpation un droit, de la même
manière que celui qui fait la loi la décrète juste. Mais il y a sophisme
(erreur logique se faisant passer pour valide) : du fait au droit il
n’y a pas de passage légitime. Grotius, Du droit de la guerre et de la
paix (1625) : sophisme = a) de fait, le pouvoir n’est pas en
faveur des gouvernés, ainsi de l’esclavage qui est en faveur des maîtres,
maîtres qui inscrivent dans la loi (qu’ils font eux-mêmes) la légalité de leur
domination. b) donc, de droit le pouvoir n’a pas être en faveur des
gouvernés = confusion de ce qui est (le fait) / ce qui doit-être (le droit).
Ainsi Grotius partant de la division de fait entre chef et gouvernés,
produit de l’histoire arbitraire de simples rapports de force, en fait une
division de droit prenant l’opposition chef/gouvernés comme légitime et
naturelle. C’est alors, note Rousseau, légitimer faussement le paternalisme. Le
modèle qu’on retrouve est, encore une fois, le modèle naturel :
l’humanité est un troupeau, une « bête », un pur corps animal que
dirige le berger, qui, nature supérieure, sait (le corps qui
obéit/l’esprit qui commande). Mais rappelle ironiquement Rousseau : le
berger ne s’occupe du bien de son troupeau que pour finalement le dévorer.
Ainsi de Caligula empereur romain despotique et sanguinaire. De même, critique
Rousseau, Aristote : il prenait la division entre hommes libres et
esclaves comme un fait de nature et donc de droit (légitime). Il avait raison
en ceci que cette division est bien un fait : il est vrai qu’il y a
des esclaves et qu’il y a des êtres qui sont devenus en leur corps et esprit
esclaves tant et si bien qu’ils ne sentent plus leurs chaînes (D’où le
problème de l’éducation : mais qui éduquera? Cercle à percevoir –
idem/texte de Kant sur Les Lumières – la liberté individuelle suppose la
liberté politique (choix d’une éducation libre) qui elle-même suppose la
liberté des individus qui font la loi). Mais Aristote confond la cause et
l’effet : s’ils sont esclaves c’est parce qu’ils le sont devenus et non en
vertu du fait qu’ils l’étaient par nature. Passer du fait au droit c’est
légitimer l’arbitraire d’une situation historique naissant de la contingence de
simples rapports de force en relation de droit (juste et légitime). Dernier
point, enfin, « le roi Adam » : Adam est le père des
hommes et Dieu lui donne «tout pouvoir sur la Terre» (Genèse). Or le roi est
roi par lien du sang (le sang royal) et droit d’ainesse. Il est roi de «droit
divin» de par sa filiation avec le premier homme créé par Dieu : de là,
parce que son pouvoir est ancré en nature (en son corps même, comme
corps sacré, corps lumineux et faiseur de miracles, cf. roi Soleil, rois
guérisseurs…), son caractère incontestable. Et pourtant qui sont les rois de
l’histoire sinon des meurtriers naissant d’obscures familles parant de beaux
discours et du sceau de justice le sang de leur méfait ? La nature (et le
sacré, qui en est une variation) est l’alibi du pouvoir : ce n’est donc pas
sur une quelconque nature que l’on pourra fonder le droit.
Chapitre III : Du droit du plus fort
C’est pourtant à une telle fondation du droit sur la
nature que prétend à son tour l’idée de «droit du plus fort». Un tel
principe est comme la vérité de la théorie paternaliste : cette dernière
consistait à cacher derrière l’idée de nature l’arbitraire de purs rapports de
force, ici pris explicitement comme principe même du droit une fois évacuées
les références fallacieuses et idéologiques à la nature comme norme. Si j’ai le
droit de dominer ce n’est donc plus parce qu’un quelconque dieu ou nature m’y
fonde mais parce que je suis le plus fort ! Mais un tel principe est
contradictoire : c’est, encore une fois, un sophisme. Pourquoi? La force =
puissance physique = ce qui arrête ou produit un mouvement (mécanique).
En termes politiques, la loi du plus fort = une loi de la nature :
le plus fort l’emporte sur le plus faible. Or «céder à la force est un acte
de nécessité » : je ne peux pas faire autrement =
contraint. Ce n’est pas un acte de volonté : est volontaire ce que
je fais de mon plein gré, sans contrainte. «C’est tout au plus un acte de
prudence» : être prudent = calcul d’intérêt, sur les moyens
(stratégie) de me soumettre à une force nécessaire. Exemple du brigand. «La
bourse ou la vie » : je n’ai pas le choix, si je choisis la bourse,
je garde la vie et perds la bourse; si je choisis la vie, je perds la vie
et la bourse. Prudence = compréhension de la nécessité, de ce sur quoi je n’ai
pas le choix et action en conséquence.
Aussi céder à la force ne saurait être un devoir.
Ici il ne s’agit pas du devoir comme reconnaissance de la nécessité : cf.
« je dois manger » (force intérieure = pulsions) mais du devoir au
sens moral. Ce qu’il faut comprendre c’est que le devoir au sens moral
est un acte de volonté (et non soumission à la nécessité = à la force).
Ex : je suis témoin d’une noyade. Naturellement, selon la force
de mes pulsions, je suis porté à me
détourner et à ne pas sauter (l’eau est froide, c’est très haut…). Pour sauter,
il faut le vouloir c'est-à-dire maîtriser ses pulsions (le mouvement
naturel). Kant : un acte n’a de valeur morale qu’à partir du moment où il
s’oppose à notre nature. Je dois = je
veux = je veux contre mes inclinations naturelles. Politiquement :
un pouvoir politique a le droit de s’imposer, si en tant qu’être de
raison, j’éprouve le devoir de lui obéir = obéir volontairement
(librement) à la loi parce que même si je suis lésé par la loi (je préférerais
payer moins d’impôts) je considère qu’elle est juste. Ce qui est ici lésé c’est
ma nature (ma pulsion possessive qui tend à me poser centre de ce monde), ce
qui acquiesce et obéit librement à la loi c’est ma volonté éclairée par la
raison (je considère que c’est raisonnable et je contrains, par volonté, ma
nature possessive). Dualité de l’homme : être égoïste de pulsion = mon
être naturel (animal) / raison et volonté (liberté par rapport à ma nature). Le
devoir (sentiment d’obligation) c’est ici la manifestation de ma volonté
raisonnable libre vis-à-vis de mes pulsions contre ma nature animale
pulsionnelle (Kant). Alors que la contrainte s’impose (force, nature),
je m’impose (à ma nature) l’obligation morale.
Vouloir fonder le droit sur la force c’est donc tenter
de me forcer à vouloir et à respecter la loi. Mais le respect et l’obéissance
volontaire ne s’imposent pas par la force : le bandit sur la route peut
bien me forcer à lui donner ma bourse, il ne peut faire en sorte que j’approuve
de surcroît. De là le «galimatias inexplicable» de l’idée d’un « droit
du plus fort ». Si c’est le plus fort qui est de droit alors le droit
change avec les rapports de force et, dès lors, pourquoi parler encore de
droit, de justice et de devoir ? Pourquoi pas simplement la force toute nue ?
Parce que, paradoxalement, la force nue est
faible : «le plus fort n’est jamais assez fort pour être toujours le maître,
s’il ne transforme sa force en droit et l’obéissance en devoir ». La
force, en effet, est par essence relative. On n’est jamais fort absolument,
mais toujours relativement à d’autres forces. De là la fragilité de la force
qui est, par essence, provisoire : un coup d’Etat, un complot, une révolte
ont tôt fait de renverser un pouvoir qui ne tient que par la force. Fragilité
des dictatures : le tyran doit dormir, vieillit et ni l’espace ni le temps
ne sont jamais suffisamment quadrillés pour empêcher la possibilité d’un
retournement des rapports de force. Au contraire, un pouvoir légitime n’est-il
pas, par essence, durable? Cf. stabilité relative des régimes
républicains / dictatures : le pouvoir auquel on adhère ne se
maintient-il pas par la force de cette adhésion (et de là, moins de répressions
/ omniprésence de la force militaire dans les régimes à tendance tyrannique) ?
A la limite, un pouvoir totalement légitime : durée infinie ? A contrario
les grèves, manifestations, les contestations… = marques de l’absence de
légitimité d’une partie du pouvoir (signe de bribes de tyrannie =
domination d’une volonté particulière/intérêt commun ou bien – propos des pouvoirs en place – irrationalité de
tels mouvements). Si tyrannie = totalité du pouvoir et de son ancrage
institutionnel : Révolution cf. 1789. On comprend de là la volonté des
forts de masquer leur force derrière l’apparence de justice = gage de
durabilité. Cf. texte de Pascal : « ne pouvant faire que ce qui
est juste fût fort, on a fait que ce qui est fort fût juste »
[nb : opposition à la thèse défendue ici : Pascal pense la justice
impuissante – et, de fait, une justice sans garantie de la force (police,
armée) n’est-elle pas impuissante? Qui respectera
la loi, serait-elle juste, s’il n’y a pas menace ? Des
êtres raisonnables assurément puisque reconnaissant sa légitimité et se
contraignant par devoir et sans menace à lui obéir. Pourquoi alors la force?
Parce que les hommes ne sont pas tous et entièrement des êtres raisonnables,
parce que l’homme est scindé entre une part raisonnable et une part égoïste
pulsionnelle. De là la nécessité du bâton (la police et les peines) au service
même du droit. Si donc la force ne fait pas droit, elle peut, au service du
droit, être force légitime].
La transmutation de la force en justice étant
impossible, c’est sur le plan irréel mais cependant efficace de la
représentation, c'est-à-dire des images et des mots que l’on a transformé la
force en droit. Le tyran le sait bien : il faut pour durer masquer la
force (cf. Le prince de Machiavel). Alors le roi n’est pas (en
représentation) ce qu’il est réellement : ce tyran meurtrier issu d’une
obscure lignée qui se perd dans l’animalité mais Louis XIV, nom propre qui
éclaire le monde, issu d’Adam, de droit divin, roi lumineux doté d’attributs
fantastiques, bras même de la Justice… C’est à cette vaste mise en scène
(pouvoir et mise en scène comme représentation fantasmatique de l’unité
du peuple : cf. rôle de la télévision et des médias… d’où
l’enjeu de médias libres) qui a pour but de masquer l’arbitraire de la
force sous le vêtement usurpé du droit que participent les théories
paternalistes dénoncées par Rousseau dans le chapitre II : il s’agit là
encore, par l’apparence des mots – rhétorique du pouvoir - de déguiser l’arbitraire
et l’absence du droit par le beau mot de Justice.
Dès lors, écrit Rousseau, «ma question primitive
revient toujours » : quel est le fondement véritable du droit?
Nous savons, cependant que ce n’est ni la nature, ni la
force (dont nous connaissons maintenant l’identité à cette première :
nature = contingente et arbitraire nécessité = rapports de force) qui peuvent
être un tel fondement. Il n’y a pas de droit, avons-nous reconnu, hors sa
reconnaissance par une volonté libre.
B) Fausse légitimité fondée sur la convention

Le
peuple aime les tyrans cruels et incapables. Or vous êtes un tyran cruel et
incapable.
Malheureusement, le peuple ne vous perçoit
pas de cette façon : il vous perçoit à 94, 7 %
comme
un « gros patapouf sympa»
Chapitre IV : De l’esclavage
Partie 1 : § 1 à 6 : l’abdication de la
liberté ne peut être l’objet d’une convention
Si le droit ne peut être fondé sur la nature, c’est sur
la convention = comme le fruit d’un accord entre les volontés que l’on doit
le fonder. Ne sera dit juste, ne sera de droit, que ce qui est le produit
d’un tel accord (consentement bilatéral). Mais quelles en sont les
conditions? Car c’est sur une telle convention, un tel accord passé
entre parties que certains théoriciens (Grotius) entendent justifier la
soumission du maître à l’esclave et du roi au peuple : s’il y a eu contrat
consenti par les deux parties, n’y a-t-il pas alors justice ? Rousseau va
démonter leur argumentation : il ne s’agit pas d’un véritable contrat.
Quelles sont les conditions d’un véritable contrat ? Un contrat est un échange
qui suppose l’intérêt réciproque et l’acquiescement volontaire à
ses conditions (cf. contrat d’assurance : échange volontaire fondé sur
l’intérêt réciproque d’une somme d’argent contre un service). Dire comme
Grotius que le peuple comme l’esclave échange sa liberté contre la nourriture
que lui fournit le maître ou le roi est absurde puisque c’est lui qui la
produite (de plus, de fait, les rois n’ont cure de la nourriture du peuple :
il s’agit de faire la guerre et donc de le ponctionner par les impôts) : il n’y
a donc pas d’échange (unilatéral et non réciproque), on ne peut donc vouloir
être esclave.
Reste un second type d’échange (§3) : le
peuple échangerait sa liberté contre la sécurité. Or cet échange là a toutes
les apparences de la rationalité : le peuple obtient bien quelque chose
qu’il n’avait pas auparavant et à quoi il a intérêt (la sécurité, l’ordre
public), le Roi – s’il doit respecter les termes du contrat – doit limiter sa
puissance en ne contrevenant pas à la sécurité du peuple. Pour la sécurité, l’ordre
public, il faut apparemment que l’on renonce à la liberté : le droit de
tout faire (privé) mais aussi à la liberté politique de contester la loi
(débats, liberté de la presse, manifs…) = facteur de désordre : il
faudrait donc échanger la liberté contre la sécurité pour ne pas vivre
dans l’insécurité du désordre (cf. absence de lois et de répressions = tous les
coups sont permis, vols, meurtres…= loi de la jungle. Ex : Western). De là
– et pour le bien du peuple - la matraque des CRS, « forces de l’ordre ».
Au nom de quoi, Rousseau dénonce t’il un tel contrat ? Premièrement : le
peuple est surveillé par les forces du roi mais qui surveillera le roi ? Le roi
est garant de l’ordre public mais cet ordre a tôt fait de devenir désordre à
son tour : guerres, répressions, vexations aléatoires = la réalité d’un
pouvoir royal illimité. Supposer le roi raisonnable et n’agir que pour l’ordre
public c’est oublier que le roi est un homme (et de plus un «puissant») rongé
par les passions qui, sans freins, peuvent se déployer. De là notamment la
guerre, fruit du désir de puissance : mais si le peuple a échangé sa
liberté contre la sécurité (tranquillité), cette sécurité-là ne lui est pas
donnée mais la guerre et l’arbitraire : contrat de dupe.
Supposons, cependant – et c’est le second point – qu’un
tel contrat soit respecté. Peut-on échanger sa liberté contre la tranquillité
(supposée acquise) et qu’est-ce qu’un tel échange pour l’homme ?
Rousseau : « qu’y gagnent-ils si cette tranquillité même est leur
misère ? » En quoi la tranquillité peut-elle être une misère ? C’est
que renoncer à la liberté c’est déchéance et perte de dignité. Rousseau par un
tour rhétorique fait appel à notre sentiment de dignité (par quoi nous
nous estimons nous-mêmes) : « on vit tranquille dans les cachots »
- nous ressentons en nous un mouvement de révolte, un refus du cachot, par quoi
nous voulons, serait-ce au détriment de la tranquillité, être libre : la
dignité de l’homme c’est, être de volonté, d’être maître de soi et non, comme
l’animal, le jouet de forces de la nature = être le sujet volontaire qui dirige
sa vie et non être dirigé. Rousseau réveille ici par ses mots une puissance
qu’il suppose (il parie donc sur elle). Qu’est-ce qu’en effet que choisir la «tranquillité»
? Tranquillité = tranquillitas en latin et ataraxie en grec.
Sénèque, De la tranquillité de l’âme : la tranquillité c’est l’absence
de trouble qu’il assimile au bonheur. Ce qui est cause de trouble c’est,
selon lui, le mouvement infini de notre désir qui sans cesse nous porte en
avant et nous déçoit toujours. De là, pour être heureux (adéquat à soi et à ses
visées), une renonciation par raison à cette force désirante : repli sur
soi, loin du monde et ses affaires, loin du corps désirant et de ses troubles.
Mais, ainsi qu’il fut souvent reproché aux stoïciens, une telle absence de
trouble ne s’apparente t’elle pas à la mort ? Et, en effet, l’ataraxie
collective, l’absence de « troubles politiques », l’absence de débats
et de conflits, ne s’apparente t’il pas à l’absence de vie ? Texte de
Montesquieu : « pour règle générale, toutes les fois qu'on verra
tout le monde tranquille dans un Etat qui se donne le nom de république, on
peut être assuré que la liberté n'y est pas (…) si l'on y
voit de l'union, ce ne sont pas des citoyens qui sont unis, mais des corps
morts ensevelis les uns auprès des autres ». On le verra plus
loin (chapitre V) c’est qu’il n’y a ici ni citoyen, ni peuple mais un
simple agrégat, un tas de membres morts reclus dans leur vie privée. Au
contraire, l’exercice effectif de la liberté politique, en ce que chaque
individu est l’irréductible dépositaire d’une raison qu’il ne peut exercer qu’à
la première personne dans l’ouverture conflictuelle (mais sans violence) aux
raisons d’autrui, ouverture rendue possible par l’existence d’un espace public
de dialogue (Assemblée, comités, presse…), n’est-il pas nécessairement tension,
conflit, mouvement et vie? Aussi, comme le dit Montesquieu, «comme des
dissonances, dans la musique, concourent à l'accord total. Il peut y avoir de
l'union dans un Etat où on ne croit voir que du trouble» non l’union figée
d’un corps mort mais l’union vivante de citoyens en dialogue – unis au moins
sur les règles qui substituent à la violence l’espace public du dialogue.
En opposant la Sparte figée à la bouillonnante Athènes, Thucydide (Histoire
de la guerre du Péloponnèse, 5ème siècle av.J.C) ne montrait-il
pas comment le chaos apparent de la ville d’Athènes, cette dynamique
fulgurante, source tant de tensions que de créations dans tous les domaines de
la vie, était intimement liée à cette liberté politique qu’elle accordait à ses
citoyens (participation effective à l’élaboration des lois, espaces multiples
de dialogue) ? Au contraire, les utopies et les systèmes totalitaires ne
visent-ils pas à substituer à cette dynamique de la liberté, une «société
froide», l’union figée et morte d’un «bonheur» au repos ? Reclus sur leur
«vie privée» garanti par un pouvoir extérieur et tutélaire, c’est le monstre
d’un Etat lubrifiant des vies séparées sans heurts ni accrocs dans le sommeil
politique de chacun que Tocqueville (De la démocratie en Amérique)
voyait à l’horizon de nos démocraties (et que peint Huxley, dans Le meilleur
des mondes). [Troquer la liberté contre un bonheur privé : problème
de l’opposition entre bonheur et liberté. Quel bonheur ? Le bonheur peut-il
être privé ? Peut-on être heureux dans la servitude ?]
Quatrième § : « Dire qu’un homme
se donne gratuitement, c’est dire une chose absurde et inconcevable ».
Pourquoi ? Se donner gratuitement c’est ici abdiquer sa propre liberté. Or
c’est là chose impossible (absurde=illogique) : je ne peux volontairement
renoncer à vouloir. Tant que je veux, je ne renonce pas. Quand j’ai renoncé, je
ne veux plus. Dans un contrat ce à quoi je peux renoncer ce n’est pas à ma
liberté (volonté libre comme source de l’action) mais à telle ou telle action.
Mais cette renonciation suppose que je la veuille et sa durée sera
celle-là même de cette volonté. Je ne peux par contrat décider d’abdiquer ma
liberté et de ne plus vouloir car ce que j’échange n’est pas une chose
(qui ne dépend plus de moi, une fois vendu, qui m’est extérieure) mais moi-même.
C’est pourquoi un contrat n’est pas le fruit d’une volonté ponctuelle mais continuelle :
dès lors que je ne veux plus, je résilie mon contrat. Cf. le contrat de
mariage : il ne tient que parce que je le veux, quand je ne le veux
plus : divorce. Le contrat qui me ferait renoncer à ma liberté à vie n’est
pas un contrat puisque suite à ce contrat ma volonté n’intervient plus :
ce n’est pas un contrat puisqu’un contrat peut être à tout instant résilié.
Cinquième § : Un contrat n’engage que
l’individu unique qui contracte et non ses descendants. Dans l’hypothèse où un
tel contrat de soumission serait valable pour un individu (ce qui n’est pas) il
ne l’est pas pour ceux qui ne l’ont pas choisi : un père n’est pas
propriétaire de ses enfants, chaque homme est une volonté libre. De là la
critique de la monarchie héréditaire et la perpétuation d’un pouvoir que
d’autres ont (par hypothèse) choisi pour nous. Sixième § : reprise
et synthèse des arguments précédents. a) On ne peut (sans folie ou mauvaise foi
(Sartre)) et on ne doit (devoir, dignité) renoncer à sa liberté. b) Le contrat
supposé est un faux contrat : rappel de la nécessité d’un échange et d’un
consentement bilatéral des volontés en présence.

C’est ton premier
pillage ?
(dessins de Voutch)
Partie 2 : § 7 et suiv.: examen
d’un prétendu droit d’esclavage fondé dans la guerre sur le droit de tuer
Grotius : l’esclavage serait légitime en situation
de guerre car il serait fondé sur un contrat. De même un chef / son
peuple conquis à la guerre : se comporter comme le maître/esclave.
Contrat = échange liberté contre vie. Semble un contrat : il y a bien
échange et intérêt des deux parties. Mais sur quoi est-il fondé ? Sur un
prétendu droit de tuer. Or, hors la guerre, il n’y a plus de droit de tuer.
Dans la guerre = légitime défense, quand ma vie est menacée (à comprendre : deux individus libres –
hors état de guerre - conviendraient d’un tel droit). Mais il n’y a pas
de droit de vie et de mort hors la guerre : quand il y a un vainqueur, la
guerre est terminée. Absence de droit de tuer : impossibilité de fonder un
droit à l’esclavage sur un droit inexistant. Là encore c’est la force qui
se pare du mot «droit » pour tenter de légitimer son pouvoir mais le
contrat supposé est, encore une fois, illégitime : du «je peux» te tuer on
passe à «j’ai le droit» de te tuer = sophisme.
Conclusion : de tels pseudo-contrats : façons
rhétoriques de masquer l’arbitraire du pouvoir de fait = la force
II) Transition : le problème du fondement du
droit que toutes ces théories n’ont pas examiné
Chapitre V : Qu’il faut toujours remonter à une
première convention
Erreur des théoriciens antérieurs (§ 2) :
supposent que le peuple puisse se soumette à un maître avant même d’étudier ce
qu’est un peuple. Qu’est-ce donc qu’un peuple? Un peuple n’est pas une
multitude, c’est une société = association. Une multitude, au contraire, c’est
une somme d’éléments épars, rassemblés par une force extérieure à laquelle ils
sont passivement soumis. Une multitude c’est un tas, une simple juxtaposition
spatiale : ex. tas de feuilles, déchets dans la poubelle. Or une fois la
force extérieure évanouie, le tas se désassemble : les déchets sans la
poubelle pour les contenir : à droite, à gauche selon les forces en
présence. Ainsi des esclaves rassemblés par la force du maître : ils sont
soumis (passivité) à la force extérieure du maître qui les unit et sont sans
liens les uns vis-à-vis des autres. Au contraire, un peuple n’est pas une
multitude : c’est une association d’hommes unis par la volonté (activité)
de vivre ensemble : ils ne sont pas unis (voix passive) par la force mais
ils s’unissent. Dans le tas le principe d’unité est à l’extérieur et les
éléments indifférents les uns vis-à-vis des autres (sans autre relation que spatiale :
espacement et contiguïté), une association : les éléments y sont chacun
avec les autres en rapport (volonté de), ils partagent en commun leur
volonté d’être ensemble et leur identité de membre de la société (citoyen). A
la différence d’une multitude dont le principe d’ordre est à l’extérieur et
régit passivement les éléments, une société s’organise en se forgeant
ses propres règles. Elle n’est pas soumise mais régie = par des règles et des
lois acceptées par tout un peuple de façon à rendre effective la volonté de
vivre ensemble. De là : si on est un peuple parce qu’on est simplement
soumis à des mêmes lois et règlements, on n’est pas un peuple mais une multitude.
Ainsi toutes les frontières ne délimitent pas un peuple : il y a dans un
même Etat des peuples qui ne veulent pas vivre ensemble (tout Etat n’est pas un
Etat-nation = Etat fondé sur la volonté unitaire de vivre ensemble). Ex :
les nationalistes corses, les conflits des ex. pays de l’Est unifiés de
l’extérieur par les forces communistes. L’opposition multitude / peuple renvoie
à deux conceptions de la politique : la première au despotisme, la seconde
à la république. Une multitude c’est, en effet, une totalité additive ou
mécanique alors qu’une société est un corps politique = totalité organique.
Totalité additive : le tout = somme des parties.
Ne fonctionne pas de façon autonome mais comme une machine – assemblage,
juxtaposition mécanique de parties – en étant mu de l’extérieur (la force) – et
ne se fabrique pas elle-même. A l’opposé une totalité
organique (corps) : le tout n’est pas une somme de parties (on ne peut pas
créer la vie par sommation de parties : cf. Frankenstein : il faut le
miracle d’un principe de vie donné par ailleurs pour faire vivre le
monstre qui sans cela est sans vie, simple juxtaposition d’organes), chaque
partie singulière (organe) participe de la vie du tout et le tout assure à
chaque partie sa vie : il y a action réciproque et unité
organique des différentes parties (le tout est en chacun, chacun est dans
le tout). Qu’est-ce qui assure cette unité organique d’un peuple qui fait qu’il
est un corps politique? La volonté de vivre ensemble, la volonté d’être un
peuple. C’est le principe de vie interne du peuple indissociable
de son être peuple : un peuple n’est peuple que soutenu par la volonté de
l’être, interne à chacune de ses parties. Au contraire, un corps politique mort
c’est ce qui reste une fois cette volonté évanouie ou usée : règles de
fonctionnement, bâtiments publics, lois… comme autant d’éléments juxtaposés et
démembrés de la machine politique qui ne fonctionnent plus sans la vie que leur
donne le souffle du peuple. De là l’échec de la transposition de formes
politiques telle une démocratie représentative là où manquent les conditions de
leur efficience : un peuple conçu comme volonté effective de vivre
ensemble, cf. Afrique;
fonctionnement
politique défectueux des ex. pays de l’Est… Un peuple ce n’est donc pas un
donné, un fait, c’est une volonté vivante et actuelle de vivre ensemble.
C’est pourtant ce qu’il ne semble pas : un peuple,
l’historien ne le définit-il pas par son histoire, comme le produit involontaire
d’un processus historique? Certes, mais les conditions historiques sont des
conditions (ce sans quoi il n’y a pas : ex. l’unification des langues, le
rapprochement culturel…) mais non des causes (ce qui produit) : il n’y a pas
de peuple sans une reprise active et volontaire des données de
l’histoire (De là le pb de l’Europe : sur quoi la fonder ? Sur
l’histoire ? Sur la volonté de vivre ensemble ? Doit-on supposer ou
construire cette volonté ? Et dans quelle mesure en avons-nous les moyens ?
Sans parler de l’idée de « faire le Monde» - au sens politique – qui
interroge en retour l’idée d’Europe : à quelle fin l’Europe ? Quel
lien / Monde ? = un pas vers (réaliser l’humanité politique)? Ou un pas
contre (se protéger) ?).
Synthèse : Une tyrannie = absence de vie
politique (mort politique), absence de peuple = agrégation d’éléments
extérieurs les uns aux autres par une force extérieure (le tyran) = un troupeau
(modèle animal) = esclaves. Absence de vie publique : tous les intérêts
sont privés / une république (res publica =chose publique) :
unité vivante du peuple voulant être peuple – intérêt commun - et exerçant
effectivement le pouvoir législatif (choisissant les lois organisant leur
propre être-ensemble).
Deuxième § : Erreur de Grotius : il
ne sait pas ce qu’est un peuple et le confond avec une multitude. Or, note
Rousseau, avant d’analyser si un peuple peut se donner à un roi – et de
quelle manière - il convient d’analyser son préalable = la constitution même du
peuple comme peuple. Le contrat que supposait Grotius par lequel une multitude
se soumettait à un chef manquait les conditions mêmes d’une telle réunion.
Si cette réunion est une agrégation forcée alors il n’y a pas de contrat,
puisque la volonté en est absente – on a affaire à une multitude unie de
l’extérieur par la force du chef ; s’il doit y avoir contrat entre le chef
et le peuple (si le pouvoir du roi doit être fondé sur l’intérêt
réciproque du roi et des gouvernés et donc sur leur volonté commune), il faut
que quelque chose comme la volonté du peuple existe préalablement.
Mais qu’est-ce qu’une telle volonté et que suppose t’elle?
Troisième § : Le contrat étant
(hypothétiquement) supposé entre le peuple et le roi – il faut donc que le
peuple existe et qu’il ne soit pas qu’un mot réunissant de l’extérieur
une multitude (ainsi qu’il l’est dans le discours des grands : fiction
d’une unité inexistante mais permettant de légitimer faussement la violence
cf. « au nom du Peuple… »). Si donc on réunit la population (une
multitude) dans une salle de vote et qu’on demande à tous de choisir le chef
qui les dominera, qu’est-ce qui peut bien engager celui qui a voté pour
un autre de suivre l’opinion majoritaire ? Lui ne veut pas de ce chef,
qu’est-ce qui va bien pouvoir l’y attacher de telle façon qu’il s’y soumette volontairement
? «Où serait (…) l’obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix
du grand, et d’où cent qui veulent un maître ont-ils le droit de voter pour dix
qui n’en veulent point ? ». Il faut au préalable que la totalité
des volontés soit d’accord sur la règle majoritaire : s’il n’y
a pas accord sur une telle règle, le résultat du vote ne saurait engager celui
qui ne veut pas cette règle. Le point est important : le peuple,
avons-nous vu, est une association fondée sur la volonté de vivre
ensemble ; il est donc constitué d’une pluralité de volontés s’unissant
volontairement : si une volonté refuse une telle association, elle ne
fait donc pas partie du peuple. Dès lors l’engagement volontaire d’une
partie de la population ne saurait engager la partie qui refuse un tel
engagement : ils ne peuvent qu’y être forcés mais, sans volonté de
leur part, ce n’est pour eux nullement un devoir. On saisit l’enjeu : la
règle démocratique de la majorité n’est-elle pas un despotisme du plus grand
nombre sur la minorité – despotisme car forçant le petit nombre qui
ne veut pas de la loi à s’y soumettre (alors que le plus grand, lui, veut
la loi) ? Pour qu’une telle règle ne soit pas despotique, il y a une
condition : qu’il y ait unanimité sur une telle règle, c'est-à-dire que
tous la veuillent. Une élection légitime doit donc être telle que la totalité
des individus la veuillent, non nécessairement dans son résultat mais dans
son principe. Voila ce qui unit fondamentalement la droite et la gauche
aujourd’hui : malgré les divergences politiques, accord fondamental et
premier sur le principe majoritaire et les institutions qui servent de
cadre au débat public. Par quoi je peux, si je veux la règle
majoritaire, obéir volontairement et sans contrainte à son résultat,
fut-il contraire à mes opinions. Il s’agit ici d’une obéissance légitime (parce
que je la veux) et non forcée (bien que la force publique soit aussi là,
mais légitime, pour contrecarrer les oppositions aux principes de la
République : de là vient, bien entendu, la question : qu’en est-il de
celui qui refuse l’association – et est-ce possible?). C’est une telle
condition d’unanimité qu’oublie Grotius : s’il doit y avoir débat public
et délibération, le préalable c’est que tous adhèrent aux principes et
aux règles de tels débats – sans quoi ils ne sont nullement engagés par le
résultat. Le préalable de toute convention politique légitime c’est la
République, c'est-à-dire l’existence d’un peuple.
Dès lors le problème à résoudre est celui-ci : comment
une multitude devient-elle un peuple? Par le contrat social.
III) La théorie rousseauiste de la légitimité
Chapitre VI : le pacte social, définition du
fondement de la légitimité
Il s’agit ici du centre de l’exposé dont les chapitres
VII et VIII ne font que dégager les conséquences. Nous savons désormais que
l’avènement du peuple est un acte de volonté (et non forcé) qui suppose l’unanimité
des contractants. Quels en sont les conditions et le moteur effectif?
Premier § : Rousseau part d’une fiction
(« je suppose ») qui est l’état de nature. Qu’est-ce qu’un tel état ?
C’est l’imagination de ce que serait la vie humaine sans la société, la culture
et les lois – fiction car nul homme ne vit et n’a vécu ainsi (pas d’homme sans
culture) mais fiction hautement intéressante en ce qu’elle nous permet de
penser, par opposition à l’animalité, tant la spécificité de l’homme que
la nécessité des lois. Le discours sur l’origine de l’inégalité
avait pour but d’éclairer le passage d’un tel état de nature où l’homme n’est
encore qu’un animal à l’état civil par la construction d’un discours
hypothétique. Ce § s’y réfère explicitement. Sans lois et sans police pour les
faire respecter, la vie de l’homme a l’état de nature a tôt fait d’être insupportable :
rien ne garantit sa sécurité, il est soumis aux passions de tous, sa vie et ses
biens sont à tout instant menacés engendrant «le plus horrible état de
guerre». De là un pacte fomenté par les riches (cf. texte) :
jouant sur l’intérêt commun à la sécurité (la vie, premier des biens), ils
convainquirent chacun de la nécessité d’un pouvoir supérieur garantissant la
paix. Mais c’est, affirme Rousseau, un véritable contrat de dupe : si les
pauvres gagnent, en effet, la sécurité ce qu’ils gagnent aussi c’est la
transformation de l’inégalité de fait – produit arbitraire de purs rapports de
force – en inégalité de droit (=ici légal, défendu par les forces de l’ordre, et
se prétendant légitime). Au contraire, les riches gagnent tant la sécurité que
la protection par la loi, sous l’apparence de la justice, des biens accaparés
sur une terre qui, à l’état de nature, appartient à tous et n’appartient à
personne : leur possession de fait devient propriété (= légale et
protégée, cf. chap. IX). L’inégalité, pur fait, produit arbitraire de
l’histoire, pur effet de rapports de force, devient, par ce pacte de dupe,
inégalité garantie par la force de la loi et masquée sous l’ambiguïté des mots
« droit » et « justice ». Actualité d’une telle critique :
à qui appartient la Terre? La loi répond en donnant des titres de propriété,
garantissant la légalité de la simple possession – réponse : à une poignée
de firmes. Qu’est-ce d’autre sinon l’illégitime (sur la nature et les limites
de cette illégitimité de la propriété, cf. chap. IX) transformation du fait en
droit = « le droit du plus fort » ? C’est pourquoi Rousseau entend
substituer à ce pacte illégitime, un pacte de droit. Le pacte social,
avons-nous reconnu, est un pacte nécessaire : nécessité des lois pour
survivre hors état de guerre (en ce sens nul ne peut, en raison, s’y
soustraire). Certes, mais quelles lois - de telle façon qu’elles soient justes?
(légitimité et sûreté) Rousseau entend
ici substituer au faux contrat fomenté par les riches, un contrat légitime
fondant la société.
Second § : Utilisation d’un modèle
mécanique (physique) pour expliquer le passage des individus formant une multitude
en conflit dans l’état de nature à l’union en un peuple par le pacte social.
Modèle mécanique : chaque individu peut-être défini par une force,
elle-même quantifiée (intensité), force ayant une direction
particulière (ex : force musculaire ayant pour direction l’objet possédé
par le voisin). Dans l’état de guerre de tous contre tous, les forces
s’opposent et se contrecarrent : le plus fort gagne mais il faut
retrancher de son gain la force qu’on lui a opposé (F = F2 – F1) – finalement,
par le jeu des forces contradictoires qui se soustraient les unes les autres un
tel état aboutit à un état de misère insupportable (où le fort d’un instant
n’est nullement assuré de sa position de demain). De là, dit Rousseau, la
nécessité «d’unir» les forces (« l’union fait la
force ») : au lieu que les forces s’opposent et ainsi se soustraient,
faire qu’elles s’additionnent = agrégation (Ex : au lieu de s’opposer pour
obtenir un fruit, unir les forces pour en produire davantage : ici tout le
monde est gagnant). Mais l’addition ne suffit pas, il y faut encore – second
point – direction. L’addition seule c’est addition sans sens
donné et donc indifféremment pour toute finalité : par
exemple, addition des forces (et non conflit) au profit d’un despote.
L’addition seule, sans direction, c’est addition aveugle.
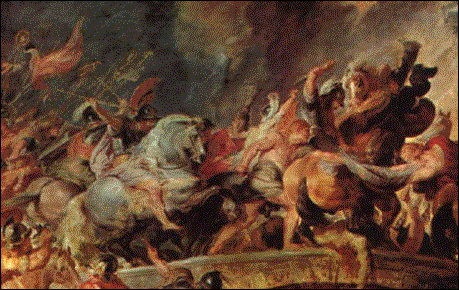
La guerre : opposition et soustraction
de forces
Rubens, Le combat des amazones

L’agrégation des forces sans conscience de la
direction : unité
aveugle
Extrait de Full métal Jacket de
Kubrick
Diriger les forces unies c’est leur donner
consciemment un sens, une direction, une finalité = décider de la direction
de notre destin commun = transformer l’agrégation des forces en association
en vue d’un « seul mobile » (= seul but). C’est non seulement
s’unir mais savoir pourquoi, dans quelle finalité on s’unit : être maître
tant de notre union que de la direction de notre vouloir commun.
Troisième point : «faire agir nos forces de concert ».
Métaphore musicale : harmonie (cf. texte de Montesquieu). Chaque
instrumentiste participe à l’élaboration du tout : la visée = commune (le
morceau) et la pratique = une partition particulière. Au contraire, si chacun
joue ce qu’il désire = cacophonie (soustraction de sonorité : on n’entend
rien ; on n’entend plus que celui qui joue le plus fort). Concert = régulation
de chaque volonté (ordre) en vue d’un but commun = la direction.
Troisième et quatrième § :
comment faire pour qu’en unissant nos forces nous ne perdions pas notre
liberté? Or il n’y a de légitimité que consentie = fondée sur la liberté :
il faut donc penser une synthèse de l’unité (le peuple) et de la pluralité
(volontés individuelles) de telle façon que l’unité soit voulue par chaque
volonté. Formulation du problème : «trouver une forme d’association qui
défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque
associé, et par laquelle chacun s’unissant à tous n’obéisse pourtant qu’à
lui-même et reste ainsi aussi libre qu’auparavant ».
1) Première interprétation : compréhension
libérale. Le problème est redoutable : si je m’unis aux autres c’est à
dire si nous mettons nos forces en commun (agrégation) sous une unique
direction (association) afin d’agir en harmonie, je ne peux apparemment
« faire ce que je veux », je dois obéir à la direction
commune (le tout) – comment dire alors que j’obéis à moi-même (si j’obéis à
un autre : le tout)? C’est ainsi que ce qui nous force le plus souvent
à obéir aux lois de l’Etat (cf. infractions routières, impôts) c’est souvent
une menace extérieure : ce que je veux (aller vite, ne pas payer d’impôts)
s’oppose à la direction du tout (ralentir, payer des impôts). Si donc
j’obéis c’est par contrainte (prudence : chapitre III). Mais je
n’obéis pas à moi-même car obéir à soi-même c’est faire ce que je veux – or
ce que je veux c’est précisément ici désobéir à la loi (aller vite, ne pas
payer d’impôts). De là le second problème : rester «aussi libre
qu’auparavant», c’est ce qui semble impossible. Si être libre c’est faire
ce que je veux et si auparavant, c'est-à-dire avant les lois et la contrainte
de l’Etat, cette liberté (naturelle) était illimitée en principe quoique
limitée en fait (par la force des autres), la nécessité d’obéir à un but commun
me contraint nécessairement à suivre une direction commune qui n’est pas la
direction que j’aurais naturellement prise. Dire que je suis aussi libre
qu’auparavant, c’est donc apparemment se payer de mots : certes, par le
pacte social, je gagne la sécurité (garantie par les lois et les forces de
l’ordre) – et je préfère la sécurité accompagnée de contraintes, à la liberté
naturelle inefficace car accompagnée du risque permanent de la mort – en ce
sens je veux (je choisis effectivement) l’état social; mais je préférerais –
chose que je reconnais impossible – ma liberté naturelle (non contrainte par
les lois) et la protection des lois. L’état social semble ainsi la
garantie d’une liberté limitée me permettant de me protéger contre
tous : il est ce qui permet à ma liberté d’être effective (et non
impuissante). Alors on comprend très bien en quel sens on peut dire qu’on obéit
à soi-même et qu’on est libre dans l’état social : je veux effectivement
cet état social car je comprends par raison qu’il est nécessaire pour
garantir ma liberté. On opposera alors la volonté éclairée de raison au désir,
force aveugle qui me pousse en avant : je veux alors contre mon
désir. Certes, mais c’est ici pour mieux le réaliser (être le maître,
accaparer) : j’ai, en effet, tout intérêt, quand l’occasion se présentera
et dans les interstices de la loi à affirmer ma liberté naturelle (conçue comme
spontanéité accaparatrice et assimilatrice). Dans une telle logique, il s’agit
donc de limiter au possible le rôle de l’Etat de façon à ce qu’il
soit, et qu’il ne soit que, le garant des libertés individuelles –
conception à laquelle se rattache le premier membre de la phrase de
Rousseau : « trouver une forme d’association qui défende et
protège de toute la force commune la personne et les biens de
chaque associé ». Cette conception = la conception libérale de l’Etat
(Etat minimum, Etat simple garant de l’ordre). Si donc on fait de la politique,
c’est négativement – on préférerait s’en passer – pour empêcher tant que
individus privés abusent de leur pouvoir, que le pouvoir étatique soit utilisé
dans un but de puissance – et certes, avons-nous vu, c’est bien là la position
la plus courante de l’Etat dans l’histoire; par quoi, il convient effectivement
de se protéger d’un tel arbitraire.
Notes complémentaires sur : «trouver une
forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la
personne et les biens de chaque associé». Surgit ici, cependant, un
sérieux problème : pour qu’un tel contrat ait un sens, il faut
nécessairement que les individus possèdent des biens, sinon pourquoi
contracteraient-ils pour garantir les biens des autres ? Or c’est – cf. Discours
sur… - ce qui n’est pas puisque certains ont tout alors que d’autres n’ont
rien (ou presque) : situation qui est plus que jamais la nôtre d’une
inégalité fondamentale des richesses. Dès lors un tel contrat ne revient-il pas
à la situation du faux contrat que dénonçait Rousseau plus haut, un tel
contrat entérinant l’inégalité des richesses en transformant en propriété (de
droit) ce qui n’était qu’arbitraire possession ? Il y aurait ici un impensé de
la part Rousseau – peut-être motivé par une certaine volonté de «réalisme»
(cf. : si le contrat doit être possible, il faut qu’il soit – de fait –
accepté par les riches). Mais la profonde inégalité des possessions est-elle
compatible avec l’unité d’un peuple (cf. Rousseau, livre I, chap. IX et livre
II, Chap XI). Les riches et les pauvres ne vivent-ils pas dans deux mondes
(division : les riches mettent en commun leurs forces / les pauvres de
même : conflit. Cf. Marx = lutte des classes) séparés et sans liens –
ou plutôt par ce seul lien que les premiers exploitent les seconds
(domestiques, ouvriers) aux fins de leurs besoins : comment la conscience d’une
unité politique pourrait-elle bien naître d’une telle disparité ? A ceci
s’ajoute que les conditions de l’émergence d’un peuple (par définition
unifié) sont tant une liberté des volontés (chapitre V) que leur éducation
(capacité à penser par soi-même) – conditions qui nécessitent qu’une partie de
la vie des citoyens soit libérée de la nécessité économique (ce qui,
bien entendu, est infiniment loin d’être aujourd’hui le cas) et, par
conséquent, une certaine répartition plus équitable des biens. A défaut
l’Etat a toute chance de n’être que cet Etat minimal garant, certes, de la
liberté des personnes mais tout autant de l’inégalité sociale.
2) Deuxième interprétation. Une telle
conception, protectrice et négative, de l’Etat n’est pourtant pas la conception
de Rousseau. Rappelons les termes du problème : ««trouver une
forme d’association qui défende et protège de toute la force commune la
personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun s’unissant à
tous n’obéisse pourtant qu’à lui-même et reste ainsi aussi libre qu’auparavant ».
Si dans l’union à tous je n’obéis qu’à moi-même, c’est que la volonté
générale (la direction commune du corps social) est ma volonté ou –
c’est la même chose – que je veux la volonté générale. Alors, bien entendu, si
ma volonté est la volonté générale je n’obéis qu’à moi-même (aux buts que je me
fixe) et je suis, en ceci, libre. Dire que je veux la volonté générale, cela ne
signifie pas ici (conception libérale) que je la veux pour réaliser –
par ailleurs – mes désirs (égoïstes par nature) mais que je la veux pour
elle-même. Cela signifie t’il que je dois faire taire ma volonté et fusionner
avec celle du corps social ? Non car alors la volonté générale ne serait plus
ma volonté – j’aurais perdu ma liberté comme capacité à me diriger
moi-même = modèle de la soumission aveugle d’un individu au groupe
(fascismes, totalitarisme : agrégation aveugle des forces). Il faut donc –
c’est le point à comprendre – qu’en toute conscience et liberté, éclairé par la
raison – et ceci donc à la première personne - ma volonté soit volonté
générale – sans quoi c’est ma liberté qui est perdue (la maîtrise
volontaire de moi-même). Alors je ferais véritablement corps avec le peuple
comme mouvement unitaire volontaire – ce n’est alors rien d’autre que de se
penser et de penser les autres comme citoyens. Est-ce possible ? Et à
quelles conditions ?
Cinquième § : les conditions du contrat
(les clauses) sont ce sans quoi le contrat est nul. Elles sont, nous dit
Rousseau, tacites = sous-jacentes, non dites. De même que le contrat est un
contrat tacite, de même les clauses : tacite, cela veut dire que la
multitude ne s’est jamais effectivement réunie pour décider de devenir
un peuple. Contracter ce n’est ici rien d’autre que participer activement à
la vie politique dans la visée de la volonté générale c'est-à-dire du bien
commun – nul besoin, en effet, de signer, nul besoin de papier, l’action
même de participer et de viser le bien commun suppose un tel contrat
tacite. Le contrat social n’est rien d’autre que l’acte permanent de
contracter = un engagement continu (comme le mariage). Mais, note
Rousseau, si les clauses sont violées alors le contrat devient nul :
sous-entendu si l’action politique réelle contrevient aux clauses du contrat,
clauses pour lesquelles j’ai renoncé à ma liberté naturelle (tout faire sans
limites), je n’ai alors nul devoir d’obéir à des lois injustes (et
injustes parce que contrevenant aux clauses par lesquelles seules la justice
comme produit de la convention prend sens) : je peux me révolter = j’en ai
le droit. Ainsi par exemple des résistants / régime de Vichy, illégitime
parce que s’imposant de l’extérieur aux volontés individuelles, démises de leur
pouvoir législatif.
§ 6, 7 et 8 : quelles sont, plus
précisément ces clauses? « L’aliénation totale de chaque associé avec
tous ses droits à la communauté » : en quoi est-ce ici la condition
du contrat social? Il faut premièrement comprendre qu’une telle aliénation
totale est le don par l’individu de tous ses droits à la
communauté : tous ses droits, cela signifie ici, tous ses droits naturels
(=hors du contrat) = droit d’user de ma force comme je l’entends au gré de mes
désirs (droit qui n’est, en réalité qu’une puissance de fait). Si, en effet,
l’individu gardait par devers lui le droit d’utiliser comme il l’entend
sa force, alors la sécurité – qui suppose l’union des forces – ne serait pas
assurée (je pourrais au gré de mes pulsions utiliser ma force contre autrui)
et, donc, le contrat, qui vise l’unité, nul. Aliéner ses droits à la communauté
signifie reconnaître que mes droits – ce que j’ai légitimement le
droit de faire - sont définis par la loi et non par l’arbitraire de mes
désirs et pulsions individuels : aliéner tous ses droits signifie ainsi abolir
le despotisme (renonciation de chacun à la possibilité d’être au-dessus du
droit – c'est-à-dire du droit commun). Par quoi, l’égalité est supposée
comme une condition du contrat : tous doivent également contracter
pour que la renonciation à l’usage égoïste de la force ne se fasse pas au
détriment de quelques-uns mais au profit de tous.
Alors « chacun se donnant à tous ne se donne à
personne » - puisque les conditions sont strictement égales pour tous
les contractants et que nul ne saurait se soustraire au contrat. Mais cependant
– et c’est le second point - ce qui n’est pas et ne peut pas être aliéné c’est
le moteur même du contrat qui est toujours ici supposé, à savoir la liberté.
C’est toujours volontairement que je souscris au contrat, c’est volontairement
que j’accepte de donner à la communauté tous mes droits naturels en échange de
droits civils maintenant légitimes – la liberté, la liberté de ma
volonté, est donc, par principe inaliénable puisqu’elle est la source continue
de la validité du contrat. Ce qu’il faut ainsi comprendre c’est que cet acte de
renoncer à mes droits naturels est un acte de liberté (un acte volontaire) par
lequel je décide librement – et sous la condition d’une égale acceptation par
tous – de devenir membre de la communauté, du corps politique, citoyen du
peuple. Alors l’Etat ne m’est plus extérieur : l’Etat (légitime)
c’est nous, soit la force du peuple en acte s’autodéterminant c'est-à-dire
tissant par soi-même les fils de son destin.
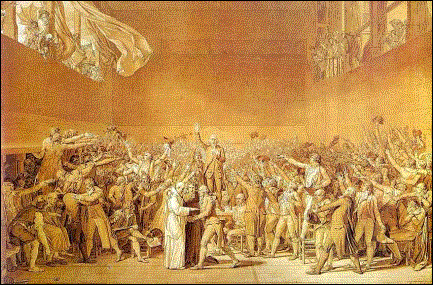
Harmonie : union et direction commune des volontés en volonté générale
David, Le serment du jeu de paume (1791)
Lecture des images
Mode de relation humaine : un certain rapport de
force, un certain rapport des volontés à l’unité
sociale.
Rubens : conflit. Caractère chaotique des mouvements
et des formes : enchevêtrement ; absence de point central focalisant
le regard (unité) = autant de volontés individuelles qui se contrecarrent,
s’empêchent, se brisent les unes sur les autres. Opposition et soustraction des
forces.
Full Metal Jacket : agrégation des forces :
unification. Présence d’une force unitaire de frappe (en puissance). Unité : perspective, ordre. Mais
soumission aveugle (absence d’individualité et de conscience = uniformes
(identiques)) à une finalité extérieure (le chef). Fusion de l’individu/groupe.
David : harmonie (unité) d’individualités (visages et
attitudes différenciés). Unité de forces et de direction (les bras, la perspective). L’élan collectif
résulte de chaque volonté particulière : c’est l’unité en acte du peuple,
synthèse consciente et volontaire des volontés individuelles = figuration du
contrat social dans une unanimité non fusionnelle (conscience de soi et
des finalités communes).
.
§ 9 : Termes du pacte social : « Chacun
de nous met en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême
direction de la volonté générale : et nous recevons en corps chaque membre
comme partie indivisible du tout ». Qu’est-ce que la volonté générale?
Distinguons trois types de volonté : la volonté particulière, la volonté
corporatiste et la volonté générale. Volonté particulière : lorsque je
prends en compte mon seul intérêt personnel = égocentrique (centré sur moi).
Volonté corporatiste : fait intervenir plusieurs individus qui ont les
mêmes intérêts (veulent la même chose). Union = plus de force, plus de
pression. Ex : association commerciale, syndicats. Volonté générale :
volonté d’un individu quand il prend en compte l’intérêt général.
L’intérêt général = un intérêt (ce qui est bien pour le tout, ce qui est
un bien commun) et non un sacrifice (ce n’est pas s’oublier) = mon intérêt en
tant que je me considère non comme un tout (égocentrisme) mais comme la partie
d’un tout = un citoyen de ce tout qu’est le peuple. Or, en tant
qu’individus nous sommes traversés par ces trois volontés. Cf. un agriculteur
dont l’Etat décide de construire une autoroute sur ses champs. Volonté
particulière : refus d’une telle construction (intérêt = mon champ =
argent). Volonté corporatiste : peut s’allier avec les autres agriculteurs
afin de former un groupe de pression (défendre en groupe les intérêts
particuliers communs). Volonté générale : se décentre de sa position
d’agriculteur (=position particulière et en concurrence
(opposition, séparation) sur l’échiquier économique), de ses passions
(Diderot : la volonté générale = « un acte pur de l’entendement
dans le silence des passions ») qui m’attachent à un
objet particulier (son champ pour l’agriculteur) et, en tant que citoyen, s’interroge
sur la légitimité d’une telle construction : qu’en est-il du point de vue
de l’intérêt général ? Je sais que je dois vouloir la volonté générale (en tant
que je suis citoyen et que je vise le bien commun) mais cette dernière je ne la
connais pas : s’engage alors un processus de réflexion (Est-ce vraiment
utile? Prise en compte du point de vue des autres = dialogue ; question de
l’environnement ; de l’esthétique ; de l’utilité économique ;
des méfaits engendrés pour les paysans…). Ce processus de réflexion est
identiquement un processus de dialogue tant avec soi (« Penser c’est
dialoguer avec soi-même » (Platon)) qu’avec les autres. De là l’enjeu
fondamental tant d’une éducation (apprendre à penser par soi-même), d’une information
(pouvoir de collecter les données du problème : rôle de la presse et des
médias), d’un espace public de discussion et de temps nécessaire au dialogue
par lequel seul, des individus qu’on suppose ici mus par l’idée de volonté
générale (de bien commun), décentrent leur volonté particulière et
cherchent chacun pour soi-même et avec tous, par la raison, l’intérêt général.
Le terme de ce processus comme expression de la volonté générale c’est la
loi, règle de mise en ordre de la société selon le bien commun.
Trois points à considérer ici : 1) Nous sommes
très souvent tiraillés entre ces volontés : le conflit
intérieur est le signe de l’existence de ces volontés contradictoires (cf.
chap. VII, § 6). 2) La discussion politique effective est très loin d’une
telle visée d’impartialité : le bien commun est dans tous les discours
et, rarement visible dans les intentions. Le jeu de la rhétorique politique est
le plus souvent une manière de cacher une volonté particulière ou corporatiste
(riches/classe moyenne/pauvres, par exemple) derrière le masque de la référence
au bien commun. La lutte des partis semble bien plus une lutte entre systèmes
corporatistes visant partialement l’intérêt d’une partie de la population que
dialogue - sans passions- en vue de
l’intérêt général et du peuple tout entier. C’est ce qu’on peut d’ailleurs
interpréter d’après la note du dernier paragraphe de ce chapitre :
confondant un bourgeois (défini par son intérêt privé, sa volonté égoïste
commune à sa classe) et un citoyen (membre du corps politique = le peuple), on
ne peut que confondre volontés particulières et volonté générale ; et
concevoir ainsi la politique comme une lutte sans violence des forces en place
pour défendre leurs intérêts privés. Mais, comme le notait Kant,
l’hypocrisie est l’hommage que le vice rend à la vertu : le masque de
l’intérêt général par lequel on cache la partialité d’un discours manifeste au
moment même où il la nie la reconnaissance de la valeur d’une telle visée.
Imaginons un homme politique qui dirait cette vérité : « je suis
riche et je défendrais la cause des riches en trompant le reste de la
population ! ». Il sait très bien qu’il ne le peut et qu’il doit
avancer masqué (pour peu que la lucidité lui fasse prendre conscience de son
masque car pour prendre conscience encore faut-il se décentrer c'est-à-dire
réfléchir – entrer en dialogue avec soi-même sans mauvaise foi). 3) Mais le
fait d’une réalité politique le plus souvent étrangère à la visée effective du
bien commun n’annule ni la valeur, ni la légitimité d’une telle recherche. Le
réaliste c’est celui qui prend acte du fait et renonce à le changer – il
coopère ainsi avec la réalité la plus abjecte et manifeste par là même son
amour d’un fait qu’il prétend rejeter («ce serait beau, mais… » : le
«mais » = on jette l’idéal à la poubelle pour sacraliser l’ordre des
choses). L’idéaliste, lui aussi, voit bien le réel mais ce réel ne le satisfait
pas : de là le fait qu’il ne renonce jamais tant à l’idée qu’à la visée
d’une transformation du réel pour le rendre conforme à l’Idée et, ici, à l’Idée
de Justice. Texte de Kant : le contrat social est une Idée
régulatrice de la pratique, c'est-à-dire une Idée qui doit nous
guider pour construire un état politique juste. C’est grâce aux idéalistes que
l’Idée de Justice (ou identiquement du contrat social) peut arriver à
s’incarner – certes peut-être toujours imparfaitement – dans la réalité
politique. 1789 = un pas vers l’idéal – condamné par tous les
« réalistes » de l’époque. Faire que la République existe = le peuple
en acte, c’est la responsabilité de chacun puisque le peuple n’existe qu’à
travers la volonté d’incarner la volonté générale, c'est-à-dire d’être citoyen.
Vocabulaire (chap. VI, dernier §) : République
= corps politique naissant de l’union volontaire de tous en un peuple par le
pacte social. Deux dimensions : Etat quand le corps politique est
passif (formé de sujets = qui obéissent) c’est-à-dire soumis à la législation
édictée par le Souverain (seconde dimension) = le peuple législateur
(formé de citoyens comme volontés participant à la formation de la loi).
Chapitre VII – IX : Explications et
implications de la théorie du contrat social
Bilan et développements - chap.
VI, VII et VIII
. Source du contrat social : refus de l’arbitraire
politique, des rapports de force (définissant un état de fait) qui se
prétendent droit.
. La loi s’impose aux hommes de telle manière qu’elle
les contraint à obéir : dans quelle mesure une telle contrainte
peut-elle être légitime = de droit – par quoi elle deviendrait obligation
à obéir – et non simple acte de prudence?
. Rousseau : elle ne peut l’être que si je veux
une telle contrainte, si j’accepte librement (c'est-à-dire hors la
pression de toute force) de m’y soumettre.
. Dans quelle mesure et sous quelles conditions
puis-je donc vouloir la loi et son ordre contraignant / ma liberté
naturelle (tout faire sans freins)?
. Premièrement : en réfléchissant (par le
biais de la raison : faculté qui pèse et calcule, anticipe, prévoit
/ par quoi je me sépare de l’immédiateté de mon désir) sur les conséquences
d’un état sans lois (guerre), je m’aperçois que les lois et des lois
contraignantes pour tous = nécessaires pour me permettre de réaliser
mes fins naturelles (désirs). Je veux donc de telles lois = ici logique égoïste
de calcul (Hobbes, Léviathan).
. Mais pour que des individus posés premièrement comme indépendants
et pouvant tout les uns sur les autres, décident de se soumettre à la loi -
c'est-à-dire de renoncer à leur liberté naturelle – il faut des conditions.
Le contrat social est l’énoncé de ces conditions.
. Il faut tout d’abord qu’unanimement (nécessité
pour que le contrat vaille pour tous (cf. critique de Grotius) – et il
ne peut valoir que s’il est librement accepté = voulu) les contractants renoncent
à leur liberté naturelle. Alors chacun contracte avec tous : un contrat
est établi par lequel les contractants renoncent à leur liberté naturelle au
profit d’une liberté civile définie par le contrat : ils ne sont
plus alors ces individus isolés dotés de volontés sans freins, des egos
irréductibles et séparés, mais des citoyens = des individus en
co-relation (relation de contrat) qui se définissent par leurs droits
civils. Par là, les individus se définissent dans une autre dimension :
la dimension du droit. L’ordre du droit substitue ainsi à la contingence
et à l’arbitraire des situations (= l’ordre de la nature et du fait) -
un ordre de raison, reconnu et voulu par tous : le droit est relation
volontaire entre des sujets libres.
. Le pacte social institue ainsi l’ordre d’une loi
commune à laquelle nous nous soumettons volontairement : le premier
terme du contrat, condition de toute loi ultérieure, est ainsi l’obéissance à
la loi (= se mettre « sous la direction de la volonté générale »).
. Cela signifie t’il pour autant se soumettre à toute
loi? N’y a-t-il pas des lois injustes – auxquelles je pourrais me
soustraire? On pourrait vouloir limiter la loi et son champ
d’application / considération extérieure (cf. constitution et droits de
l’homme : la loi n’a pas le droit de…). On opposerait ainsi l’ordre de la
loi et l’ordre du droit (point de départ de Rousseau). Certes, mais au nom de
quoi une telle opposition? Au nom du droit, c'est-à-dire du contrat social
(qui fonde le droit c'est-à-dire la légitimité de la loi) : aussi ne
peut-on opposer au contrat social et aux lois légitimes qu’il crée un droit
quelconque à la désobéissance. Il faut donc aller au fondement d’une
telle opposition : une loi injuste c’est une loi qui contrevient aux
termes du contrat social. Mais d’où vient la possibilité d’une telle loi?
D’une disjonction entre celui qui fait la loi / celui qui est censé y obéir =
ex. disjonction entre le roi / le peuple. L’Etat (ici comme pouvoir effectuant
et dirigeant les lois - et non selon la définition – passive - de Rousseau)
apparaît alors comme extérieur et étranger : le Souverain (=celui
qui édicte les lois), différent ici du peuple, peut alors et doit être limité/
termes du contrat social.
. Mais une telle conception ne va pas encore assez
loin : la disjonction peuple / souverain doit être dépassée.
Qu’est-ce, en effet, qu’un tel souverain extérieur au peuple ? Cela
signifie t’il un individu extérieur au pacte social (qui engage chacun envers
tous et substitue à l’usage libre de la force la soumission volontaire de tous
au droit) ? Mais si c’est le cas, je n’ai nul devoir d’obéissance envers un tel
individu extérieur au contrat : je ne dois, en effet, obéissance qu’aux
lois naissant du pacte social. Qui tisse ainsi ces lois ? = le peuple
par définition légitime. Le seul souverain légitime c’est donc le
peuple : les lois édictées par le peuple sont ainsi toujours légitimes :
le souverain n’est pas et ne peut-être extérieur au pacte social, il est son
produit sans cesse recommencé.
. Si donc le souverain limite sa propre action ce ne
peut-être qu’une autolimitation : la constitution (par quoi certaines lois
peuvent être « anticonstitutionnelles ») est toujours
révisable puisque c’est le souverain = le peuple qui en est la source (Chap.
VII, 2ème §).
. On comprend ainsi que si j’obéis à la loi édictée par
le peuple (union volontaire et sans cesse continuée des volontés individuelles
unies par la visée du vivre-ensemble), je n’obéis qu’à moi-même –
puisque c’est, par définition, librement et volontairement que je me fais
citoyen c'est-à-dire membre du corps politique. « L’obéissance à la loi
qu’on s’est prescrite est liberté » (chapitre VIII) = définition de
l’autonomie.
. De là la compréhension de la phrase : «on le
forcera à être libre » (chap. VII, dernier §). Si, en effet, un
individu refuse d’obéir à la loi édictée par la volonté générale (légitime, par
définition), c’est à lui-même (en tant que volonté générale) qu’il refuse
d’obéir. Or une telle désobéissance marque la disjonction entre sa volonté
particulière et sa volonté générale, soit entre sa sensibilité égoïste et sa
raison. « On le forcera à être libre » signifie alors :
on forcera son être égoïste naturel à se soumettre à la raison, raison qui est,
en droit, la sienne – même si, de fait, il ne la reconnaît pas
(aveuglement par le désir, folie, emportement…). Le travail de l’éducation
(chap. VIII) est précisément de faire en sorte que le petit animal égocentré
qu’est l’homme s’éveille à la raison et puisse substituer à une liberté
naturelle qui n’est que licence pulsionnelle (spontanéité), la direction d’une
loi librement choisie à la lumière de la raison. Si donc individuellement
l’individu pour être libre doit obéir à sa raison (auto / nomie : obéir à
la loi que je me donne), politiquement, c’est à la volonté générale
qu’il doit – en tant qu’être double, nature et raison, sujet et citoyen,
volonté particulière et volonté générale – obéir. La volonté générale n’est
rien d’autre alors que ma volonté en tant que membre du corps politique
- auquel j’appartiens par l’acte raisonné de ma liberté. L’autonomie politique
c’est donc : a) pour chacun l’obéissance à la loi qu’en tant que membre du
peuple (citoyen) je m’impose b) pour le peuple : le fait de s’autodiriger,
soit d’obéir à sa propre volonté.
. La volonté générale c’est donc précisément la volonté
du peuple en tant qu’elle naît de l’union volontaire en un tout de chaque
membre, acte du souverain (le peuple) par lequel ce dernier organise (et
dirige) par la loi l’ordre social, produit d’une histoire que nul n’a
premièrement choisie. La volonté générale est ainsi le moteur qui
permet à la liberté collective des hommes de reprendre les fils d’un destin,
fruit de l’histoire et de l’arbitraire des rapports de force, afin de le
soumettre aux fins d’une raison visant le bien commun.
Conclusion : les principes = ici mis en
place. La pierre de touche de la légitimité est posée.
Doit suivre ensuite une discussion sur les modalités
pratiques d’une telle institution du peuple par lui-même. Comment faire pour
que la volonté générale informe le réel ? Par le biais de quelles institutions
? Quelles sont les conditions (pratiques, historiques) d’une telle direction du
peuple par lui-même ? Quels en sont les obstacles ?
Chapitre VIII : De l’état civil
Il s’agit dans ce chapitre de montrer ce que
l’homme devient et peut devenir dans l’état civil. Deux sens à ce dernier
terme : il s’agit tantôt de cette période qui succède à l’état de nature
par l’institution de lois injustes; tantôt, au contraire, de celle qui est
consécutive au Contrat social. Alors qu’une institution injuste de la société,
si elle fait cependant de l’homme autre chose qu’une bête, en le rendant
capable de raison, peut faire de lui un être abject, une institution juste par
le biais d’une éducation à la liberté peut en faire un homme développé,
libre et puissant, ne se soumettant qu’à ce que la puissance de sa propre
raison lui dicte, un être moral et un citoyen enfin.
Premier §. Rousseau oppose ici globalement état civil
et état de nature, soit ici humanité et animalité = culture et nature. Un tel
passage, irréversible (« pour jamais ») – l’homme n’est
dorénavant plus un simple animal -
engendre de profonds changements en l’homme. Alors que l’animal est
guidé par l’instinct = ancré dans la nature et sa nature pulsionnelle, sans
possibilité de contrôle ni distance, l’homme, parce qu’il a désormais
conscience de lui-même et conscience des autres, parce qu’il peut s’opposer à
ses propres désirs, les maîtriser et les contrôler peut se conduire
selon la justice. Parce qu’il a conscience de lui-même et peut se contrôler,
parce que acteur libre, il devient ainsi responsable de lui-même, ses actions
deviennent susceptibles de moralité – soit d’un jugement selon le Bien
et le Mal, jugement qui n’a aucun sens pour un être dépourvu de distance à soi
(animal). Passage de l’animalité à l’humanité : du simple appétit
(pulsions = passivité et inhérence à soi) à la considération du droit
(considération par la raison de ce que j’ai le droit de faire – quels
que soient, par ailleurs, mes appétits) ; de l’impulsion physique (idem) à
la voix du devoir (possibilité d’entendre ce qu’il faut faire et de se
sentir obligé malgré mes désirs). Alors que l’animal est clos sur
lui-même, ne voit que lui-même, n’agit que pour lui-même (ancrage sans distance
dans ses propres pulsions) sans possibilité de se raisonner et de penser aux
autres, le petit homme socialisé doit rapidement apprendre à se considérer du
point de vue des autres et à guider sa conduite selon le droit et la raison
sans plus agir selon la seule inconscience de ses pulsions
(« penchants » – ce vers quoi spontanément, naturellement je penche).
Que gagne ainsi l’homme à sortir de l’animalité ?
Il perd certes certains avantages – cf. second § - mais s’élève spirituellement
de telle façon que nul ne voudrait véritablement retourner à l’état de
bête : qui voudrait, par exemple, passer sa vie à brouter l’herbe ou à
renifler les crottes de ses congénères ? Lorsque l’homme envie l’animal
c’est soit en y plaçant une part d’humanité (la paix du chat et le sentiment de
la liberté ou bien le Carpe Diem…), soit en oubliant ce à quoi il devrait
renoncer en renonçant à son humanité : sa conscience, sa liberté, sa
finesse, les valeurs auxquelles il tient, l’amour, la musique… Le passage de la nature à la culture (état
civil) est, parce qu’on ne voudrait en toute conscience pour rien au
monde y retourner (tout au moins définitivement), un « instant
heureux » qui marque une élévation, l’élévation du corps naturel à la spiritualité :
passage de l’animalité stupide (comparer l’intelligence animale avec celle d’un
humain moyen) et bornée (limitée = quasi absence de nouveauté,
d’invention, d’imagination) à la conscience de l’homme évolué. « Ses
facultés s’exercent et se développent » : facultés = aptitudes,
pouvoir de = puissances – puissances du corps et de l’esprit
(savoir-faire) : perception, imagination, raisonnement, mémoire mais aussi
nage, musique… / à comparer à la relative non évolutivité des facultés animales.
« Ses idées s’étendent » : conception de l’infini, de
l’éternel et de la totalité / animal réduit à la perception quasi-immédiate.
« Ses sentiments s’ennoblissent » : poétisation des
sentiments, invention de l’amour en ses milles nuances, développement de l’amitié
/ ancrage des affects animaux dans le corps. « Son âme toute entière
s’élève » : ce mouvement qui est passage de la nature à la
culture est perfectionnement et spiritualisation.
Reste cependant, note Rousseau, que l’homme peut être
bien pire que plus sauvage des bêtes – sous un ordre injuste, en effet,
entouré de violence, éduqué sous d’iniques et barbares principes,
l’homme peut se dégrader bien en deçà de la bête. Et de fait, les violences de
l’histoire sont de culture et non de nature – massacres, arrachage des enfants
du ventre de leur mère, bestialité, torture, viols… ne sont pas concevables
hors la conscience de la souffrance de l’autre dont l’homme seul sait jouir.
Telle est l’affreuse réalité de l’histoire – sous l’état civil antérieur au
contrat si la moralité et le droit sont désormais possibles (l’homme = être
conscient), c’est l’injustice, le malheur, la violation du droit et l’inégalité
qui règnent parmi les hommes. De là l’enjeu de principes politiques justes –
d’un état civil régi par le contrat – instituant une éducation à la
liberté des hommes visant le développement de leur spiritualité, sens même de
la culture (cf. Hegel, cours Le sens de la vie, I, conclusion).
Second §. Mise en balance de la liberté
naturelle et de la liberté civile (contrat social) : l’homme perd « sa
liberté naturelle et son droit illimité à tout ce qui le tente et qu’il peut
atteindre » – le chien peut gambader où il le désire, ronger tous les
os et sauter sur toutes les chiennes accessibles. Il est la spontanéité
même de l’instinct se déployant à travers des obstacles physiques : telle
est la « liberté naturelle » dont parle Rousseau – liberté en
ce sens que les désirs ne sont pas empêchés par des devoirs, des lois,
des raisons. Cette forme de liberté comme réalisation des pulsions (faire ce
qu’on désire) est pourtant limitée par a) les capacités = forces propres de
l’individu (vitesse, puissance physique, ruse…) ; b) de
l’extérieur, par la résistance des autres forces de la nature (les
prédateurs, les autres membres de l’espèce, la résistance des proies…).
Pourquoi Rousseau parle ici t’il d’un « droit » naturel
« illimité » ? Que de fait, puisque sans frein intérieur,
la liberté naturelle n’ait pas d’autres limites que celles du désir – est un
fait = constatable = les animaux font ce qu’ils désirent, limités par
les seules forces - pourquoi parler ici de « droit » ? Ne
confondons-nous pas ici le droit et la force (chapitre III) ? Rousseau désigne
ici un état antérieur à la parole et à la conscience : parler de
« droit » ne signifie donc pas ici la forme publique qu’il
a en son essence (publique : lorsque je parle de mes droits, je suppose
que l’autre doit le reconnaître – il ne s’agit pas d’une affirmation
privée – cf. communauté de la parole). Mais, du fait qu’aucune norme, aucune
loi ne peut s’opposer au déploiement du désir, le mot « droit »
désigne ici l’absence d’interdits et de normes – hors du champ de
l’interdit et de l’obligation, « il a bien le droit de… », en ce
sens qu’aucun droit (ici public – aucune norme, aucune loi) ne peut s’opposer à
ses mouvements, à ses désirs – mais seulement la force. Aussi ne jugeons-nous
(droit, morale) pas nos animaux mais nous les punissons (force). Reste qu’en
toute rigueur cependant on ne peut parler ici de « droit »
(parce qu’impliquant la référence à une norme) à l’état de nature – il ne
s’agit que du fait d’une puissance privée sans frein intérieur : un
droit naturel ça n’a donc pas de sens – le droit ne naît qu’avec la
parole et l’état civil.
Or c’est une telle « liberté naturelle »
sans frein que l’homme perd en rentrant dans l’état civil. Que gagne t’il donc,
en échange ? Dans la réalité historique (état civil antérieur au contrat)
– qui est celle de la domination arbitraire –
l’homme perd sa liberté naturelle et gagne le droit (ici : la loi -
injuste) de se taire et le devoir d’obéir (droit et devoir qui sont, avons-nous
vu, de faux droits et de faux devoirs – mais qui sont efficaces
par la seule croyance des hommes en leur caractère normatif – aussi les hommes
se prosternent-ils devant des dieux et des maîtres…). On comprend ainsi qu’en
d’autres lieux, Rousseau fasse l’éloge de la liberté animale – le cheval
capturé se battant pour sortir de ses fers… - quand les hommes dans les fers
lèchent les bottes des puissants. Reste cependant que l’état civil parce qu’il
instaure la parole et la référence au droit rend possible un état civil
juste régi par le contrat. Ce que gagne alors celui qui vit dans un état civil
juste (ce que vise, en ces lignes, Rousseau) c’est une liberté civile et la
propriété de ses biens (sur la propriété et les problèmes qui lui sont liés,
cf. chap. IX). La liberté naturelle parce qu’elle est privée n’a pour limite
que la force individuelle et l’opposition des autres forces. Or c’est,
avons-nous vu, l’opposition des forces engendrant la guerre de tous contre tous
qui rend très souhaitable (par pur calcul) le contrat social. Sans droit
et sans loi, la liberté de chacun est menacée par celle de tous les autres, la
possession (le fait d’avoir) par le désir des autres = insécurité et guerre.
C’est premièrement d’un tel état incertain et angoissant que le contrat social
libère les contractants : l’homme acquiert une liberté civile
reconnaissant désormais la volonté des autres, la justice de la loi et des
forces légitimes qui la maintiennent, en autolimitant par raison sa
« liberté naturelle ». C’est alors la force de tous unifiée
en volonté générale (publique) qui garantit et défend, par la justice de la
loi, sa sécurité, sa propriété et sa liberté civile.
Troisième §. Reste que l’on pourrait préférer
– cf. analyse du chap. VI, § 3-4 – jouir de la liberté naturelle tout en ayant
les avantages de la liberté civile (protection par la loi). C’est le cas de
Gygès (Cf. cours sur la morale, Platon, La République). Le contrat
social serait donc un pis-aller (je veux les lois pour réaliser mes désirs –
mais je préférerais ne pas me limiter bien que je reconnaisse que c’est
impossible). La pleine liberté est ainsi ici assimilée au déferlement des
désirs. Mais peut-on appeler liberté ce qui n’est pas maîtrisé, pesé, jugé par
un être conscient et maître de soi ? La spontanéité de la liberté
naturelle pose, en effet, Rousseau parce qu’elle survient comme surviennent les
pulsions est une forme d’esclavage. Si je crois que je suis libre c’est que les
forces de la nature sont ici les forces de ma nature, intérieures à mon
corps avec lesquelles je coïncide – je ne me sens donc pas contraint. Mais
peut-on dire libre l’alcoolique qui désire son énième verre ? L’enfant qui
désire son jouet ? Ou le plus grand cette fille ? Parce qu’ils
surviennent en moi sans qu’un « je » les ai pesés, maîtrisés
et librement choisis, celui qui se soumet au déferlement de ses désirs n’est
pas un être libre, mais, l’analogue de l’animal esclave de ses pulsions. La
« liberté naturelle » dont parle ainsi Rousseau est
enchaînement à la nature.
A contrario en acquérant la conscience de lui-même
(dualité interne), en pouvant se maîtriser et se choisir selon des fins
clairement réfléchies auxquelles il adhère par la force de sa raison, l’homme
acquiert une « liberté morale » - soit la liberté de pouvoir
se guider selon des valeurs librement consenties à la lumière de la raison. Qui
est donc le plus libre de celui qui refuse de violer parce qu’il considère par
raison la liberté de l’autre et ne voudrait pas qu’on fasse de même à sa
place (liberté morale) ? Ou de celui qui viole sans considération
d’autrui (liberté naturelle) ? Parce qu’elle est maîtrise consciente de
soi et possibilité de se choisir en raison, la liberté morale est la
vraie liberté : « car l’impulsion du seul appétit est esclavage et
l’obéissance à la loi qu’on s’est prescrite est liberté ». « On
n’est pas (plus) des bêtes », tout de même…
Tableau
résumant le chapitre VIII

Chapitre IX : Du domaine réel (propriété
des choses et des biens)
Question centrale de la propriété et de l’inégalité
économique : la question de la justice sociale = de l’égalité et de
l’inégalité légitimes opposées à la simple inégalité économique de fait
garantie par la loi. Rappel : le faux contrat du discours sur l’origine
de l’inégalité : la loi institutionnalise un ordre de fait en
transformant l’usurpation, produit de l’arbitraire de rapports de force
historiques en rapports juridiques garantis par la loi. Mais un tel ordre de la
loi ne fait pas pour autant droit. Sur quoi peut donc se fonder une
égalité ou une inégalité de possession de telle façon qu’elle devienne égalité
ou inégalité de droit = légitime = juste?
Premier §. Rappel du chap. VI, §
6 : le passage de l’état naturel à l’état civil implique l’aliénation totale
des biens et de la personne à l’Etat = redéfinition juridique de chacun
en tant que sujet de droit – pour que ma possession de fait devienne
ainsi propriété (définie juridiquement) c'est-à-dire reconnue par
tous en tant que légitime il faut que je soumette ce que j’ai au jugement
de tous – jugement dont je ne suis pas le maître mais auquel je participe
en tant que citoyen. Cela signifie donc que ce que je peux légitimement
posséder est défini par la volonté générale. C’est ce qui est impliqué lorsque
je dis «j’ai le droit de posséder ceci » : on suppose
que l’autre doit reconnaître ce droit et donc la définition commune et
raisonnable d’un tel droit – dans le cas contraire il faudrait se contenter
d’avoir sans prétendre en plus légitimer une telle possession par le droit.
Mais – chp. III – la force est faible sans le droit : il faut donc que la
force se pare du manteau du droit. D’où dans les faits ce mélange obscur de
fait et de droit qu’est la loi effective : la propriété garantie par la
loi se prétend juste. L’est t’elle et à quelles conditions? Il faut pour
bien comprendre la réponse de Rousseau distinguer non pas deux mais trois
termes : la possession (le pur fait d’avoir), la propriété
en tant que définie par la loi de fait (les titres de propriété garantis
par la force publique = le droit de fait. Ex : je détiens ce château par
héritage et c’est conforme à la loi) : cette dernière n’est du point de
vue de la justice pas nécessairement propriété légitime ; car –
troisième terme – la propriété légitime est propriété reconnue par tous
selon les termes du contrat social (en tant qu’unanimement approuvée sans
contrainte par la seule raison humaine). Or Rousseau dans ce premier § semble
poser que la propriété ne peut sous aucune condition être propriété légitime.
Pourquoi donc ? Premier point : du point de vue de la loi de fait, la
reconnaissance de la possession est un fait public qui transforme juridiquement
la possession en propriété – puisque c’est le souverain qui définit la
propriété, celle-ci lui est donc intégralement soumise (c’est la loi qui dit ce
qui m’appartient, ce qui suppose : a) une appropriation collective par le
souverain ; b) une éventuelle redistribution… cf. le pouvoir des pouvoirs
publics de m’exproprier – marquant la nature publique de ma propriété). Pour
autant une telle «possession publique» n’est pas propriété légitime
(Rousseau dit « propriété »). Cela ne laisse pas d’être
paradoxal puisque Rousseau affirmait plus haut que l’état civil transformait la
possession en propriété – et que, par hypothèse, la collectivisation des biens
est ici conforme au modèle du Contrat Social : la propriété devrait ainsi
être par définition légitime. Rousseau sous-entend ainsi que même redéfinie par
le souverain de droit (le peuple) la possession devient certes propriété en
tant que définie par la loi mais que cette propriété ne saurait être une
propriété légitime. Qu’est-ce qui dans la nature de la possession empêche sa
transformation en propriété légitime? Essentiellement le fait que la
possession est de nature exclusive : détenir un bien et
particulièrement un bien foncier c’est exclure autrui de la possession (et donc
de l’usage) de ce bien (quatrième §) (et donc allons-nous voir, de la
possibilité de vivre). Or sur quoi est fondé une telle appropriation ?
Sur « le droit de premier occupant ». Rousseau va montrer
qu’un tel droit n’est pas un véritable droit, mais, là encore, un coup de force
qui se prétend légitime et se pare du vêtement du droit. L’illégitimité
d’une telle référence au droit est manifeste dans les rapports existants entre
plusieurs pays : hors un droit international garanti par l’existence d’une
force publique supranationale (fondée sur un contrat social à l’échelle
planétaire), ce qui est défini juridiquement comme propriété par l’Etat voisin
à l’intérieur de ses frontières n’est pour un autre Etat que possession de fait
– et ce ne sont que les rapports de force qui empêchent l’appropriation par
l’autre des terres du premier. Cf. le destin des pays sans force armée :
le Tibet face à la Chine, l’impérialisme européen... Les frontières sont le
produit historique d’appropriations de fait excluant par la force d’autres
hommes et peuples de la possession et de l’usage des terres primitivement
communes à l’humanité.
Quatrième §. « Le droit de premier
occupant » n’est qu’une modalité du droit du plus fort car, en un
premier sens, tout aussi arbitraire et illégitime. Image d’un tel faux
droit : Nunez Balboa, conquistador espagnol, qui s’approprie les Terres
d’Amérique latine en y posant son pied. Ainsi des rois de l’histoire. Discours
sur l’origine de l’inégalité : «Le premier qui, ayant enclos un
terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens
assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que
de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs n’eût point
épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé,
eût crié à ses semblables : Gardez-vous d’écouter cet imposteur ;
Vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la
Terre n’appartient à personne […] ». Le fait que ce droit
soit reconnu par les hommes et qu’il devienne dans l’histoire propriété
juridique ne signifie donc pas la légitimité d’un tel fait. L’histoire est, de
ce fait et à nouveau, ce processus obscur où la force se transmute
(illégitimement) en droit (puisque la propriété y est, de fait, reconnue et
défendue). Si on demande ainsi aux Etats et aux individus, l’origine de leur
propriété, c’est à d’obscurs rapports de force que l’on sera ramené. Ainsi de
Robert, le jardinier dans l’Emile, qui exproprie Emile ayant planté des
fèves dans son champ, renvoyant pour toute justification le fait de sa
propriété à l’héritage de son père : mais d’où vient donc a) la première
possession b) la règle de l’héritage ? D’une première appropriation, d’un
premier rapport de force, de hasards historiques – ayant pour caractéristique
d’exclure autrui de l’usage primitivement commun. Prise dans ce processus
d’appropriation, l’histoire est ainsi une guerre perpétuelle pour la possession
et l’extension (individus, Etats). Conséquence : la Terre est quadrillée. Emile :
«Il n’y a plus guère de terre en friche […] et toutes les terres que vous
voyez son occupées depuis longtemps ». Le fait que la Terre soit
quadrillée par des enclos et des frontières engendre une injustifiable (puisque
née de la seule force) inégalité économique entre les hommes : a)
Emile exclu du champ de Robert : «mais moi je n’ai point de jardin».
Robert : «que m’importe ». Réponse donc : pas de
chance, mais c’est ainsi – cynisme des lois qui garantissent sous leur ordre
l’arbitraire d’un pur état de fait. Conséquences : la Terre divisée en
propriétaires et non propriétaires, en riches et en pauvres selon les rapports
de force historiques. b) Mais si une telle division est injustifiable c’est
parce qu’elle fait dépendre la vie des hommes de son arbitraire :
ce de quoi est privé Emile c’est, en effet, de la possibilité de vivre sans
dépendance vis-à-vis d’autrui (voire de vivre tout simplement lorsque nul n’a
besoin de nous – cas de tous ces inadaptés à l’ordre économique, cf. dans notre
pays, annexe de M. Onfray, et bien plus encore dans le reste du monde).
Or comme il faut vivre, celui qui n’a rien (le prolétaire) doit vendre (au
« prix du marché », c'est-à-dire des rapports de force en vigueur) sa
force de travail à celui qui possède (cf. Discours sur l’origine de
l’inégalité). De là l’exploitation de l’homme par l’homme – exploitation
garantie par la loi (puisque, par exemple, la propriété de telle grande firme
dans les mains de quelques actionnaires est garantie par la loi qui la défend
de toute tentative d’appropriation par les travailleurs). On comprend ainsi
cette dénonciation de l’Etat, « instrument de l’exploitation du travail
salarié par le capital » par Engels : «il est, dans la règle,
l’Etat de la classe la plus puissante, de celle qui domine du point de vue
économique et qui, grâce à lui, devient aussi classe politiquement dominante et
acquiert ainsi de nouveaux moyens pour mater et exploiter la classe
dominée » (L’origine de la famille, de la propriété, de l’Etat).
Or – ainsi que nous l’avons longuement vu - la
duplicité de la loi est qu’elle se prétend juste, les droits
effectifs se référant pour être légitimes à leur reconnaissance par la volonté
générale. Peut-on en prenant une telle référence au sérieux (la justice)
penser un modèle de propriété qui – sans être absolument juste, ce qui est
selon Rousseau, par principe impossible (exclusion et propriété) – puisse
néanmoins être plus juste (ou moins injuste), de sorte qu’il soit
possible de transformer les rapports économiques conformément à l’Idée de
justice qui sert de référence à la loi? Autrement dit : peut-on faire que
l’Etat soit autre chose qu’un instrument de domination?
Retour sur les deuxième et troisième § :
Rousseau est ici pragmatique : si le sage peut renoncer pour lui-même à la
propriété (un tel renoncement concerne l’individu et a une valeur morale), ce
serait être fou de penser qu’un peuple puisse devenir un peuple de sage
(« prendre les hommes tels qu’ils sont », préambule). Rousseau
prend donc acte du fait de la propriété. Qu’est-ce qui rend ce fait totalement
illégitime (cas de Nunes Balboa) ? Le fait qu’une telle appropriation est sans
limite et sans référence au besoin et au travail. Ce que cherche en
effet Nunes Balboa et ainsi de tous ceux qui cherchent à s’étendre ce n’est
nullement à vivre, mais c’est à satisfaire leur amour-propre (cf. I.a). D’une
manière générale, montre Rousseau dans le Discours sur l’origine de
l’inégalité, le moteur de la possession n’est nullement le besoin - limité
au corps - mais l’image vaine de sa propre puissance, mouvement par principe
illimité puisque jamais satisfait (cf. cours sur le désir). Or la conséquence
du désir de puissance c’est la division riches/pauvres. Mais – et tel est le
point d’ancrage de la critique - une telle volonté de puissance ne se dit pas
elle-même telle qu’elle est pour elle-même – le riche ne se contente pas
d’avoir, il parle et se justifie ; et la loi effective, en tant que forgée
par la parole des hommes, suppose une telle justification. Quelle est la nature
de cette justification ? Il suffit d’ouvrir un manuel d’économie pour avoir la
réponse (Marx : l’économie politique est la justification idéologique des
rapports de force) : le mérite et donc le travail. Rappelons que selon
l’économie néo-classique (modèle dominant dans les sciences sociales) chaque
individu est supposé détenir des biens à la mesure de son travail et de sa
productivité. Or une telle référence est un piège si on la prend véritablement
au sérieux – aussi ne la prend t’on qu’à-demi au sérieux, juste assez pour
justifier l’ordre existant - car elle délégitime la quasi-totalité de nos possessions.
Si conformément au modèle de la légitimité qu’est le contrat social, on
suppose, en effet, des individus réunis en un peuple et cherchant la juste
répartition des biens entre les hommes (conforme à la volonté générale), le
« droit de premier occupant » ne saurait être un « vrai
droit » - c'est-à-dire reconnu tel par une telle assemblée
hypothétique - qu’en tant qu’il est limité au « nécessaire ».
Pour que la propriété soit reconnue par une telle assemblée, il faut, en effet,
qu’elle ne lèse personne – soit qu’elle ne soit pas un instrument de
domination mais simple moyen nécessaire de vie (quoique qu’absolument
parlant il n’y ait rien ici de nécessaire puisqu’on peut très bien imaginer un
partage des fruits de la Terre sans propriété – ce que fait Rousseau dans le Discours
sur l’origine de l’inégalité et ici-même, § 7). Aussi, parce que la terre
et les biens sont limités et parce que l’appropriation est exclusive, trois
conditions (3ème §) limitent une telle appropriation : a) le
fait « que ce terrain ne soit encore habité par personne » -
ce qui n’est, avons-nous vu, plus le cas, tout terrain étant déjà occupé b) la
limitation de la quantité de terres et de biens appropriés au besoin par
essence limité de l’individu c) le fait que l’individu travaille la
terre possédée. Aussi est-ce le fait qu’il travaille pour vivre et ainsi transforme
à partir de sa propre force pour ses propres besoins le donné matériel qui
peut rendre justifiable l’appropriation (quoique non absolument légitime, cf.
ci-dessus). Nous pouvons ainsi mesurer la distance qui sépare de telles
conditions limitatives de la propriété de la réalité historique où la plupart
des possédants possèdent bien au-delà de leurs besoins et ne travaillent pas
leur terre mais la font travailler – par ceux qui devraient ainsi, selon la
justice (relative), en être les propriétaires : la terre aux paysans, les
entreprises aux travailleurs… il y a tant à l’échelle nationale qu’à l’échelle
mondiale beaucoup de travail à faire.
Plus précisément, nous pouvons établir selon les
principes rousseauiste de la justice sociale une forme de hiérarchie :
a) Puisque nul être ne saurait souscrire
pleinement au contrat si les termes du contrat ne lui permettent pas de vivre
décemment et sans dépendance (position de domination, ce qui ne signifie pas
sans lien) vis-à-vis d’un autre, toute forme d’appropriation privée qui exclut
cette possibilité (mainmise sur la totalité des moyens de production ou des
biens de consommation par une oligarchie d’individus) est illégitime. Moyens
de production et biens de consommation doivent alors être contrôlés par la
puissance publique et les biens distribués de façon à rendre possible la
première condition.
b) Dans la mesure où la première condition est
remplie, le travail assurant la légitimité de la possession, c’est aux
travailleurs et aux collectifs de travailleurs que le produit du travail
doit appartenir – et non à une couche d’exploitants improductifs (ce qui est
effectivement le cas presque partout et à l’échelle mondiale).
c) Enfin, acceptation de la propriété individuelle
dans la mesure où elle ne porte pas préjudice aux deux dernières conditions.
Notons sur ce point encore que la pleine justice de
tels principes ne peut avoir une validité qu’à l’échelle mondiale :
le premier principe serait-il appliqué à l’intérieur de nos frontières, que,
faute de contrat social à l’échelle mondiale, le paysan du tiers-monde en
serait, par exemple, exclu. N’ayant pas souscrit au contrat, il ne peut le
reconnaître comme une norme qui l’oblige.
… Ne vous disais-je pas plus haut que ceux
qui veulent se battre pour la justice avaient encore bien du pain sur la
planche… ?
Conclusion : le modèle rousseauiste de
justice sociale implique ainsi un remodelage des rapports de propriété
entre les hommes (dont l’Etat, notamment par l’imposition, doit être
l’instrument) – idée dont Rousseau n’est pas dupe du caractère profondément
idéaliste mais idée qui, en tant qu’elle est présente de façon sous-jacente au
sein même du discours qui la dénie (le riche se prétend juste et se garantit de
la loi, loi qui n’a de légitimité qu’à se référer à son institution par le
peuple, peuple qui légitime une telle loi sous la condition du respect des
termes du contrat social) est doté de la force même de la parole humaine :
très faible en ce que la parole ne peut rien contre la force, très forte en ce
qu’elle se réfère à un horizon commun de justification dont la force ne
peut se passer, horizon à partir duquel elle peut seule être parole légitime;
horizon que la force doit, tout à la fois, poser et cacher dans une duplicité
qui ne peut pas se dire et qui, c’est sa faiblesse, doit sans cesse avancer
masquée.
Conclusion générale.
. L’idée de contrat renvoie à un difficile
problème : comment concevoir l’Etat de telle manière que l’homme puisse
être pensé comme libre ? Comment, en somme, conjuguer la liberté de
l’homme avec l’obéissance à la loi, sans laquelle il n’y a pas de vie sociale
paisible ? Comment intégrer dans la communauté politique les libertés
individuelles, sans que cette intégration se fasse de façon inégalitaire, les
uns jouissant de droits dont les autres sont privés ?
. Le contrat social de Rousseau n’est ni descriptif ni
explicatif, mais normatif. Il s’agit de déduire a priori les fondements
de l’autorité légitime, en distinguant le droit du fait. Ainsi Rousseau a-t-il
montré qu’on ne peut penser sans contradiction l’idée d’une servitude
volontaire, que l’ordre de fait n’a pas de légitimité naturelle mais qu’il est
fondé sur des conventions, qu’il est du coup impossible de concevoir un droit
d’esclavage et de fonder par là même le droit sur la force. De sorte qu’on
n’est obligé d’obéir qu’aux puissances légitimes.
. Les trois finalités de la vie en société sont la
sécurité des personnes, celle des biens (garantie de la propriété –
problématique, on l’a vu et non absolument nécessaire), ainsi que la
liberté. La société issue du pacte social n’est pas une simple association
d’individus, unis en vue de la préservation de leurs intérêts égoïstes. La société
est une communauté de citoyens qui sont tous membres du corps social et qui ont
en vue le bien commun. La notion de corps a un sens organique. Le pacte social
n’est pas un pacte d’aliénation, par les individus, de leur liberté au profit
de quelque entité politique que ce soit. La liberté est inaliénable; elle est à
la fois le fondement et la finalité de la communauté politique :
s’autodéterminer, être collectivement nos propres maîtres sans obéir à des
puissances illégitimes = déf. de l’autonomie politique.
. Dans le contrat social, en effet, les associés
échangent leur liberté naturelle contre la liberté civile fondée sur la loi. Le
pacte social préserve la liberté des contractants car c’est avec eux-mêmes
qu’ils contractent, et non avec un autre. Chaque membre de la société à venir
contracte avec lui-même dans la mesure où il est déjà membre du corps social en
formation, du tout dont il fait déjà partie. Rousseau distingue donc l’homme en
tant qu’il est un individu privé, avec ses intérêts égoïstes, et le citoyen,
sujet et membre de l’Etat, qui n’obéit qu’à l’intérêt commun et à la volonté
générale. L’opposition brute entre l’un et l’autre doit se réduire par les
bienfaits même de l’état civil (chapitre VIII) à travers l’éducation à la
liberté – le sentiment de ma liberté devenant d’autant plus intense que je suis
entouré d’être libres (communauté de citoyens en dialogue). L’égoïsme asocial
n’est donc pas une fatalité ni une donnée immuable de la nature humaine :
bébé peut devenir grand, libre et puissant (cf. Le sens de la vie, II)
. Le lien social n’est donc pas autre chose que ce qui
forme le bien commun et qui constitue la volonté générale qui est souveraine et
à laquelle nul ne saurait échapper. Celui qui désobéit à la volonté générale se
place de lui-même en dehors du corps politique et rompt le pacte. Il doit être
exclu de la cité et sera contraint,
« on le forcera à être libre ». Si être libre, c’est n’obéir qu’à
soi-même, ce n’est rien d ‘autre qu’agir conformément à ce que la raison dicte.
Dès le moment où, en vertu de la réciprocité du pacte, tous concourent à
égalité à la formation de la volonté générale, il est dès lors raisonnable de
vouloir que tous obéissent à cette volonté générale, quelle que soit l’opinion
particulière que chacun puisse avoir sur telle ou telle question.
. La puissance légitime est celle par laquelle un
peuple se forme comme tel. La démocratie, c’est-à-dire l’organisation
autonome du peuple décidant de son propre destin, est alors l’essence même de
toute organisation politique légitime à l’aune de laquelle doivent être jugés
les régimes politiques de fait, ce qui légitime par ailleurs le soulèvement du
peuple contre les régimes tyranniques.
. Application aux formes politiques contemporaines :
que cette démocratie, cependant, ne soit encore qu’une idée, très partiellement
réalisée, que nous ayons sur ce point encore beaucoup de travail à faire… c’est
ce que donne à penser cet extrait de Rousseau dans le livre III du Contrat
social : « Les
députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne
sont que ses commissaires; ils ne peuvent rien conclure définitivement. Toute
loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle; ce n'est point une
loi. Le peuple Anglais pense être libre, il se trompe fort; il ne l'est que
durant l'élection des membres du parlement: sitôt qu'ils sont élus, il est
esclave, il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en
fait mérite bien qu'il la perde » (Livre III, 15). La situation du peuple anglais de
l’époque de Rousseau est exactement la nôtre : nous serions politiquement
libres une fois tous les cinq ans lorsque nous votons pour nos représentants et
rentrerions dans la servitude pour le reste du temps – soumission à des lois
que nous n’avons ni choisies ni faites, impossibilité de révoquer nos délégués.
A ce titre le philosophe Castoriadis, défenseur d’une démocratie radicale,
rappelle que dans la démocratie directe grecque des 6-5ème siècle
avjc les différents délégués étaient à tout instant révocables par le peuple
lui-même. Encore rappelle t’il qu’une telle liberté d’un jour tous les cinq ans
est, chez nous, on ne peut plus fictive du fait de : a) de la limitation
des choix et des options par des partis en présence ; b) de
l’absence d’éducation politique du peuple, qui suit alors, pour la plupart,
sans réflexion propre les grandes lignes oligarchiquement (oligarchie :
domination par un petit groupe) décidées des partis et des idéologies
dominantes – éducation dont la principale condition est d’avoir du temps
libre hors du celui du travail (en Grèce ancienne, là encore, la cité avait
institué une paye pour tout citoyen assistant et participant aux débats
politiques). Dès lors lorsque le parlement ou le président prétendent parler au
nom du peuple, ne se paye t’on pas singulièrement de mot ? Car ceux qui
parlent – petite oligarchie au sommet de l’Etat - ont désormais – pour
une période donnée – les quasi-plein pouvoirs (modulés certes par les
mécontentements sociaux, mécontentements qui, cependant, sont rarement
politiques c'est-à-dire mus par la conscience citoyenne de l’unité politique et
la volonté de développer un projet commun). Ces constats nous ouvrent à cette
grande tâche – à partir de laquelle seule un peuple pourra se dire libre et ses
institutions justes : réaliser la démocratie en la développant à
travers tout le corps social et jusque dans l’entreprise… Ce n’est pas là la
tâche d’un seul homme, c’est celle de tout un peuple qui, pour cela,
doit vouloir être libre. Si la privatisation de l’homme contemporain,
son intérêt exclusif pour la consommation privée de biens qui suppose
l’acceptation de l’ordre oligopolistique capitaliste mondial, son désintérêt
pour la chose publique… ont de quoi laisser sceptique sur la réalisation d’une
telle tâche… une telle Idée reste, cependant, invincible au fait, car ne
serait-elle jamais réalisée qu’elle ne serait pas moins principe de la
justice, soit la norme véritable de tout droit. Se battre et militer pour
elle vaut donc par soi-même, quelle qu’en soit l’issue, le combat manifestant
la dignité d’hommes libres qui ne veulent pas être dominés mais s’autodiriger.
Si donc le contrat social n’est pas un fait c’est une
Idée (Kant) = un modèle supérieur au fait servant de guide et d’idéal
pour notre pratique, de boussole pour nous orienter à travers le champs
politique. Irréductible au fait, cette Idée :
cependant travaille notre propre histoire en
tant qu’= agie par des hommes qui parlent et se justifient. 1789, le
développement de la base électorale (du suffrage censitaire au suffrage
universel ; du suffrage des hommes au suffrage mixte) ainsi que celui des
droits sociaux – acquis au prix de luttes au nom de la justice – marquent la
présence agissante d’une telle Idée à travers notre histoire (sans qu’il
n’y ait là, cependant, de nécessité – cf. la désaffection contemporaine pour la
politique - tout dépend de la volonté des hommes – irréductible et
incontrôlable – de vouloir être
libres) ;
doit travailler l’histoire pour que
cette dernière ait un sens. Le contrat social n’est rien d’autre qu’un
horizon – pour lequel nous devons lutter, que nous devons développer à
l’intérieur de nos frontières, à l’échelle de l’Europe et à l’échelle mondiale.
Le Contrat social définit l’horizon de rapports justes
entre les hommes, horizon à partir duquel l’humanité pourrait devenir maîtresse
d’elle-même en substituant la liberté et la raison à l’arbitraire abject
des rapports de force dont est tissée l’histoire.
________________________
Textes
complémentaires
« QU’EST-CE QUE LE DROIT ?
Cette question pourrait bien mettre le jurisconsulte
dans l’embarras, à moins qu’il ne veuille tomber dans la tautologie ou, au lieu
de présenter une solution universelle, renvoyer à ce que veulent les lois en un
quelconque pays à une quelconque époque, autant que ce défi auquel on le
provoque embarrasse le logicien : qu’est-ce que la vérité ? Ce
qui est de droit, c'est-à-dire ce que disent ou ont dit les lois en un certain
lieu et à une certaine époque, il peut bien l’indiquer ; mais quant à
savoir si ce qu’elles voulaient était également juste et quel est le critère
universel on peut reconnaître en général le juste aussi bien que l’injuste,
celui lui reste caché s’il n’abandonne pas pour un temps ces principes
empiriques, s’il ne cherche pas la source de ces jugements dans la simple
raison (quoique ces lois puissent parfaitement lui servir en cela de fil
conducteur) afin d’établir le fondement d’une législation positive
possible » (Kant, Métaphysique des mœurs, 1796).
«Je vois, par exemple, que deux fois deux font quatre,
et qu'il faut préférer son ami à son chien ; et je suis certain qu'il n'y a
point d'homme au monde qui ne le puisse voir aussi bien que moi. Or je ne vois
point ces vérités dans l'esprit des autres, comme les autres ne les voient
point dans le mien. Il est donc nécessaire qu'il y ait une Raison universelle
qui m'éclaire, et tout ce qu'il y a d'intelligences. Car si la raison que je
consulte, n'était pas la même qui répond aux Chinois, il est évident que je ne
pourrais pas être aussi assuré que je le suis, que les Chinois voient les mêmes
vérités que je vois. Ainsi la raison que nous consultons quand nous rentrons
dans nous-mêmes, est une raison universelle. Je dis : quand nous rentrons dans
nous-mêmes, car je ne parle pas ici de la raison que suit un homme passionné.
Lorsqu'un homme préfère la vie de son cheval à celle de son cocher, il a ses
raisons, mais ce sont des raisons particulières dont tout homme raisonnable a
horreur. Ce sont des raisons qui dans le fond ne sont pas raisonnables, parce
qu'elles ne sont pas conformes à la souveraine raison, ou à la raison
universelle que tous les hommes consultent.» (Malebranche)
« Si l’intelligence est commune à tous, la raison,
qui fait de nous des êtres raisonnables, nous est aussi commune ; et si
cela est vrai, la raison qui nous prescrit ce qu’il faut faire ou ne pas faire
nous est aussi commune. Si cela est vrai, nous sommes concitoyens ; si cela
est vrai, nous sommes membres d’un même Etat ; et si cela est vrai, le
monde est comme une cité » (Marc Aurèle, Pensées pour moi-même).
(Les Lois de la cité à Socrate :) « Voyons, qu’as-tu à reprocher à nous
et à l’État pour entreprendre de nous détruire ? Tout d’abord, n’est-ce
pas à nous que tu dois la vie et n’est-ce pas sous nos auspices que ton père a
épousé ta mère et t’a engendré ? Parle donc : as-tu quelque chose à
redire à celles d’entre nous qui règlent les mariages ? les trouves-tu
mauvaises ? — Je n’ai rien à y reprendre, dirais-je. — Et à celles qui
président à l’élevage de l’enfant et à son éducation, éducation que tu as reçue
comme les autres ? Avaient-elles tort, celles de nous qui en sont
chargées, de prescrire à ton père de t’instruire dans la musique et la
gymnastique ? — Elles avaient raison, dirais-je. — Bien. Mais après que tu
es né, que tu as été élevé, que tu as été instruit, oserais-tu soutenir d’abord
que tu n’es pas notre enfant et notre esclave, toi et tes ascendants ? Et
s’il en est ainsi, crois-tu avoir les mêmes droits que nous et t’imagines-tu
que tout ce que nous voudrons te faire, tu aies toi-même le droit de nous le
faire à nous ? Quoi donc ? Il n’y avait pas égalité de droits entre
toi et ton père ou ton maître, si par hasard tu en avais un, et il ne t’était
pas permis de lui faire ce qu’il te faisait, ni de lui rendre injure pour
injure, coup pour coup, ni rien de tel ; et à l’égard de la patrie et des
lois, cela te serait permis ! et, si nous voulons te perdre, parce que
nous le trouvons juste, tu pourrais, toi, dans la mesure de tes moyens, tenter
de nous détruire aussi, nous, les lois et ta patrie, et tu prétendrais qu’en
faisant cela, tu ne fais rien que de juste, toi qui pratiques réellement la
vertu ! Qu’est-ce donc que ta sagesse, si tu ne sais pas que la patrie est
plus précieuse, plus respectable, plus sacrée qu’une mère, qu’un père et que
tous les ancêtres, et qu’elle tient un plus haut rang chez les dieux et chez
les hommes sensés ; qu’il faut avoir pour elle, quand elle est en colère,
plus de vénération, de soumission et d’égards que pour un père, et, dans ce
cas, ou la ramener par la persuasion ou faire ce qu’elle ordonne et souffrir en
silence ce qu’elle vous ordonne de souffrir, se laisser frapper ou enchaîner ou
conduire à la guerre pour y être blessé ou tué ; qu’il faut faire tout
cela parce que la justice le veut ainsi ; qu’on ne doit ni céder, ni
reculer, ni abandonner son poste, mais qu’à la guerre, au tribunal et partout
il faut faire ce qu’ordonnent l’État et la patrie, sinon la faire changer
d’idée par des moyens qu’autorise la loi ? Quant à la violence, si elle
est impie à l’égard d’une mère ou d’un père, elle l’est bien davantage encore
envers la patrie. » Que répondrons-nous à cela, Criton ? que les lois
disent la vérité ou non ? » (Platon, Criton).
« Justice, force. - Il est juste que ce qui est
juste soit suivi, il est nécessaire que ce qui est le fort soit suivi. La
justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est
accusée. Il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et, pour cela,
faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort, soit juste. La
justice est sujette à dispute, la force est très reconnaissable et sans
dispute. Ainsi on n’a pu donner la force à la justice, parce que la force
contredit la justice et a dit qu’elle était injuste, et a dit que c’était elle
qui était juste. Et ainsi, ne pouvant faire que ce qui est juste fût fort, on a
fait que ce qui est fort fût juste » (Pascal, Pensées, 298)
«La raison du plus fort est toujours la
meilleure ; Nous l’allons montrer tout à l’heure.
Un Agneau se désaltérait Dans le courant d’une onde
pure. Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure, Et que la faim en ces
lieux attirait. – Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? Dit cet
animal plein de rage : Tu seras châtié de ta témérité. – Sire, répond
l’Agneau, que votre Majesté Ne se mettre pas en colère ; Mais plutôt
qu’elle considère Que je me vas désaltérant Dans le courant, Plus de vingt pas
au-dessous d’elle ; Et que par conséquent, en aucune façon, Je ne puis
troubler sa boisson. – Tu la troubles ! reprit cette bête cruelle ;
Et je sais que de moi tu médis l’an passé. – Comment l’aurais-je fait si je
n’étais pas né ? Reprit l’Agneau. Je tête encore ma mère. – Si ce n’est
toi, c’est donc ton frère ! – Je n’en ai point. – C’est donc quelqu’un des
tiens ; Car vous ne m’épargnez guère, Vous, vos bergers et vos chiens. On
me l’a dit : il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, Le
loup l’emporte, et puis le mange, Sans autre forme de procès. » (La
Fontaine, Fables)
«Un prince doit
s'efforcer de se faire une réputation de bonté, de clémence, de piété, de
fidélité à ses engagements, et de justice ; il doit avoir toutes ces
bonnes qualités mais rester assez maître de soi pour en déployer de contraires,
lorsque cela est expédient. Je pose en fait qu'un prince, et surtout un prince
nouveau, ne peut exercer impunément toutes les vertus, parce que l'intérêt de
sa conservation l'oblige souvent à violer les lois de l'humanité, de la charité
et de la religion. Il doit être d'un caractère facile à se plier aux
différentes circonstances dans lesquelles il peut se trouver. En un mot, il lui
est aussi utile de persévérer dans le bien, lorsqu'il n'y trouve aucun
inconvénient, que de savoir en dévier, lorsque les circonstances l'exigent. Il
doit surtout s'étudier à ne rien dire qui ne respire la bonté, la justice, la
bonne foi et la piété ; mais cette dernière qualité est celle qu'il lui importe le
plus de paraître posséder, parce que les hommes en général jugent plus par
leurs yeux que par aucun des autres sens. Tout homme peut voir ; mais il
est donné à très peu d'hommes de savoir rectifier les erreurs qu'ils commettent
par les yeux. On voit aisément ce qu'un homme paraît être, mais non ce qu'il
est réellement; et ce petit nombre d'esprits pénétrants n'ose contredire la
multitude, qui d'ailleurs a pour elle l'éclat et la force du gouvernement. Or,
quand il s'agit de juger l'intérieur des hommes, et surtout celui des princes,
comme on ne peut avoir recours aux tribunaux, il ne faut s'attacher qu'aux
résultats; le point est de se maintenir dans son autorité; les moyens, quels
qu'ils soient, paraîtront toujours honorables, et seront loués de chacun. Car
le vulgaire se prend toujours aux apparences, et ne juge que par l'événement. »
(Machiavel, Le prince).
«Il m'est arrivé maintes fois d'accompagner mon frère
ou d'autres médecins chez quelque malade qui refusait une drogue ou ne voulait
pas se laisser opérer par le fer et le feu, et là où les exhortations du
médecin restaient vaines, moi je persuadais le malade, par le seul art de la
rhétorique. Qu'un orateur et un médecin aillent ensemble dans la ville que tu
voudras : si une discussion doit s'engager à l'assemblée du peuple ou dans une
réunion quelconque pour décider lequel des deux sera élu comme médecin,
j'affirme que le médecin n'existera pas et que l'orateur sera préféré si cela
lui plaît.
Il en serait de même en face de tout
autre artisan : c'est l'orateur qui se ferait choisir plutôt que n'importe quel
compétiteur ; car il n'est point de sujet sur lequel un homme qui sait la
rhétorique ne puisse parler devant la foule d'une manière plus persuasive que
l'homme de métier, quel qu'il soit. Voilà ce qu'est la rhétorique et ce qu'elle
peut.» (Platon, Gorgias)
«Pour règle générale, toutes les fois qu'on verra tout
le monde tranquille dans un Etat qui se donne le nom de république, on peut
être assuré que la liberté n'y est pas.
Ce qu'on appelle union dans un corps
politique, est une chose très équivoque : la vraie est une union d'harmonie,
qui fait que toutes les parties, quelque opposées qu'elles nous paraissent,
concourent au bien général de la société ; comme des dissonances, dans la
musique, concourent à l'accord total. Il peut y avoir de l'union dans un Etat
où on ne croit voir que du trouble ; c'est-à-dire une harmonie d'où résulte le
bonheur, qui seul est la vraie paix. Il en est comme des parties de cet
univers, éternellement liées par l'action des unes, et la réaction des autres.
Mais, dans l'accord du despotisme (...),
c'est-à-dire de tout gouvernement qui n'est pas modéré, il y a toujours une
division réelle. Le laboureur, l'homme de guerre, le négociant, le magistrat,
le noble, ne sont joints que parce que les uns oppriment les autres sans
résistance : et, si l'on y voit de l'union, ce ne sont pas des citoyens qui
sont unis, mais des corps morts ensevelis les uns auprès des autres.» (Montesquieu,
De l’esprit des lois)
«C’est ainsi
que les plus puissants et les plus misérables, se faisant de leur force ou de
leurs besoins une sorte de droit au bien d’autrui, équivalent, selon eux, à
celui de propriété, l’égalité rompue fut suivie du plus affreux désordre :
c’est ainsi que les usurpations des riches, les brigandages des pauvres, les
passions effrénées de tous étouffant la pitié naturelle, et la voix encore
faible de la justice, rendirent les hommes avares, ambitieux et méchants. Il
s’élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un
conflit perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres. La
société naissante fit place au plus horrible état de guerre : le genre
humain avili et désolé ne pouvant plus retourner sur ses pas ni renoncer aux
acquisitions malheureuses qu’il avait faites et ne travaillant qu’à sa honte,
par l’abus des facultés qui l’honorent, se mit lui-même à la veille de sa
ruine.
Epouvanté d’un mal si nouveau, à la foi riche et
misérable, il ne désire que fuir l’opulence, et ce qu’il avait souhaité
naguère, il le hait (Ovide).
Il
n’est pas possible que les hommes n’aient fait enfin des réflexions sur une
situation aussi misérable, et sur les calamités dont ils étaient accablés. Les
riches surtout durent bientôt sentir combien leur était désavantageuse une
guerre perpétuelle dont ils faisaient seuls tous les frais et dans laquelle le
risque de la vie était commun et celui des biens particulier […] Destitué de
raisons valables pour se justifier, et de forces suffisantes pour se
défendre ; écrasant facilement un particulier mais écrasé lui-même par des
troupes de bandits, seul contre tous, et ne pouvant à cause des jalousies
mutuelles s’unir avec ses égaux contre des ennemis unis par l’espoir commun du
pillage, le riche, pressé par la nécessité, conclut enfin le projet le plus
réfléchi qui soit jamais entré dans l’esprit humain ; ce fut d’employer en
sa faveur les forces mêmes de ceux qui l’attaquaient, de faire ses défenseurs
de ses adversaires, de leur inspirer d’autres maximes, et de leur donner
d’autres institutions qu lui fussent aussi favorables que le droit naturel lui
était contraire.
Dans
cette vue, après avoir exposé à ses voisins l’horreur d’une situation qui les
armait tous les uns contre les autres, qui leur rendait leurs possessions aussi
onéreuses que leurs besoins, et où nul ne trouvait sa sûreté ni dans la
pauvreté ni dans la richesse, il inventa aisément des raisons spécieuses pour
les amener à son but :
« Unissons-nous, leur dit-il, pour garantir de l’oppression les faibles,
contenir les ambitieux, et assurer à chacun la possession de ce qui lui
appartient. Instituons des règlements de justice et de paix auxquels tous
soient obligés de se conformer, qui ne fassent exception de personne ; et
qui réparent en quelque sorte les caprices de la fortune en soumettant
également le puissant et le faible à des devoirs mutuels. En un mot, au lieu de
tourner nos forces contre nous-mêmes, rassemblons-les en un pouvoir suprême qui
nous gouverne selon de sages lois, qui protège et défende tous les membres de
l’association, repousse les ennemis communs et nous maintienne dans une
concorde éternelle. »
Il en
fallut beaucoup moins que l’équivalent de ce discours pour entraîner des hommes
grossiers, faciles à séduire, qui d’ailleurs avaient trop d’affaires à démêler
entre eux pour pouvoir se passer d’arbitre, et trop d’avarice et d’ambition,
pour pouvoir longtemps se passer de maîtres. Tous coururent au-devant de leurs
fers, croyant assurer leur liberté ; car avec assez de raison pour sentir
les avantages d’un établissement politiques, ils n’avaient pas assez d’expérience
pour en prévoir les dangers ; les plus capables de pressentir les abus
étaient précisément ceux qui comptaient d’en profiter, et les sages mêmes
virent qu’il fallait se résoudre à sacrifier une partie de leur liberté à la
conservation de l’autre, comme un blessé se fait couper le bras pour sauver le
reste du corps.
Telle
fut, ou dut être, l’origine de la société et des lois, qui donnèrent de
nouvelles entraves au faible et de nouvelles forces au riche, détruisirent sans
retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la loi de la propriété et de
l’inégalité, d’une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et pour le
profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le genre humain au
travail, à la servitude et à la misère » (Rousseau, Discours sur
l’origine de l’inégalité, 1755)
«... Ce contrat (appelé contractus
originarius ou pactum sociale) en
tant que coalition de chaque volonté particulière et privée dans un peuple en
une volonté générale et publique (visant à une législation d'ordre
uniquement juridique), il n'est en aucune façon nécessaire de le supposer comme
un fait (et il n'est même pas possible de le supposer tel), tout comme s'il
fallait avant tout commencer par prouver par l'histoire qu'un peuple, dans les
droits et les obligations duquel nous sommes entrés à titre de descendants,
avait dû un jour accomplir réellement un tel acte et nous en avoir laissé,
oralement ou par écrit, un avis certain ou un document, permettant de s'estimer
lié à une constitution civile déjà existante. C'est au contraire une simple Idée de la raison, mais elle a une réalité (pratique)
indubitable, en ce sens qu'elle oblige tout législateur à édicter ses lois
comme pouvant avoir émané de la volonté collective de tout un peuple, et à
considérer tout sujet, en tant qu'il veut être citoyen, comme s'il avait concouru à former par son suffrage
une volonté de ce genre. Car telle est la pierre de touche de la légitimité de
toute loi publique. Si en effet cette loi est de telle nature qu'il soit
impossible que tout un peuple puisse y donner son assentiment (si par exemple
elle décrète qu'une classe déterminée de sujets doit avoir héréditairement le privilège de la noblesse), elle
n'est pas juste.» (Kant, Métaphysique des mœurs).