L’art
est-il une évasion ?
Analyse des termes et
ébauche de problématique
Art
a) « Ensemble des procédés
et des œuvres qui portent la marque d’une personnalité, d’un
savoir-faire et d’un talent particulier » (Comte-Sponville). Ici
l’aspect chose de l’œuvre.
b) Ouvrant, à travers le regard qui le perçoit, des
mondes particuliers qui sont les mondes des œuvres. Cette chose
= sens imaginaire.
Evasion
a) S’évader = quitter un lieu qui nous emprisonne
= dans lequel nous ne sommes pas libres – pas chez nous.
b) De là : monde de l’art = monde où nous
serions libres et chez nous? Evasion comme libération.
c) Mais une telle évasion n’est-elle pas illusoire?
Le monde comme ce qu’on ne peut jamais quitter. Second sens : évasion
= imaginaire et illusoire.
d) Mais l’art ne serait-il pas au contraire – par
cette évasion même du monde quotidien – puissance effective, élargissement
du regard et questionnement critique du réel ? Mouvement d’évasion pensé
non comme sortie impossible de soi mais : a) comme transformation
réelle de soi et b) questionnement
problématique et libérateur du réel.
Rapport
de la vie et de l’art :
L’art est-il un refus illusoire du réel ou
bien en nous éloignant de l’irréalité du monde quotidien nous ouvre t’il les
portes d’une vie en vérité?
Introduction
« Tu m’as fait croire que la mer ressemblait à la vaste nappe
d’eau étalée sur tes toiles, si bleue qu’une pierre en y tombant ne peut que se
changer en saphir, que les femmes s’ouvraient et se refermaient comme des fleurs…
Tu m’a menti Wang-Fô, vieil imposteur : le monde n’est qu’un amas de
taches confuses, jetées sur le vide par un peintre insensé, sans cesse effacées
par nos larmes. Le royaume de Han n’est pas le plus beau des royaumes, et je ne
suis pas l’Empereur. Le seul empire sur lequel il vaille la peine de régner est
celui où tu pénètres » (M. Yourcenar, Nouvelles orientales).
Ainsi s’exprime un jeune empereur déçu de ne pas trouver dans le monde qu’il
perçoit la beauté dont il avait goûté la pure intensité dans les toiles du
maître. Là tout n’était « qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté »
(Baudelaire, Invitation au voyage) – ici tout n’est que fuite et
dispersion, mélange bigarré sans ordre ni unité. Ici le monde est vide, vide
d’un sens lumineux qui – tel un soleil rayonnant et irradiant le monde -
ordonnerait la masse confuse des apparences en leur donnant la signification,
la direction et la valeur qui leur manque. L’art est alors promesse, promesse d’évasion
hors de ce monde sans sens, promesse d’une vie transfigurée et libérée de ses
chaînes. Mais, découvrant l’irréalité d’une telle promesse, le jeune empereur
semble être condamné à vivre une vie à jamais scindée entre un réel sans
goût et de nul parfum et le rêve d’un ailleurs dont il ne peut qu’effleurer
– sans jamais pouvoir le vivre - l’irréel spectacle à travers les œuvres de
l’art. Dès lors le monde de l’art en nous promettant un tel Ciel où nous ne
saurions vivre et une Terre plus bleue n’est-il pas le voile mensonger et
trompeur de la vie sur elle-même ? La vie blessée et insatisfaite ne
cherche t’elle pas dans l’art à s’évader d’un caveau auquel elle est
rivée ? En ce sens l’évasion ne serait comme le jeu, qu’illusoire distraction.
Mais un tel divertissement de ce que nous nommons réel, n’est-il qu’un moyen de
nous en éloigner ? En nous évadant d’un rapport au réel peut-être
illusoirement posé comme unique et véritable, l’art – sans nous promettre
nécessairement telle Terre plus bleue et lumineuse - n’a-t-il pas aussi pour
vocation d’ouvrir notre regard et nos propres puissances en nous faisant
percevoir que la vie et la réalité n’étaient pas en ces lieux communs en
lesquels nous les posions ? L’art est-il donc un refus illusoire du réel
ou bien en nous éloignant de l’irréalité du monde quotidien
nous ouvre t’il les portes d’une vie plus vraie et intense ?
Dans un premier temps nous montrerons que l’art en rompant avec notre
monde quotidien est promesse d’une évasion vers quelque autre monde plus
dense et plus vrai. Cependant, dans un deuxième temps, nous porterons le
soupçon sur la nature d’une telle évasion, qui loin d’être réelle libération
nous apparaîtra comme évasion rêvée et ainsi illusoire s’enracinant dans un
refus d’un réel auquel nous sommes pourtant rivés. Enfin, si une telle critique
touche, en effet, une certaine pratique que nous faisons d’un art qui nous
divertit de vivre notre vie, nous montrerons que ce dernier a, néanmoins, pour
vocation non de nous faire vivre dans l’illusion mais de nous transformer en
changeant notre regard, dans un mouvement de libération et d’enrichissement
de nos puissances créatrices.
I L’art
est rupture vis-à-vis de notre monde et promesse d’une libération – évasion réelle vers un
monde plus vrai
a) L’expérience esthétique comme rupture du monde
quotidien
Lecture d’un texte de Sartre relatant l’expérience que nous faisons des
œuvres comme rupture de notre monde commun et épreuve d’une profondeur qui nous
élève et nous transporte.
Sartre, La
nausée, Éd. Gallimard
1938, p. 34. (Journal : Vendredi.)
Quand la patronne
fait des courses, c'est son cousin qui la remplace au comptoir. Il s'appelle
Adolphe. J'ai commencé à le regarder en m'asseyant et j'ai continué parce que
je ne pouvais pas tourner la tête. Il est en bras de chemise, avec des
bretelles mauves; il a roulé les manches de sa chemise jusqu'au-dessus du
coude. Les bretelles se voient à peine sur la chemise bleue, elles sont tout
effacées, enfouies dans le bleu, mais c'est de la fausse humilité : en fait,
elles ne se laissent pas oublier, elles m'agacent par leur entêtement de
moutons, comme si, parties pour devenir violettes, elles s'étaient arrêtées en
route sans abandonner leurs prétentions. On a envie de leur dire : « Allez-y,
devenez violettes et qu'on n'en parle plus. »
Mais non, elles restent en suspens, butées dans leur effort inachevé.
Parfois le bleu qui les entoure glisse sur elles et les recouvre tout à fait :
je reste un instant sans les voir. Mais ce n'est qu'une vague, bientôt le bleu
pâlit par places et je vois réapparaître des îlots d'un mauve hésitant, qui
s'élargissent, se rejoignent et reconstituent les bretelles. Le cousin Adolphe
n'a pas d'yeux : ses paupières gonflées et retroussées s'ouvrent tout juste un
peu sur du blanc. Il sourit d'un air endormi ; de temps à autre il s'ébroue,
jappe et se débat faiblement, comme un chien qui rêve.
Sa chemise de coton bleu se détache joyeusement sur un mur chocolat. Ça
aussi ça donne la Nausée. Ou plutôt c'est la Nausée. La Nausée n'est pas en moi
: je la ressens là-bas sur le mur, sur les bretelles, partout autour de moi.
Elle ne fait qu'un avec le café, c'est moi qui suis en elle.
A ma droite, le paquet tiède se met à bruire, il agite ses paires de
bras.
« Tiens, le voilà ton atout. -Qu'est-ce que c'est l'atout? » Grande échine noire courbée sur le jeu : «
Hahaha! » « Quoi? Voilà l'atout, il
vient de le jouer. » « Je ne sais pas, je n'ai pas vu... » « Si, maintenant je viens de jouer atout. » « Ah bon, alors atout cœur. » Il chantonne : « A tout cœur, A tout cœur.
» Parlé : « Qu'est-ce que c'est,
Monsieur? Qu’est-ce que c'est, Monsieur ? Je prends ! »
De nouveau, le silence - le goût de sucre de l'air, dans mon
arrière-bouche. Les odeurs. Les bretelles.
Le cousin s'est levé, il a fait quelques pas, il a mis ses mains
derrière son dos, il sourit, il lève la tête et se renverse en arrière, sur
l'extrémité des talons. En cette position, il s'endort. Il est là, oscillant,
il sourit toujours, ses joues tremblent. Il va tomber. Il s'incline en arrière,
s'incline, s'incline, la face entièrement tournée vers le plafond, puis, au
moment de tomber, il se rattrape adroitement au rebord du comptoir et rétablit
son équilibre. Après quoi, il recommence. J'en ai assez, j'appelle la serveuse
:
« Madeleine, jouez-moi un air, au phono, vous serez gentille. Celui
qui me plaît, vous savez : Some of these days. »
« Oui, mais ça va peut-être ennuyer ces messieurs ; ces messieurs
n'aiment pas la musique, quand ils font leur partie. Ah, je vais leur demander.
»
Je fais un gros effort et je tourne la tête. Ils sont quatre. Elle se
penche sur un vieillard pourpre qui porte au bout du nez un lorgnon cerclé de
noir. Il cache son jeu contre sa poitrine et me jette un regard par en dessous.
« Faites donc, Monsieur. »
Sourires. Il a les dents pourries. Ce n'est pas à lui qu'appartient la
main rouge, c'est à son voisin, un type à moustaches noires. Ce type à
moustaches possède d´immenses narines, qui pourraient pomper de l'air pour
toute une famille et qui lui mangent la moitié du visage, mais, malgré cela, il
respire par la bouche en haletant un peu. Il y a aussi avec eux un jeune homme
à tête de chien. Je ne distingue pas le quatrième joueur.
Les cartes tombent sur le tapis de laine, en tournoyant. Puis des mains
aux doigts bagués viennent les ramasser, grattant le tapis de leurs ongles. Les
mains font des taches blanches sur le tapis, elles ont l'air soufflé et
poussiéreux. Il tombe toujours d'autres cartes, les mains vont et viennent.
Quelle drôle d'occupation : ça n'a pas l'air d'un jeu, ni d'un rite, ni d'une
habitude. Je crois qu'ils font ça pour remplir le temps, tout simplement. Mais
le temps est trop large, il ne se laisse pas remplir. Tout ce qu'on y plonge
s'amollit et s'étire. Ce geste, par exemple, de la main rouge, qui ramasse les
cartes en trébuchant : il est tout flasque. Il faudrait le découdre et tailler
dedans.
Madeleine tourne la manivelle du phonographe. Pourvu qu'elle ne se soit
pas trompée, qu'elle n'ait pas mis, comme l'autre jour, le grand air de
Cavalleria Rusticana. Mais non, c'est bien ça, je reconnais l'air dès les
premières mesures. C'est un vieux rag-time avec refrain chanté. Je l'ai entendu
siffler en 1917 par des soldats américains dans les rues de La Rochelle. Il
doit dater d'avant-guerre. Mais l'enregistrement est beaucoup plus récent. Tout
de même, c'est le plus vieux disque de la collection, un disque Pathé pour
aiguille à saphir.
Tout à l'heure viendra le refrain : c'est lui surtout que j'aime et la
manière abrupte dont il se jette en avant, comme une falaise contre la mer.
Pour l'instant, c'est le jazz qui joue ; il n'y a pas de mélodie, juste des
notes, une myriade de petites secousses. Elles ne connaissent pas de repos, un
ordre inflexible les fait naître et les détruit, sans leur laisser jamais le
loisir de se reprendre, d'exister pour soi. Elles courent, elles se pressent,
elles me frappent au passage d'un coup sec et s'anéantissent. J'aimerais bien
les retenir, mais je sais que, si j'arrivais à en arrêter une, il ne resterait
plus entre mes doigts qu'un son canaille et languissant. Il faut que j'accepte
leur mort ; cette mort, je dois même la vouloir : je connais peu d'impressions
plus âpres ni plus fortes.
Je commence à me réchauffer, à me sentir heureux. Ça n'est encore rien
d'extraordinaire, c'est un petit bonheur de Nausée : il s'étale au fond de la
flaque visqueuse, au fond de notre temps - le temps des bretelles mauves et des
banquettes défoncées -, il est fait d'instants larges et mous, qui
s'agrandissent par les bords en tache d'huile. A peine né, il est déjà vieux,
il me semble que je le connais depuis vingt ans.
II y a un autre bonheur : au dehors, il y a
cette bande d'acier, l'étroite durée de la musique, qui traverse notre temps de
part en part, et le refuse et le déchire de ses sèches petites pointes ; il y a
un autre temps.
« Monsieur Randu joue cœur, tu mets le manillon.»
La voix glisse et disparaît. Rien ne mord sur le ruban d'acier, ni la
porte qui s'ouvre, ni la bouffée d'air froid qui se coule sur mes genoux, ni
l'arrivée du vétérinaire avec sa petite fille : la musique perce ces formes
vagues et passe au travers. A peine assise, la petite fille a été saisie : elle
se tient raide, les yeux grands ouverts ; elle écoute, en frottant la table de
son poing.
Quelques secondes encore et la négresse va chanter. Ça semble
inévitable, si forte est la nécessité de cette musique : rien ne peut
l'interrompre, rien qui vienne de ce temps où le monde est affalé ; elle
cessera d'elle-même, par ordre. Si j'aime cette belle voix, c'est surtout pour
ça : ce n'est ni pour son ampleur ni pour sa tristesse, c'est qu'elle est
l'événement que tant de notes ont préparé, de si loin, en mourant pour qu'il
naisse. Et pourtant je suis inquiet ; il faudrait si peu de chose pour que le
disque s'arrête : qu'un ressort se brise, que le cousin Adolphe ait un caprice.
Comme il est étrange, comme il est émouvant que cette dureté soit si fragile.
Rien ne peut l'interrompre et tout peut la briser.
Le dernier accord s'est anéanti. Dans le bref silence qui suit, je sens fortement
que ça y est, que quelque chose est arrivé.
Silence.
Some of these days
You'll miss me honey
Ce qui vient d'arriver, c'est que la Nausée a disparu. Quand la voix
s'est élevée, dans le silence, j'ai senti mon corps se durcir et la Nausée
s'est évanouie. D'un coup : c'était presque pénible de devenir ainsi tout dur,
tout rutilant. En même temps la durée de la musique se dilatait, s'enflait
comme une trombe. Elle emplissait la salle de sa transparence métallique, en
écrasant contre les murs notre temps misérable. Je suis dans la musique.
Dans les glaces roulent des globes de feu ; des anneaux de fumée les encerclent
et tournent, voilant et dévoilant le dur sourire de la lumière. Mon verre de
bière s'est rapetissé, il se tasse sur la table : il a l'air dense, indispensable.
Je veux le prendre et le soupeser, j'étends la main... Mon Dieu ! C'est ça surtout
qui a changé, ce sont mes gestes. Ce mouvement de mon bras s'est développé
comme un thème majestueux, il a glissé le long du chant de la négresse; il m'a
semblé que je dansais.
Le visage
d'Adolphe est là, posé contre le mur chocolat ; il a l'air tout proche. Au
moment où ma main se refermait; j'ai vu sa tête ; elle avait l'évidence, la nécessité
d'une conclusion. Je presse mes doigts contre le verre, je regarde Adolphe :
je suis heureux.
Analyse :
1) «Il y a » (Lévinas). Il y a le monde plat
comme une crêpe, lourd, sans sens (cf. description : dispersion,
contingence, indifférence, sans goût ; le temps comme horizon de
répétition morne et infini) – la
banalité insoutenable de la vie.
Sartre : la nausée = une certaine modalité du désir : l’ennui
qui colore le monde et l’impossibilité d’en sortir. Tout est le même, rien ne
ressort. Nous sommes «englués dans l’être » (Sartre). Ce sentiment d’être
rivé à un sol à jamais insipide, un monde sans profondeur, cette
absence de distance, de souffle dans lequel pourrait s’engorger notre désir,
c’est ce qui est le propre de la nausée.
« L’état nauséabond qui précède le vomissement et dont le
vomissement va nous délivrer nous enferme de partout. Mais il ne vient pas nous
enfermer du dehors. Nous sommes soulevés de l’intérieur ; le fond de
nous-mêmes étouffe sous nous-mêmes ; nous avons « mal au
cœur » (…) Il y a dans la nausée un refus d’y demeurer, un effort
d’en sortir. Mais cet effort est d’ores et déjà caractérisé comme
désespéré : il l’est en tout cas pour toute tentative d’agir ou de penser.
Et ce désespoir, ce fait d’être rivé constitue toute l’angoisse de la
nausée. Dans la nausée, qui est une impossibilité d’être ce qu’on est,
on est en même temps rivé à soi-même, enserré dans un cercle étroit qui étouffe »
(Lévinas, De l’évasion, p. 115 – 116).
Alors nous
sentons que nous sommes tant étranger à ce monde que rivé à lui.
2) Or c’est cet état premier que l’expérience de la contemplation
esthétique vient briser. La musique se révèle à moi (passivité) comme ce
qui brise cet univers de
l’ « il y a » et le creuse d’une profondeur.
Alors se révèle à moi ce qui vaut, une profondeur qui éclaire ce
petit monde – et me fait échapper au non-sens quotidien. L’art en ce
sens est bien une évasion mais une évasion vers quoi?
b) L’art est la révélation d’un autre monde
Sartre :
«II y a un autre bonheur : au dehors, il y a cette bande d'acier,
l'étroite durée de la musique, qui traverse notre temps de part en part, et le
refuse et le déchire de ses sèches petites pointes ; il y a un autre
temps ».
Evidence : rencontre (passivité); quelque chose s’est creusé
dans la morne identité du monde. Là quelque chose s’est révélé, quelque
chose de dense, quelque chose de profond, quelque chose qui contraste si
fort avec le reste du monde qu’il semble venu d’ailleurs. Comment
pourrait-il venir de notre monde alors que celui-ci n’est que morne et stérile
répétition absurde?
De là cette réponse : le contenu de l’art c’est ce qui transcende
notre monde, c’est un autre monde plus vrai et plus beau que le
nôtre dont l’œuvre est le reflet et dont nous goûtons les miettes – miettes du
pain des anges.
Sur cette révélation d’un ailleurs plus profond apparaissant
comme la source même de l’œuvre :
« Au-dessus de la vie, au-dessus du
bonheur, il y a quelque chose de bleu et d’incandescent, un grand ciel immuable
et subtil dont les rayonnements qui nous arrivent suffisent à animer des
mondes. La splendeur du génie n’est que le reflet pâle de ce verbe caché »
(Flaubert, Correspondance).
« Là, ô mon âme, au plus haut ciel
guidée,
Tu y pourras reconnaître l’idée
De la beauté qu’en ce monde j’adore »
(Joachim du Bellay).
« La peinture a pour ainsi dire son
soleil qui n’est pas celui de l’univers »
(Diderot, sur l’art de peindre »
« Tout y parlerait
A l’âme en secret
Sa douce langue natale »
(Baudelaire, Invitation au voyage).
« L’homme siège au conseil qui créa
l’univers
Où l’âme remontant à sa grande origine
Sent qu’elle est une part de l’essence
divine » (Chénier).
« Astre dont le Soleil n’est que l’ombre
grossière
Sacré jour dont le jour emprunte sa
clarté » (Racine).
Le secret du surréalisme « tient dans le
fait que nous sommes persuadés que quelque chose est caché derrière les objets
visibles » (A. Breton).
Quel est donc le rapport entre ce monde transcendant et lumineux et
notre monde quotidien et comment accéder à un tel monde? Ou comment faire de
notre évasion une libération?
c) Métaphysique de la libération
De cette réalité transcendante nous sommes séparés. Aussi, êtres
de deux mondes (corps et âme, matière et esprit) sommes-nous nostalgiques
d’un tel pays dont nous ne connaissons que le reflet et les traces.
« La vraie vie est ailleurs »
(Rimbaud)
« Misérable, et je vis, et je soutiens la
vue
De ce sacré Soleil dont je suis
descendue »
(Phèdre, Racine)
« Quand nous en irons-nous où vous êtes,
colombes,
Où sont les enfants morts et les printemps
enfuis,
Et les chères amours dont nous sommes les
tombes
Et toutes les clartés dont nous sommes les
nuits » (Hugo).
Le poète, quant à lui, est plus proche de l’Origine de laquelle il s’approche
par l’élan inspiré de son imagination et détache pour nous des miettes du pain
des dieux – que nous goûtons et grâce auquel nous nous sentons croître
(élévation). Modèle de Platon dans le Phèdre.
« Ce n’est pas l’art mais une force
divine qui leur inspire leurs vers » (Platon, Ion)
« Quiconque approche des portes de la
poésie sans que les Muses lui aient soufflé le délire, persuadé que l’art
suffit pour faire de lui un bon poète, celui-là reste loin de la perfection, et
la poésie du bon sens est éclipsée par la poésie de l’inspiration »
(Platon, Phèdre)
« La musique dans les choses sensibles
est créée par une musique qui leur est antérieure » (Plotin, Ennéades, V,
8).
Nul ne saurait se dire poète « s’il ne
sent pas du ciel l’influence secrète » (Boileau)
« Je dis qu’il faut être voyant, se
faire voyant. Le poète se fait voyant par un long, immense et irraisonné
dérèglement de tous les sens. Toutes les formes d’amour, de souffrance, de
folie ; il cherche lui-même, il épuise en lui tous les poisons, pour n’en
garder que les quintessences. Ineffable torture où il a besoin de toute la foi,
de toute la force surhumaine, où il devient entre tous le grand malade, le
grand criminel, le grand maudit – et le suprême Savant ! »
(Rimbaud, lettre à Paul Demeny, datée du 15
mai 1871).
Tentons de mettre en image les intuitions qui se révèlent à travers ces
poèmes : imaginons ainsi un
grand Soleil rayonnant, le Principe ontologique qui fait que les œuvres sont
œuvres, que les artistes sont artistes, que les regards voient l’œuvre. C’est
notre Origine, l’absolu transcendant, l’Un-Beau-Véritable, ce vers quoi
notre désir nous attire – et dont nous gardons en nous la trace.
L’Un rayonne à travers les
œuvres, les artistes et les regards. Il faut concevoir les œuvres comme autant
d’astres – plus ou moins éloignés - dont la source est le grand Soleil, l’Astre
dont tous les astres ne sont que le reflet.
Or à ce monde nous sommes liés et de ce monde séparés –
plus ou moins – voile plus ou moins léger. Liés : origine métaphysique qui
explique notre désir. Et séparés : chute. Nous, être de deux mondes,
avons à nous faire poète et artiste – ou à goûter leurs œuvres = une évasion
qui est libération vers quelque ciel plus bleu, notre être véritable, notre
véritable patrie. Et, en effet, c’est bien là-bas que nous
respirons.
Conclusion – transition
Mais l’expérience de l’art n’est-elle pas vouée à la déception? Car le
fait est que ce monde plus lumineux que l’art nous promet n’existe jamais pour
nous que visé et absent – si bien que, tel le jeune empereur de M.
Yourcenar, dégrisé des images du poète, nous retournons sans cesse au même
monde, vide et plat, que nous espérions quitter. N’est-ce pas ici le signe que
ce monde de lumière n’est qu’un monde rêvé ? Dès lors si l’art est évasion
ne l’est t’il pas simplement qu’en ce qu’il nous divertit du réel de nous-mêmes
et non en ce qu’il serait l’instrument d’une vraie libération.
II Une
telle évasion est évasion imaginaire – le monde de l’art est un monde joué
L’artiste, tout ainsi que le philosophe, est, en effet, souvent
considéré par le sens commun comme un doux rêveur, un homme qui vit « dans
son monde », monde imaginaire oublieux de la réalité. C’est un « distrait »,
un « idéaliste » dit Bergson. Ce qu’il offre aux autres hommes
ce n’est alors que le produit plaisant de ses songes – œuvre d’imagination que
les spectateurs, mettant pour un temps le réel de côté, vont à leur tour
goûter.
a) L’œuvre ne se donne qu’à un regard qui joue à
irréaliser le monde alentour
C’est qu’en effet, l’œuvre d’art ne se donne qu’à un regard (ou une
écoute) qui a déréalisé son rapport au monde. Cf. un tableau :
alors que du point de vue de ma perception, le tableau est dans la pièce, il
faut pour le percevoir comme tableau que j’irréalise – comme s’il n’existaient
pas – tant le mur que tout ce qui entoure le tableau, pour ne décider que de
voir ce qu’il représente. Je fais comme si le reste n’existait pas – et
c’est la condition pour que je rentre dans le monde imaginaire présenté sur la
toile. De même / la lecture : où il faut que les signes sur le papier
soient oubliés, mis de côté – ainsi que le lieu où je me trouve en irréalisant
le monde alentour dans tel univers de chevalerie ou de science fiction. Alors
on peut dire « il est dans son monde », monde imaginaire porté
par une certaine attention de notre regard / monde duquel nous chutons lorsque
par exemple on nous appelle pour le dîner, alors le monde imaginaire disparaît,
les signes sur la page redeviennent graffitis, le livre est sur le lit et le
lit dans la pièce où on m’appelle – nous retombons dans le monde commun, nous
« revenons sur Terre ».
A la différence du rêve toutefois, le regard esthétique est une
déréalisation feinte – bien qu’absorbés dans l’œuvre contemplée, nous savons
que nous sommes en train de lire, d’écouter de la musique ou au théâtre. Le
réel n’est donc nullement quitté, mais simplement ajourné, toujours présent à
la marge de la conscience qui joue comme si le réel était musique ou
peinture. De la même manière que l’enfant qui joue avec son bâton sait très
bien que ce qu’il prend pour une épée n’est en réalité qu’un bâton, dans la
contemplation des œuvres nous ne quittons le monde qu’en imagination. Ce qui
explique d’ailleurs que, pour qui se refuse à un tel jeu avec le réel, l’œuvre
d’art n’est rien qu’un morceau de notre monde et non l’ouverture d’un monde
imaginaire. Or une telle analogie avec le jeu éclaire la nature du désir
qui nous porte vers les œuvres d’arts : car pourquoi jouons-nous ainsi?
b) L’art est conjuration imaginaire d’un réel qui
fait souffrir.
Freud a montré quelle était la fonction affective du jeu. Avec le rêve
et le fantasme, le jeu est, en effet, l’un des trois éléments centraux de notre
vie imaginaire. Or chacun d’eux vise, selon une modalité particulière, à
satisfaire un désir qu’il n’a pu réaliser. Ainsi dans Au-delà du principe de
plaisir, Freud analyse t’il le jeu d’un enfant lançant et tirant une bobine
de fil en prononçant successivement «fort-da » (ici, là) comme une manière
pour lui de maîtriser imaginairement l’absence et le retour de sa mère
vis-à-vis desquels il n’a nul pouvoir réel. Il redevient actif par les gestes
imaginairement sensés du jeu là où dans la réalité il est impuissant et frustré.
Ainsi l’enfant qui joue « se crée un monde à lui, ou plus exactement,
il transpose les choses du monde où il vit dans un ordre nouveau tout à sa
convenance » (Freud).
Or, écrit Freud, l’œuvre d’art
est « une continuation et un substitut du jeu enfantin d’autrefois »
(Essais de psychanalyse appliquée). « Le poète fait, en
effet, comme l’enfant qui joue », il maîtrise imaginairement par la
création d’un substitut imaginaire – l’œuvre - sa frustration réelle. Aussi
est-ce pourquoi, écrit Mélanie Klein, la nécessité de créer se fait souvent
sentir dans des situations douloureuses. « A ce stade du deuil, la
souffrance peut devenir productive. Nous savons que les expériences
douloureuses, quelles qu’elles soient, stimulent quelquefois les sublimations,
ou font même apparaître des aptitudes tout à fait nouvelles chez certaines
personnes : celles-ci se mettent alors à peindre ou à écrire, sous la
pression des épreuves et des frustrations » (Essais de psychanalyse).
Si l’on joue, si l’on imagine, si l’on crée c’est donc que la réalité ne
correspond pas à nos désirs ou, dit prosaïquement, que l’on n’est pas bien
chez soi. Aussi l’artiste est-il celui qui crée du sublime pour conjurer son
incapacité à vivre dans un réel qui n’est pas à la mesure de son désir. A ce titre
l’art est bien évasion mais évasion imaginaire et jouée d’un réel auquel
nous sommes rivés.
c) L’illusion d’une évasion possible
Or, ainsi que nous le montre
l’exemple du jeune empereur qui s’y est laissé prendre et que nous
l’avons vu en notre première partie, l’art ne se donne pas en une telle origine
dans le bas-fond de notre souffrance et de nos frustrations mais comme une
émanation de quelque ciel plus bleu. L’expérience que nous faisons des œuvres
qui nous émeuvent puissamment est, en effet, celle d’une « vraie vie »,
plus claire, plus vraie, plus dense, annoncée et effleurée au travers de
l’épreuve que nous faisons de l’œuvre – expérience si forte, qu’un artiste
pourra passer sa vie à en chercher et à en dire les signes. L’art est alors
promesse d’une libération et de vie véritable.
Mais ce dont il faut rendre
compte c’est, tout d’abord, du fait que cette réalité céleste figurée dans les
œuvres n’y est jamais que figurée et effleurée. Or une telle réalité,
nous ne pouvons jamais la posséder, nous arrêter en elle : elle n’existe
pour nous que par l’arrêt dans notre action, dans la mise à l’écart par
l’imagination du fond réel de la vie, et dans cette visée particulière que nous
avons reconnue être celle d’un jeu. Même si la Messe en si peut avoir
pour nous les couleurs de la « vraie vie », c’est dans son absence
à notre monde commun qu’elle se donne à nous comme cette musique des anges. Dès
lors ne nous faut-il pas conclure avec Rousseau qu’ «il n’y a rien de beau
que ce qui n’est pas » (Rousseau), la beauté des œuvres n’étant qu’un
horizon à jamais éloigné porté par notre désir de rompre avec le pathétique de
notre vie ? L’illusion constitutive de l’art serait alors de nous faire
croire qu’une évasion est possible – alors que la beauté ne se donne que
dans l’absence, sur fond de manque et de souffrance. Dès lors ce sortilège
enchanté de l’art n’est-il pas la marque de notre refus de voir ce qui
est, masques et baumes illusoires posés sur notre vie ? C’est là ce
que suggère, en effet, Céline – opposant à ce monde enchanté de l’art l’âpre
dureté de notre réalité.
Sur Musyne, racontant la guerre en la parant
de notes héroïques : « Elle possédait le don de mettre ses trouvailles dans
un certain lointain dramatique où tout devenait et demeurait précieux et
pénétrant (…) Elle travaillait dans l’éternel, ma belle. Il faut croire Claude
Lorrain, les premiers plans d’un tableau sont souvent répugnants et l’art exige
qu’on situe l’intérêt de l’œuvre dans les lointains, dans l’insaisissable, là
où se réfugie le mensonge, ce rêve pris sur le fait, et seul amour des
hommes » (Voyage au bout de la nuit, p. 80). En mettant à
distance l’horreur de la réalité – ici de la guerre – l’art apparaît comme un
agent du mensonge.
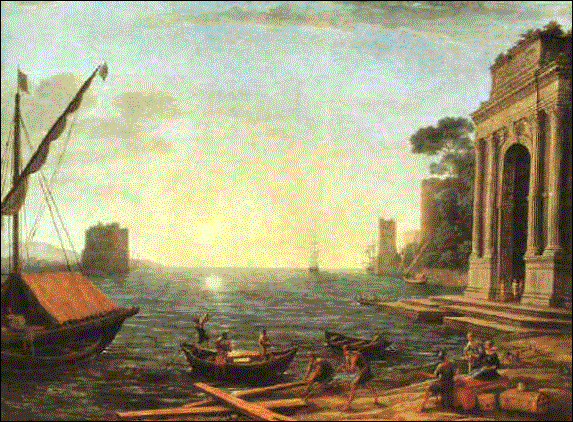
Claude Lorrain, Port
Oui, mais comment la dire alors la
réalité ? Par ce langage sec, cru, tissé de mots simples, communs et
cinglants : «Quand on s’arrête à la façon par exemple dont sont formés
et proférés les mots, elles ne résistent guère nos phrases au désastre de leur
décor baveux. C’est plus compliqué et plus pénible que la défécation notre
effort mécanique de la conversation. Cette corolle de chair bouffie, la bouche,
qui se convulse à siffler, aspire et se démène, pousse toutes espèces de sons
visqueux à travers le barrage puant de la carie dentaire, quelle
punition ! Voilà pourtant ce qu’on nous adjure de transposer en idéal »
(V, p. 336).
Or qu’un tel fond de souffrance, qu’une telle réalité plate et sans profondeur
fasse le fond de notre vie c’est, suggère à son tour Nietzsche, ce que tous
savent et dénient dans la « sorcellerie évocatoire »
(Baudelaire) de la poésie – ce pourquoi, savoir qui s’oublie et qui ne se dit
pas, il n’y a pas d’art sans quelque mauvaise foi. « On
rencontre, çà et là, chez les philosophes comme chez les artistes, le culte
passionné et excessif des « formes pures » ; à n’en pas douter,
ceux qui ont à ce point besoin du cultes des apparences ont dû faire un
jour ou l’autre un plongeon malencontreux au-delà de ces apparences.
Peut-être y a-t-il une hiérarchie même parmi ces chats échaudés, les artistes
nés, qui ne jouissent de la vie qu’en s’escrimant à en fausser l’image
(comme qui dirait pour en tirer une longue vengeance) ; on pourrait
deviner à quel point la vie leur est odieuse d’après le degré auquel ils
souhaitent en voir falsifier, diluer, transcender, diviniser l’image ; on
pourrait ranger les artistes parmi les homines religiosi dont ils
constitueraient l’échelon supérieur » (Nietzsche, Par delà le
bien et le mal, § 59).
On comprend ainsi pourquoi l’art nous est si nécessaire : il est le
baume, l’oubli que nous faisons du fond de notre vie en nous en distrayant
: «Pendant deux ans qu’il avait passés là-bas, il n’était pas entré bien
avant dans la vie des Américains ; seulement, il avait été comme touché
quand même par leur espèce de musique, où il essayent de quitter eux aussi leur
lourde accoutumance et la peine écrasante de faire tous les jours la même chose
et avec laquelle ils se dandinent avec la vie qui n’a pas de sens, un peu,
pendant que ça joue. Des ours, ici, là-bas.
Il n’en finissait pas son cassis à réfléchir à tout ça. Un peu de
poussière s’élevait de partout. Autour des platanes vadrouillent les petits
enfants barbouillés et ventrus, attirés, eux aussi, par le disque. Personne ne
lui résiste au fond à la musique. On n’a rien à faire avec son cœur, on le
donne volontiers. Faut entendre au fond de toutes les musiques l’air sans
notes, fait pour nous, l’air de la Mort » (Céline, voyage au bout de la nuit, p.
297).
Mais dès lors que nous n’avons plus la force de cette distance
imaginante, dès lors que nous ne pouvons plus avoir du jeu
avec la vie, dès lors que la vérité de ce vis-à-vis de quoi il n’y a plus
de distance : la souffrance, la mort – vient nous envahir, alors retombent
et disparaissent ces paysages et ces contrées qui n’existaient que figurés. «On
n’a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. Toute la
jeunesse est allée mourir déjà au bout du monde dans le silence de vérité. Et
où aller dehors, je vous le demande, dès qu’on a plus en soi la somme
suffisante de délire? La vérité c’est une agonie qui n’en finit pas. La vérité
de ce monde c’est la mort. Il faut choisir mourir ou mentir » (Voyage au
bout de la nuit, p. 200)
Conclusion - transition
Si donc « nous avons l’art pour ne pas périr de la vérité »
(Nietzsche), l’art est un mensonge, un doux mensonge, un baume, en ce
que mettant un jeu, une distance imaginaire, dans notre rapport au
réel, il nous fait vivre par procuration une vie que nous ne saurions vivre
autrement qu’en imagination. Dès lors, la conclusion ne s’impose t’elle pas, pour
qui veut vivre en vérité, de rejeter tout entier l’univers mensonger de
l’art ?
Il conviendrait alors de retourner à notre monde commun et de vivre dans
la conscience claire de la réalité qui est celle de tout un chacun – de tous
ceux qui savent bien que le poète est un illuminé et qui frappent la terre en
montrant ce qui résiste. En banquier, en mère de famille, en maçon, en élève
lambda… Mais est-ce ainsi vivre sur le roc même du réel ? Une telle vie
n’est-elle pas, elle aussi, dans sa pauvreté même, évasion perpétuelle?
III L’art comme puissance et fonction critique
a) L’art et la critique du monde quotidien (pour approfondire, lire le cours
sur l’art, première partie)
Or si de telles vies qui opposent à l’artiste la positivité de leur
ancrage dans le réel sont des vies aveugles sur elles-mêmes et sur la réalité,
c’est que, toujours portées en avant vers quelque objet de désir, elles ne
s’arrêtent jamais pour percer les apparences et réfléchir leur désir. «Toujours
béant après les choses futures (…) nous ne sommes jamais chez nous, nous
sommes toujours au-delà. La crainte, le désir, l’espérance nous élancent vers
l’avenir et nous dérobent le sentiment de ce qui est, pour nous amuser à ce qui
sera, voire quand nous ne serons plus» (Montaigne, Essais, I, 3).
Ainsi « chacun court ailleurs et à l’avenir, d’autant que nul n’est
arrivé à soi… » (Montaigne, Essais, III, 12). Que voyons-nous,
en effet, de nous-mêmes et du monde dans le regard quotidien?
La promptitude quotidienne dans l’identification des choses et des
êtres, nous fait naturellement penser que notre perception est un simple reflet
des choses en notre regard. Les choses, immédiatement, déposeraient en nous
leur image, de telle façon qu’aucune médiation ne serait ni nécessaire ni
possible pour nous les faire percevoir plus efficacement ou d’une autre façon.
Pourtant que voyons nous, communément, des choses et des êtres qui nous
entourent? Parce que notre regard n’est pas celui d’une chose mais d’un
sujet vivant, qu’il est donc motivé, dirigé en fonction d’un but, ce que nous
voyons premièrement des choses c’est leur rapport à nous, à nos fins, à nos
intérêts. « Dans l’intuition directe du monde et de la vie, nous ne
considérons d’ordinaire les choses que dans leurs relations (…), dans
leur existence relative et non pas absolue. Nous regarderons par exemple des
maisons, des vaisseaux, des machines, avec la pensée de leur destination et de
leur appropriation à cette fin ; nous regarderons des hommes avec la
pensée de leurs rapports avec nous, s’il en existe», écrit Schopenhauer
dans Le monde comme volonté et représentation. Parce qu’il est
ainsi pris dans le mouvement de nos vies, notre regard ne sélectionne, dans
l’indéfini de ce qu’on peut percevoir, que ce qui l’intéresse. Le perçu est
alors entièrement pensé dans le rapport à notre action, comme ce chien (cf.
plus bas le chien de Giacometti) qui n’est pour le passant qu’obstacle sur
le chemin qui le mène au lieu de son désir. Parce que vivre c’est ainsi réagir
promptement aux sollicitations de notre environnement en fonction de nos fins,
cela implique de «n’accepter des objets que l’impression utile pour y
répondre par des réactions appropriées : les autres impressions doivent
s’obscurcir ou ne nous arriver que confusément » (Bergson, Le rire). C’est
pourquoi « ce que je vois et ce que j’entends du monde extérieur, c’est
simplement ce que mes sens en extraient pour éclairer ma conduite » (id.).
Dans ce mouvement d’orientation à travers l’indéfini du perceptible nous traçons
des chemins et des points de repère pour faciliter notre prise sur les choses.
C’est ainsi que «des routes me sont tracées à l’avance où mon action
s’engagera » (ibid.), routes tracées par nos mouvements, nos habitudes
perceptives, et les mots et clichés de notre langue commune. Dès lors,
engagés dans les habitudes de nos mouvements quotidiens, nous ne voyons plus
des choses que les chemins que nous y avons tracés. Devenus insensibles à
leur étrangeté, nous avons assimilé les choses et les êtres, nous mouvant dans
un monde « à nous », prolongement du mouvement d’appropriation et d’assimilation
de notre corps vivant. Ce pourquoi nous comprenons que, loin de nous faire voir
les choses comme elles sont en elles-mêmes, le mouvement et les habitudes de la
vie perceptive ne nous les révèlent que dans leur relation utilitaire à nos vies,
chaque élément perçu renvoyant à une fin vis-à-vis de laquelle elle n’est que
moyen ou obstacle. Notre vision ne saurait ainsi être un pur reflet des choses.
Ainsi que le dit Bergson, « entre la nature et nous, que dis-je? Entre
nous et notre propre conscience, un voile s’interpose, voile épais pour
le commun des hommes, voile léger, presque transparent pour l’artiste et le
poète » (ibid.).
Aussi parce qu’il est détaché
des préoccupations quotidiennes, parce qu’il arrête ce mouvement de
préhension et d’appropriation qui assimile les choses à leur utilité, le regard
de l’artiste, comme celui exigé par la contemplation des œuvres, nous met en
position de voir et d’interroger ce que notre regard quotidien ne peut
pas voir.
b) Quatre exemples de libération du regard par
l’art
1) Les mains
Qui regarde – et pourquoi – les mains des autres? « Ce ne sont
que des mains » : jugement commun. C’est qu’il ne voit rien. Les
mains ont un langage, un langage singulier aux milles tonalités – la main qui
caresse, qui frappe, qui tremble, qui joue, qui accroche, qui saisit, qui
perce, qui insulte, qui meurtrit… – avec ces milles nuances qu’il faut
apprendre à voir, qu’il faut apprendre à dire : il y a des mondes,
mondes de sentiments et de vie, portés par ce mouvement des mains que
disent les poètes, les peintres, les sculpteurs.
. Les mains de celle que j’aime, des mains qui revivent enfin, à
nouveau : «je vois des mains retrouver leur lumière et se soulever
comme des fleurs après la pluie. Les flammes de ses doigts cherchent celle des
cieux et l’amour qu’elles engendrent sous les feuilles, sous la terre, dans le
bec des oiseaux, me rend à moi-même, à ce que j’ai été » (Eluard, Donner
à voir, p. 14).
. Les mains de solitude : « Des mains belles encore,
déformées, les doigts nus. Comme sont nus parfois les arbres en novembre »
(Barbara, Drouot).
. Etc.
2) Le chien
Que voyons-nous du chien qui fouille les
poubelles sinon un obstacle au bord de nos chemins? Le chien que nous voyons
n’est qu’un chien, rangé dans nos catégories, engageant telle action pour le
chasser, l’éviter ou le négliger. « Ce n’est qu’un chien » -
et nous passons notre chemin.
Parce qu’il s’arrête et interroge, parce qu’il
refuse que son regard passe dessus comme il passe communément sur toutes
choses, l’artiste scelle dans le métal ce qu’il vit comme l’être réel et
profond, rendant extérieur ce qui n’a de réalité qu’à être vécu et souffert. Il
prétend alors nous montrer ce que nous ne pouvions pas voir : la présence
d’une solitude déchirée, réduite à l’irréductible unicité d’une présence sans
personne, pour personne, au vide désolé d’une vie abandonnée à la morsure du
temps, de la faim, de la nuit.
Tel est le monde que nous donne
indéfiniment à voir le chien d’Alberto Giacometti.

Alberto Giacometti, Le
chien
3) Nos amours, nos malheurs, nos espoirs
Bergson : « Ce ne sont pas seulement les objets extérieurs,
ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce
qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons
de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce
bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille
nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose
d'absolument nôtre : nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous
musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son
déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur
aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce
qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes.
Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et
des symboles» (Le rire).
Qui n’a jamais senti combien la pauvreté de ses mots pour dire le plus
profond de ce qu’il ressentait, sentiment qui restait si obscur à lui-même? Or
c’est dans cette musique qu’enfermé dans sa chambre, il lui semble
reconnaître le fond même de son être. Ou bien, abandonné au souvenir d’amours
aujourd’hui disparues, ne retrouve t’il pas dans ses mots du poète, exprimé et
amplifié ce qu’il ne pouvait dire – où il reconnaît la plainte de son âme?
Ces serments, ces parfums, ces baisers
infinis,
Renaîtront-ils d'un gouffre interdit à nos
sondes,
Comme montent au ciel les soleils rajeunis
Après s'être lavés au fond des mers profondes?
Baudelaire, Le balcon
On peut saisir comment les mots communs, langue du
quotidien, dans leur pauvreté sont incapables de rendre l’intensité, la vie et
le monde intérieur (spirituel : Hegel) porté par ce poème en en
transcrivant le sens affectif immédiat tel qu’il pourrait se dire par
celui qui éprouve son malheur : «On était heureux. Je suis malheureux.
Est-ce qu’on va redevenir heureux? » : quelle pauvreté et quelle distance
entre ce que je ressens et que je voudrais dire! Que fait d’autre alors le
poète sinon de s’ancrer dans ce sentiment et les lignes de force qu’il
déploie en moi comme autant de possibles, pour tisser dans les mots des chemins
qui sont autant de mouvements vivants où ma pensée pourra se mouvoir,
éprouvant, dans le mouvement même des images suggérées, la profondeur
intérieure d’un monde évoqué.
Sur ce mouvement intérieur et l’usage poétique du langage :
résonances multiples du poème : le poème donne à rêver et à penser /
l’usage quotidien du mot tend à être univoque, à ne pas faire naître de
pensées mais à s’abolir dans l’action (se rapproche du signal). « Attention
au gouffre ! » - et on passe à autre chose. Le poète est celui
qui s’arrête et qui pense, déploie et vit le sens profond du gouffre.
Ex ici : Gouffre – sans lumière – ce gouffre = le passé, le jamais plus,
ce que je ne peux atteindre. Ce pourquoi = interdit à toute sonde = à toute
exploration ; toute prise est nulle, sans pouvoir. Il n’y a même plus de
traces. Les sondes : ce avec quoi… on explore à l’aveugle; mais
aussi : sonorité du mot… le « on » profond, enfoui, qui vient de
la gorge grave. Quoi ? Le fond des mers profondes. Noirceur insondable du grand
silence… la mort… Puis l’opposition : gouffre, ombre, mort / Soleil et
renaissance… Le mouvement de montée et descente s’amplifie de la
profondeur et de la hauteur relatives, et s’élève à une dimension cosmique qui
donne à ces mouvements intérieurs une portée et un sens infiniment profond –
qui semble exprimer les affres de nos âmes.
4) Monet et l’impressionnisme, une poésie du temps
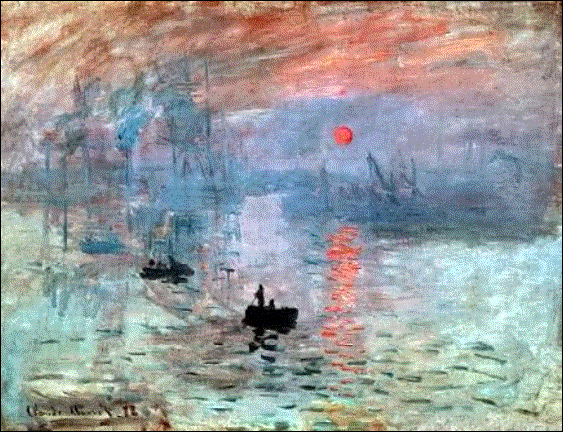
Monet,
Impression, soleil levant, 1872
Voir ce que nous donnent à voir les toiles de Monet suppose une
transformation de notre regard. Le regard quotidien assimile ce qu’il voit aux
objets connus et maîtrisés. « Qu’est-ce que c’est? »
L’identification des choses par notre regard les cerne d’un contour et d’une
forme fixe – formes fixes dont une partie de l’art classique, art du roc, de la
pureté et de la solidité des formes avait fait de leur manifestation son idéal
(cf. tableau du Lorrain). Mais dans l’identification quotidienne de
notre regard nous sommes insensibles à l’étrangeté des choses, à leur
nouveauté, au temps qui s’écoule et qui fait que tout se mêle, se déploie, que « rien
n’est, tout devient » (Héraclite). Alors nous ne les voyons pas mais
les «étiquettes» que nous mettons dessus, la fonction et la généralité qu’elles
signifient.
Ce que tente de faire Monet c’est de se rendre sensible aux milles nuances
et relations qui s’offrent, à tout instant à nos yeux, à voir en éliminant
nos projets, ce que nous anticipons (nos prises possibles : la barque
comme ce qui reste le même et que je peux prendre, toucher, manipuler)
et ce que nous retenons (nos chemins passés, nos habitudes) : voir les
choses dans leur perpétuelle mouvance et, par exemple, ces formes rigides de la
cathédrale qu’il nous semble pouvoir détacher du fond du monde comme une figure
éternelle et solide, comme mouvance et fondue dans un air impalpable – mouvance
accentuée par l’aspect sériel de la production du peintre (séries de peinture
de la cathédrale, cf. cours sur l’art), nous donnant à
voir mille facettes et mille scintillements de ce qui semblait à notre regard
objectivant le même. Ce que nous donne alors Monet c’est un autre regard, une
autre tonalité, un autre monde – que le regard pauvre et figé de notre
quotidienneté, renvoyant ce dernier à sa partialité, son utilitarisme et sa
relativité pratique.
Deux belles
citations sur la nature temporelle de toute chose :
« Remettez-vous, monsieur; notre divertissement est terminé. Ces
acteurs, je vous l’ai dit déjà, étaient tous des esprits ; ils se sont
fondus en air, en air impalpable. Pareillement à l’édifice sans base de cette
vision, les tours coiffées de nuages, les palais fastueux, les temples
solennels, le grand globe lui-même avec tous ceux qui en ont la jouissance se
dissoudront, comme ce cortège insubstantiel s’est évanoui, sans laisser
derrière eux la moindre vapeur. Nous sommes faits de la même étoffe que les
songes et notre petite vie, un somme la parachève » (Shakespeare, La
Tempête, IV, 1).
« Le monde n’est
qu’un branloire pérenne. Toutes choses y branlent sans cesse : la terre,
les rochers du Caucase, les pyramides d’Egypte, et du branle public et du
leur » (Montaigne, Essais, III. 2)
Conclusion sur
ces exemples : quel
est le caractère commun de ces quelques exemples ?
1) Chacun met à distance notre monde commun, le monde quotidien. L’étonnement,
le sentiment d’étrangeté face à l’œuvre – en ce qu’il est la marque de
quelque délocalisation, de quelque extra-territorialisation – est un sentiment
indispensable à toute œuvre. L’étrangeté nous révèle que ce monde commun de
notre quotidien bien loin d’être une terre de réalité n’est que la fixation
de nos habitudes et de nos préjugés. Dès lors s’il y a évasion de ce
monde quotidien c’est, dans un premier temps, au moins pour montrer que le
monde de chacun n’était qu’un monde possible.
2) Chacune de ces œuvres « donne à penser », à
imaginer, à ressentir inépuisablement – sur un mode à chaque fois singulier. Ce
qu’ouvrent ainsi les œuvres c’est un monde propre singulier, monde que nous
creusons à travers elle de la profondeur de nos questions, sentiments,
mouvements d’affects, d’images et de pensées – monde absurde de la technique de
l’univers de Cloaque, monde miroitant, fugitif et mouvant de Monet,
monde enfiévré de feu solaire de Van Gogh, monde solitaire et évidé de Giacometti,
monde cinglant, plat et désespéré de Céline…
Si donc l’art peut être divertissement – s’il peut être
l’occasion de s’échapper du réel en faisant miroiter les lumières d’un ailleurs
imaginaire - le monde commun vis-à-vis duquel on juge d’un tel
divertissement – opposé au sérieux des gens très très sérieux – ne saurait être
pensé comme la mesure même de la réalité sans oublier par là qu’il est lui-même
le produit singulier d’une vision du monde, d’habitudes de vie et de pensées
figées. Mettre à distance la quotidienneté, c’est la condition même pour
voir et questionner. Car si la vie est ce qui ne s’arrête jamais, aussi ne
pouvons-nous, - puisque nous sommes pris dans son mouvement - jamais la voir.
Si l’art n’est donc pas qu’un jeu décollé de la vie, c’est que, puissance
critique et d’ouverture, il donne à voir et à penser tant la relativité
de notre vie quotidienne que des modalités insoupçonnées de vie et de pensée.
C’est qu’en effet, allons-nous voir, le corollaire du regard quotidien
étranger aux puissances de l’art, n’est autre que la pauvreté
des puissances subjectives du corps et de la pensée : alors loin
d’être évasion de notre corps, de notre vie, dans un ailleurs imaginaire, l’art
peut être conçu comme le grand éducateur de l’homme à ses propres puissances.
c) L’art comme transformation et développement des puissances
humaines
Nous notions plus haut avec
Freud que l’origine de la création artistique était quelque souffrance et
quelque frustration du désir humain incapable de se réaliser. De là la
relation entre l’art et le jeu, ces deux pratiques n’étant accessibles qu’à
travers une attitude dé-réalisante qui, en forgeant une représentation
imaginaire plaisante serviraient de substituts imaginaires à notre incapacité
de vivre. L’art et le jeu seraient ainsi des moyens de nous évader de
nous-mêmes en feignant de nous retrouver dans un monde imaginaire mimé. Ce
qu’il faut retenir d’une telle analyse, c’est le fait qu’en effet, nous ne
créerions pas et ne serions pas attirés par les œuvres de l’art si nous étions satisfaits
de la réalité présente. N’est-ce pas le cas, en effet, de tous ces
insensibles aux mondes de l’art, qui pensent trouver sur la terre bien ferme de
leur monde historique la fin et le sens même de leur vie? Il y a donc bien quelque
désir d’ailleurs à l’origine de toute création et contemplation.
Mais à la différence du jeu qui
nous laisse identiques – aussi pauvres au sortir qu’à son entrée, cf. jeu de
cartes comme « passe-temps », jeux vidéos… - l’épreuve
effective de l’art est celle d’une transformation et d’un accroissement de nos
propres puissances. Ainsi, note Karl Marx, « c’est la musique qui
éveille le sens musical de l’homme ; pour l’oreille qui n’est pas
musicienne, la musique la plus belle n’a aucune signification, n’est pas un
objet, car mon objet ne peut être que la confirmation d’une maîtrise propre à
mon être. L’objet sera pour moi tel que ma maîtrise est pour soi comme faculté
subjective, car le sens qui correspond à cet objet s’étendra aussi loin que
s’étend mon sens : voilà pourquoi les sens de l’homme social sont autres
que ceux de l’homme non social. C’est seulement grâce à l’épanouissement de la
richesse de l’être humain que se forme et se développe la richesse de la
sensibilité subjective de l’homme : une oreille musicienne, un œil pour la
beauté des formes, bref, des sens capables de jouissance humaine, des sens
s’affirmant comme maîtrise propre à l’être humain » (Marx, manuscrits
de 1844). Texte d’une grande profondeur : le corollaire du monde
imaginaire de l’œuvre c’est une faculté éduquée et transformée par sa pratique
des œuvres à pouvoir la faire vivre. Un tableau de Van Gogh n’est rien pour
l’œil de l’âne, pour l’œil de celui qui, faute d’éducation de ses puissances
de voir, de penser et de ressentir, n’est pas capable de lui donner la vie
spirituelle, la vie intérieure qui est la sienne. Or ce n’est que par la
pratique des œuvres et la création personnelle que nos puissances de voir, de
penser, d’entendre, d’imaginer, de sculpter, de parler… peuvent se déployer, se
transformer, s’affiner.
Dès lors si l’art est évasion,
évasion d’un monde où nous ne sommes pas chez nous, loin d’être une
impuissance, une telle évasion si elle est pratiquée comme un mouvement de
transformation de soi indissociable de la pratique créatrice est libération et
enrichissement véritable de notre être. Aussi, écrit Nietzsche, « l’instinct
qui les éloigne [les artistes] de la réalité présente n’a pas à
être réfuté (…) Avec un peu de vigueur, d’envolée, de courage, de sens
artistique, ils souhaiteraient passer au-delà, et non retourner en arrière »
(Par delà le bien et le mal, § 10). S’évader de soi, c’est, en effet,
ici, se transformer, s’accroître et déployer nos puissances subjectives
tant dans l’épreuve que nous faisons des œuvres contemplées que dans les
facultés créatrices qu’une telle contemplation suscite, nourriture spirituelle,
nourrissant mon désir et éveillant la perspective d’un temps de puissance
créatrice.
Eveillé par la force même de l’art, ce sont de nouveaux possibles
qui, en nous, creusent le monde d’un à-venir plus intense : transformant
nos regards, libérant nos désirs de leur gangue quotidienne, sédiments d’une
histoire endormie en nos chairs, «les symphonies font soudain retentir, hors
des salles de concert, des échos et des chœurs» (Romain Gary) – rendant
intolérable un réel figé qui ne sait pas «danser» (Nietzsche). Par la
mise en cause de la clôture satisfaite du réel sur lui-même – la réalité
instituée tendant selon Marcuse (cf. texte) à saturer les possibles futurs
rendant impensable l’imagination d’un véritable ailleurs, de là la puissance
négatrice de l’art - , libérant les désirs vers un ailleurs de beauté, que la
puissance de l’art vient, en nos vies, d’éveiller, s’ouvre alors en nous et
pour le monde l’horizon des possibles, condition d’un devenir riche de
création. Aussi, dans et par sa coupure même vis-à-vis du réel commun, par la
transformation des désirs et regards qu’il opère, « ce champ de Van
Gogh, brûlant de génie, est un futur incendie de la réalité » (Gary).
« Le langage poétique parle de ce qui appartient à ce monde, de ce
qui est visible, tangible, audible dans l’homme et la nature – et ce qui n’est
ni vu, ni touché, ni entendu.
Créant et se mouvant dans un domaine qui rend présent l’absent, le
langage poétique est un langage de cognition – mais c’est une cognition qui
subvertit le positif. Dans sa fonction cognitive la poésie réalise la grande
tâche de la pensée : « le travail qui fait vivre en nous ce qui
n’existe pas » (Paul Valéry). En nommant « les choses qui sont
absentes », elle rompt le charme de celles qui sont là ; c’est
l’incursion d’un ordre de choses différent dans l’ordre établi – c’est
« le commencement d’un monde » (Valéry). »
Marcuse, L’homme unidimensionnel, p. 92
« Ce qu’une œuvre laisse comme goût à ses lèvres, c’est le goût et le pressentiment d’un monde qui n’est ni celui de la réalité ni celui du roman. Je l’ai dit : l’art fait toujours de l’homme un personnage futur. C’est ainsi qu’agit la vérité artistique : comme une poussée vers «ce qui n’est pas» au goût de beauté, de plénitude, vers un « ailleurs » qui ne saurait être atteint et qui est la condition même de la course de la conscience-poursuite et de l’Histoire. C’est un ébranlement vers l’avenir sans désignation spécifique de cet avenir : aucun romancier ne le connaît, aucune œuvre d’art ne peut le faire voir. C’est essentiellement quelque chose qui n’existe pas, une aspiration, au sens de la dynamique, mais qui est liée au bonheur, au jouir, à la beauté, à l’assouvissement. »
Romain Gary, Pour Sganarelle, p. 105
Conclusion - résumé
«L’art est-il donc une évasion ?»
I) Dans un premier temps, nous avons vu qu’en s’opposant à la platitude
et la stérilité de notre monde commun l’expérience que nous faisions des œuvres
de l’art nous ouvrait l’horizon d’un monde plus dense, plus profond, plus
vrai. Dès lors – suivant en cela le discours commun de nombreux artistes -
l’expérience que nous faisons de l’art n’est-elle pas celle d’une élévation vers
quelque autre monde, notre véritable patrie, patrie métaphysique, lieu du
soleil des âmes? L’art serait alors évasion, évasion bien réelle de
la prison du corps.
II) Si nous avons, cependant, pu faire porter le soupçon sur la nature
d’une telle évasion, c’est parce qu’un tel « arrière-monde »
n’est jamais qu’effleuré, dans un rapport au monde qui ne se sépare de
ce dernier que sur le mode imaginaire de la feinte et du jeu. Dès lors,
comme le soupçonnait Céline, n’est-ce pas par impuissance de vivre que nous nous
enivrons des sortilèges de l’art? Si l’art est donc évasion ce n’est ainsi nullement
libération réelle mais déni, évitement et oubli illusoire du réel et
de soi.
III) Mais si une telle critique condamne une pratique de l’art qui ne
vise, en effet, qu’à nous divertir de notre propre vie - car toujours, dans
l’oubli, posée à distance d’elle-même - elle oublie que l’art ne se réduit pas
en un tel divertissement mais peut être conçu comme puissance libératrice :
a) en mettant en perspective critique l’impensé
de notre rapport quotidien au monde
b) en ouvrant des possibles – de vie et de
pensée - qu’un tel rapport cachait
c) en formant et déployant les facultés
humaines, nous rendant plus puissants, plus riches et plus capables de voir,
d’imaginer, de ressentir, de penser…
L’art alors est bien, encore, évasion non par l’oubli de soi et
de sa pauvreté mais par transformation effective de nos propres pouvoirs
et éveil critique à des rapports au monde encore insoupçonnés.
------------------------------------------------
Résumé de cours
Introduction : a)
Mise en situation. Texte de M. Yourcenar. Déception du jeune empereur du
fait de l’irréalité du monde de l’art et de l’irrémédiable pauvreté relative
du monde réel. Pour comprendre un tel amour déçu, il faut analyser : 1) comment
l’art peut apparaître comme la promesse de la « vraie vie » 2)
le rapport existant entre nos vies communes et le monde de l’art de telle façon
qu’une telle promesse soit toujours déçue.
Mais l’est-elle vraiment?
L’histoire du jeune empereur illustre t’elle le statut véritable de
l’art comme évasion jouée, libération rêvée et, par là, illusoire de
notre monde commun? Ou bien peut-on penser un autre rapport à l’art que de
diversion, de telle façon que ce dernier puisse apparaître comme le médium
d’un regard libéré et d’une vie transformée ? b) Problématique :
L’art est-il donc un refus illusoire du réel ou bien en nous
éloignant de l’irréalité du monde quotidien nous ouvre t’il les portes d’une
vie plus vraie et intense ?
[On partira ici de l’expérience la plus commune éprouvée par les
amoureux de l’art de tous les temps : l’art est élévation vers quelque
monde plus vrai – afin, comme le jeune empereur, a) de la comprendre = de tenter de l’éprouver b) de saisir ce qui,
en elle, est nécessairement déçu]
I L’art est rupture
vis-à-vis de notre monde et promesse d’une libération – évasion réelle vers un monde plus vrai
a) L’expérience esthétique comme rupture du monde quotidien
Texte de Sartre, La nausée, relatant l’épreuve que Roquentin fait
de la musique. Alors qu’il vivait dans « la nausée », c'est-à-dire
ici, dans cette expérience de la platitude et de l’inanité des choses et de
soi, dans l’absence de désir que caractérise l’ennui, désir sans désir, dans ce
sentiment d’être insupportablement rivé à ce monde et à soi («englué dans
l’être » (Sartre)), la musique entendue vient déchirer la
platitude du monde et la creuser d’une autre dimension (cf. encore texte
de Proust, Swann et la petite phrase de Vinteuil). Baudelaire : « la
musique creuse le ciel » (Fusées) – ce ciel plat et gris s’ouvre vers
quelque autre horizon lumineux : profondeur qui éclaire le monde d’une
autre lumière. En nous libérant des chaînes de la nausée, cette insupportable étrangeté
de nous-mêmes à nous-mêmes et de nous-mêmes aux choses, l’art est bien évasion,
mais évasion vers quoi?
b) L’art est la révélation d’un autre monde.
Evidence : comment ce qui se révèle à nous en une telle expérience,
ce qui excède, creuse, intensifie notre monde pourrait-il venir de ce monde si
plat, si banal, si stérile? Non, l’art vient d’ailleurs et cet
ailleurs=un autre monde plus vrai, plus beau, essentiel. Sur cet autre
monde, ce «soleil de derrière tout», cf. textes de Flaubert, du Bellay,
Diderot, Baudelaire… Mais comment un tel « arrière-monde »
(Nietzsche) se manifeste t’il et comment y accéder?
c) Métaphysique de la libération
Modèle religieux (deux mondes, chute, espoir de salut). De cette réalité
transcendante (qui transcende = dépasse notre monde) nous sommes
séparés. Aussi, êtres de deux mondes (corps et âme, d’ici et d’ailleurs)
sommes-nous nostalgiques d’un tel pays dont nous reconnaissons dans les
œuvres des artistes le reflet et les traces. Sur cette séparation (la
chute : nous avons connu et perdu le pays de nos origines), textes de
Rimbaud, Racine, Hugo. L’artiste, quant à lui = plus proche de l’Origine de
laquelle il s’approche par l’élan inspiré de son imagination : il
détache pour nous des «miettes du pain des dieux» que nous goûtons et
grâce auxquelles nous nous sentons croître (élévation). Textes de Platon,
Plotin et Rimbaud. Nous, être de deux mondes, aspirant (désir) vers le
monde transcendant duquel nous avons chuté et dont nous reconnaissons la trace
dans les beautés de ce monde et les œuvres des artistes, cherchons à nous
évader = nous libérer vers notre véritable patrie = là où nous sentons
que nous pourrions enfin vivre et respirer.
Transition : mais un
tel arrière-monde n’existe pour nous qu’effleuré et pressenti à l’horizon
de notre visée = le signe qu’un tel monde de lumière n’est qu’un monde rêvé?
Dès lors cette évasion au lieu d’être véritable libération n’est-elle pas qu’illusoire
échappement au réel et à soi?
II Une telle évasion est
évasion imaginaire – le monde de l’art est un monde joué
a) L’œuvre d’art ne se donne qu’à un regard qui joue à irréaliser le
monde alentour
Voir un tableau : non plus le voir dans la pièce, sur le mur mais
faire comme si mur et pièces n’existaient plus = entrer dans le
monde imaginaire porté par la toile. Idem / lecture : faire comme si
les signes sur le papier n’existaient plus = condition pour « être
dedans ». Alors : « il est dans son monde ».
Mais nous ne le sommes que par jeu – différence avec le rêve :
comme l’enfant qui joue du sabre avec son bâton sait très bien qu’il s’agit en
réalité d’un bâton, tout en étant « dans l’œuvre » nous
savons, par exemple, que nous sommes en train de lire. La déréalisation du
monde alentour, condition pour voir l’œuvre, est donc une déréalisation
jouée. Pourquoi donc un tel jeu?
b) L’art est conjuration imaginaire d’un réel qui fait souffrir
Freud : rêve, fantasme et jeu = satisfaire un désir qui ne peut se
réaliser. Au-delà du principe de plaisir : l’enfant qui lance et tire
une bobine de fil en disant successivement «fort – da» (ici – là) joue
et maîtrise ainsi imaginairement le départ et le retour de sa mère, mouvements
vis-à-vis desquels il n’a nul pouvoir réel. L’enfant qui joue « se crée
un monde à lui, ou plus exactement, il transpose les choses du monde où il vit
dans un ordre nouveau tout à sa convenance ». Or Freud : l’œuvre
d’art « est une continuation et un substitut du jeu enfantin
d’autrefois » (Essais de psychanalyse appliquée). Par la
création de l’œuvre, l’artiste, prenant du jeu avec le réel,
maîtriserait imaginairement sa frustration réelle. Ainsi, selon Mélanie Klein,
comprend t’on pourquoi les situations douloureuses sont l’occasion de
mouvements de création (cf. la poésie de l’ado déprimé). A ce titre l’art
est bien évasion mais évasion imaginaire et jouée d’un réel auquel nous sommes
rivés.
c) L’illusion d’une évasion possible
Aussi est-ce l’intégralité du modèle religieux (première partie) qui est
ici mis en cause. Si l’expérience que nous faisons de l’art nous semble l’appel
de quelque transcendance, force nous est, en effet, de constater qu’une telle
transcendance n’est jamais par nous que figurée (image) et effleurée – et
jamais possédée : nous ne pouvons vivre en elle, mais seulement la jouer.
Ne pouvons-nous ainsi soupçonner son éternelle absence? – Rousseau : «il
n’y a de beau que ce qui n’est pas » - le beau n’étant qu’un objet
fantasmé. L’illusion constitutive de l’art serait alors de nous faire croire qu’une
évasion est possible. L’art serait alors un masque, un baume illusoire posé sur
nos vies. Texte de Céline : Le Lorrain et le mensonge de l’art / opposé au
gris de la dure réalité. De là l’idée qu’il n’y aurait pas d’art a) sans
quelque volonté d’échapper à la vie (Céline, Nietzsche) et b) ni sans mauvaise
foi (Nietzsche). Mais dès que nous n’avons plus la force de cette distance
imaginante, dès que nous ne pouvons plus prendre du jeu avec la vie,
alors s’évanouissent comme des rêves les contrées imaginées – faisant place à
ce vis-à-vis de quoi il n’y a plus de distance : la souffrance, la mort
(Texte de Céline). Nietzsche : « nous avons l’art pour ne pas
périr de la vérité » - l’art est le mensonge qui nous permet de vivre,
évasion d’un moment mais illusoire et vaine.
Transition : qui
veut vivre en vérité doit-il donc rejeter le monde mensonger de l’art – ainsi
que font tous ceux qui, insensibles à l’art, traitent le poète d’«illuminé»
frappant de leur pied la Terre ferme des évidences communes? Cependant,
une telle vie, n’est-elle pas, elle aussi dans sa pauvreté même, évasion
perpétuelle? Or, à mettre en perspective critique une telle vie, l’art ne
regagne t’il pas des accents libérateurs?
III L’art comme fonction critique et comme puissance
a) L’art et la critique du monde quotidien
Si la vie quotidienne est une vie aveugle sur elle-même et sur la
réalité qui l’entoure c’est que toujours portée en avant vers quelque objet de
désir, elle se s’arrête jamais pour percer les apparences et réfléchir son désir.
Montaigne : «chacun court ailleurs et à l’avenir, d’autant que nul
n’est arrivé à soi ». Que voyons-nous, en effet, de nous-mêmes
et du monde dans le regard quotidien? Si le regard quotidien est vécu comme
dans l’évidence comme le reflet des choses mêmes - Schopenhauer : il ne
voit des choses que leur rapport à nous, à nos fins, nos intérêts.
Bergson : par nos mots et nos habitudes, nous traçons des chemins dans
l’indéfinité du perceptible, chemins assurant l’efficacité de notre action mais
nous rendant aveugle à ce qui excède cette dernière. Aussi parce qu’il est détaché
des préoccupations quotidiennes, parce qu’il arrête le mouvement commun
qui assimile les choses à leur utilité, le regard de l’artiste se met en
position de voir et d’interroger ce que notre regard quotidien ne peut pas
voir.
b) Quatre exemples de libération du regard et de la pensée par l’art
. Le chien de Giacometti. Le regard quotidien range le chien dans
ses catégories : « ce n’est qu’un chien ». L’artiste nous
donne à voir en sa sculpture ce sur quoi notre regard a passé : la
présence d’une solitude déchirée, réduite à l’irréductible unicité d’une
présence sans personne, pour personne, au vide désolé d’une vie abandonnée à la
morsure du temps, de la faim, de la nuit. Tel est le monde donné à voir
et à penser par Giacometti.
. Nos amours, nos malheurs, nos espoirs. Texte de Bergson :
nos propres états d’âme se dérobent à nous – nous ne savons les dire et à peine
les sentir -ainsi «jusque dans notre propre individu, l’individualité nous
échappe ». Or dans la musique, dans les mots du poète, nous découvrons
exprimé et amplifié ce que nous ne savions, ni ne pouvions dire – et que,
pourtant, nous reconnaissons comme la plainte même de notre âme. Ex. vers de
Baudelaire, Le balcon. La langue commune dans sa pauvreté est incapable
de rendre l’intensité, la vie et le monde intérieur porté par ce poème.
Disjonction fondamentale entre l’intensité vécue / pauvreté des mots
communs : « on était heureux ; je suis malheureux ;
est-ce qu’on va redevenir heureux ? ». A contrario le musicien,
le poète s’ancre dans le sentiment et les lignes de forces qu’il déploie en moi
pour créer à travers les mots de tous un monde ayant la couleur de son âme.
Analyse du poème : résonances multiples, mouvement de pensée, d’images,
d’affects. L’art donne à penser, à sentir, à imaginer.
. Monet et l’impressionnisme, une poésie du temps.
L’identification quotidienne des choses par notre regard les cerne d’un contour
et d’une forme fixe : cf. question : « qu’est-ce que c’est ?»,
volonté d’identifier = ramener ce qui est vu aux formes connues et maîtrisées.
Nous sommes, par là, insensibles à l’étrangeté des choses, à leur nouveauté, au
temps qui s’écoule à travers elles et qui fait que tout se mêle, se
déploie : nous ne voyons que nos étiquettes (Bergson). Monet : se
rendre sensible aux mille nuances et relations qui s’offrent, à tout instant, à
nos yeux en éliminant ce que la perception commune y dépose (habitudes, chemins
tracés, projets). De là ce nouveau regard sur la cathédrale de Rouen – forme
pour nous fixe, éternelle et solide – devenue vibration, scintillement,
transformation dans l’air impalpable (mouvances amplifiées par les séries du
peintre). Monet : un regard, une tonalité, un monde.
. Fonction critique de l’art : « cloaca » de Wim
Delvoye (2000). Machine complexe – issue d’une recherche technologique
poussée – qui, en une longue chaîne et par des processus chimiques imitant le
cheminement et la transformation des aliments en notre propre corps, à partir
des mets les plus raffinés des plus grands restaurants, produit à son issue des
étrons ayant l’aspect, l’odeur et la taille de vrais étrons humaine. Cloaca =
une machine «à faire de la merde». Quel intérêt? Enorme effort
technologique pour une fin absurde : donne à penser sur les productions
contemporaines de la techno-science dynamisées par le profit capitaliste :
ne sont-ce donc pas, sous des formes plus affriolantes, de semblables machines?
Cf. le destin de nos biens = consommation puis mis au rebut = déchet, ordure.
Cycle organique infini de consommation / destruction. Vers : ce monde là
a-t-il un sens? Et encore, donne à penser sur notre propre corps : comme
cette machine, ne sommes-nous pas pièces extérieures et processus chimiques? Or
le sens duquel nous vivons et par lequel nous différencions le bon du mauvais,
le bien du mal, et par exemple, l’escalope à la crème de l’étron devenu, ce
sens que devient-il quand tout devient étron, quand tout devient machine,
effort absurde pour produire ce qui n’a pas de sens?
Ce qu’ont en commun ces exemples :
1) Mise à distance critique du monde quotidien. Etonnement / ces œuvres
(sentiment d’étrangeté) = par différence avec nos habitudes, montre que le
monde commun quotidien, loin d’être une terre de réalité n’est que la fixation
de nos habitudes et de nos préjugés. S’il y a donc évasion du monde quotidien,
c’est d’abord parce que c’est là la condition pour libérer les sens et la
pensée de leurs œillères.
2) Chacune de ses œuvres « donne à penser », à
imaginer, à ressentir. Ce qu’elles ouvrent = des mondes propres singuliers,
mondes que nous creusons de la profondeur de nos questions, sentiments et
pensées; monde absurde de la technique de l’univers de Cloaca, monde
miroitant, fugitif et mouvant de Monet, monde enfiévré et solaire de Van
Gogh, monde solitaire et évidé de Giacometti, monde cinglant, plat
et désespéré de Céline…
Mais la contrepartie d’un regard quotidien, étranger à l’art, n’est pas
simplement l’aveuglement sur soi et sur toutes choses, c’est aussi la pauvreté
des puissances subjectives du corps et de la pensée : loin d’être évasion
de notre vie dans un ailleurs imaginaire, l’art n’a-t-il pas aussi pour
vocation d’être le grand éducateur de l’homme à ses propres puissances?
c) L’art comme transformation et développement des puissances
humaines ouvrant à l’action créatrice le champ des possibles
Rappel des thèses de Freud sur l’art (II. b) : nous ne créerions
pas si nous étions satisfaits de la réalité présente. Et de fait, le banquier –
satisfait de sa vie – n’est pas un créateur. Il y a donc bien quelque désir
d’ailleurs à l’origine de toute création et contemplation. Mais, à la
différence du jeu qui nous laisse identiques (jeu de cartes, jeux vidéos…),
l’épreuve effective de l’art est celle d’une transformation et d’un
accroissement de nos propres puissances. Texte de Marx. Le corollaire du monde
imaginaire de l’œuvre c’est une faculté éduquée pour la faire vivre : nous
apprenons par notre fréquentation des œuvres et par nos créations, à voir,
penser, ressentir davantage et mieux. Ce pourquoi la même musique qui a la
profondeur d’un monde pour le musicien – en ce qu’elle lui donne à ressentir,
imaginer, déployer - n’est rien pour l’oreille inéduquée. Dès lors si l’art est
évasion d’un monde où nous ne sommes pas chez nous, d’un monde étranger à notre
intériorité, une telle évasion si elle est pratiquée comme un mouvement de
transformation de soi indissociable de la pratique créatrice est libération et
enrichissement véritable de notre être. Nietzsche : «l’instinct qui les
éloigne de la réalité présente n’a pas à être réfuté » mais amplifié
et dépassé dans un temps qui, bouleversant la morne monotonie du
monde, devient celui d’une puissance créatrice. Eveillé par la force même de
l’art, ce sont de nouveaux possibles qui, en nous, creusent le monde
d’un à-venir plus intense : transformant nos regards, libérant nos désirs
de leur gangue quotidienne, sédiments d’une histoire endormie en nos chairs, «les
symphonies font soudain retentir, hors des salles de concert, des échos et des
chœurs» (Romain Gary) – rendant intolérable un réel figé qui ne sait pas «danser»
(Nietzsche). Par la mise en cause de la clôture satisfaite du réel sur lui-même
– la réalité instituée tendant selon Marcuse (cf. texte) à saturer les possibles
futurs rendant impensable l’imagination d’un véritable ailleurs, de là la
puissance négatrice de l’art - , libérant les désirs vers un ailleurs de
beauté, que la puissance de l’art vient, en nos vies, d’éveiller, s’ouvre alors
en nous et pour le monde l’horizon des possibles, condition d’un devenir riche
de création. Aussi, dans et par sa coupure même vis-à-vis du réel commun, par
la transformation des désirs et regards qu’il opère, « ce champ de Van
Gogh, brûlant de génie, est un futur incendie de la réalité » (Gary).
Conclusion. «L’art est-il donc une
évasion ?»
I) Dans un premier temps, nous
avons vu qu’en s’opposant à la platitude et la stérilité de notre monde commun
l’expérience que nous faisions des œuvres de l’art nous ouvrait l’horizon d’un monde
plus dense, plus profond, plus vrai. Dès lors – suivant en cela le discours
commun de nombreux artistes - l’expérience que nous faisons de l’art n’est-elle
pas celle d’une élévation vers quelque autre monde, notre véritable patrie,
patrie métaphysique, lieu du soleil des âmes? L’art serait alors évasion,
évasion bien réelle de la prison du corps.
II) Si nous avons, cependant, pu faire porter le soupçon sur la nature
d’une telle évasion, c’est parce qu’un tel « arrière-monde »
n’est jamais qu’effleuré, dans un rapport au monde qui ne se sépare de ce
dernier que sur le mode imaginaire de la feinte et du jeu. Dès lors, comme le
soupçonnait Céline, n’est-ce pas par impuissance de vivre que nous nous
enivrons des sortilèges de l’art? Si l’art est donc évasion ce n’est ainsi
nullement libération réelle mais déni, évitement et oubli illusoire du réel et
de soi.
III) Mais si une telle critique condamne une pratique de l’art qui ne
vise, en effet, qu’à nous divertir de notre propre vie - car toujours, dans l’oubli,
posée à distance d’elle-même - elle oublie que l’art ne se réduit pas en un tel
divertissement mais peut être conçu comme puissance libératrice : a) en
mettant en perspective critique l’impensé de notre rapport quotidien au monde.
b) en ouvrant des possibles – de vie et de pensée - qu’un tel rapport cachait.
c) en formant et déployant les facultés humaines, nous rendant plus puissants,
plus riches et plus capables de voir, d’imaginer, de ressentir, de penser…
L’art alors est bien, encore, évasion non par l’oubli de soi et de sa
pauvreté mais par transformation effective de nos propres pouvoirs et éveil
critique à des rapports au monde encore insoupçonnés rendant ainsi possible un
autre devenir, devenir créateur des puissances libérées.