Cours sur l’art
Première approche : distinctions conceptuelles – liens et
différences art / nature / technique
Afin
d’établir une première caractérisation du champ de notre propos, mettons en
lumière la définition de l’art impliquée par le classement que nous, modernes,
effectuons entre divers choses, évènements, objets :
-
soient une baffe, une plante, Beat it de Michael Jackson, une armoire
normande, un stylo bic, un éclair, la Joconde, une chaise de classe, un
escargot.
Selon quels critères pouvons-nous classer ces
objets ?
NATURE - causer - cause
HOMME – faire - fins
Développement inintentionnel d’un effet
ou d’un être
Production intentionnelle d’un effet – d’un objet
(éclair, chute de pierre… / plante, escargot…)
(chant, une baffe… - une table, un tableau…)
![]()
![]()
Produit industriel Produit
de l’art
(produit d’un savoir - règle objective qui précède l’objet –
machine programmée)
(produit d’un savoir-faire - règle incorporée au geste)
(une chaise de classe, un stylo…) (une armoire normande, un
tableau…)
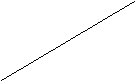
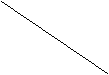
Artisanat
(artisan) Art
(artiste)
Règle connue avant la production : prévisibilité de l’effet (on
sait ce qu’on veut). Règle
inconnue avant.
Répétition Nouveauté, création, unicité
Utilité (corps). Inutile
au corps (esprit).
Mercantile (travail en vue d’un profit) Libéral
(faite pour elle-même)
Impersonnalité Expression d’un artiste (style)
(armoire normande, sabot breton,
baguette de pain…) (Joconde, Beat
it...)
Bilan : l’art est cette
activité humaine, nécessitant un savoir-faire, exprimant en un style
la singularité d’un artiste, effectuée pour elle-même, productrice
d’actions et d’objets nouveaux et originaux ayant une signification spirituelle
(les œuvres d’art) inutile aux besoins du corps de la vie quotidienne.
Notons qu’une telle caractérisation, fort utile, ne
vaut que généralement. Nombre d’œuvres contemporaines font éclater une
telle définition.
![]() Quel est cependant le sens d’une telle activité ? A quoi sert l’art
s’il ne sert à rien (inutile : on peut sans passer pour vivre –
biologiquement parlant) ?
Quel est cependant le sens d’une telle activité ? A quoi sert l’art
s’il ne sert à rien (inutile : on peut sans passer pour vivre –
biologiquement parlant) ?
Thèses de Hegel[1]
et Bergson : l’art n’a
pas pour but de : a) nous divertir (de la vraie vie, la vie quotidienne) =
plaisir et évasion (cf. les films de divertissement), b) d’embellir le monde
(le joli – l’art comme tapisserie).
![]() L’art a une signification spirituelle
profonde qui vise à révéler des vérités et à exprimer des valeurs
(supérieures / quotidien). Si l’art a une telle fonction – ce qu’il faudra
montrer – cela signifie que la vie quotidienne, loin d’être ce qu’elle prétend
= suffisante (valeur) et évidente (vraie) – est une vie de peu de hauteur
(valeur), qui ne connaît pas les choses et qui ne se connaît pas
(vérité).
L’art a une signification spirituelle
profonde qui vise à révéler des vérités et à exprimer des valeurs
(supérieures / quotidien). Si l’art a une telle fonction – ce qu’il faudra
montrer – cela signifie que la vie quotidienne, loin d’être ce qu’elle prétend
= suffisante (valeur) et évidente (vraie) – est une vie de peu de hauteur
(valeur), qui ne connaît pas les choses et qui ne se connaît pas
(vérité).
Texte de Bergson : la vie quotidienne est une vie
réductrice / l’art nous ouvre à la vérité
L’artiste a toujours passé
pour un idéaliste. On entend par là qu’il est moins préoccupé que nous du côté
positif et matériel de la vie. C’est au sens propre du mot, un
« distrait ». Pourquoi étant plus détaché de la réalité, arrive t’il
à voir plus de choses ? On ne le comprendrait pas si la vision que nous
avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes n’était une vision
que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d’agir, nous a
amenés à rétrécir et à vider. De fait, il serait aisé de montrer que, plus nous
sommes préoccupés de vivre, moins nous sommes enclins à contempler, et que les
nécessités de l’action tendent à limiter le champ de la vision. Bergson, La pensée et le mouvant
Analyse
a) Opposition courante : le distrait / l’homme sérieux. L’idéaliste - distrait = celui qui a la tête dans les nuages / le « matérialiste » - sérieux : les pieds sur terre. Nuages = songes, illusions et idées / Terre = pratique, réalité et matière. Cf. « lui, c’est un artiste » : identique au jugement commun / philosophe.
b) Bergson inverse une telle hiérarchie : la distraction, l’idéalisme = condition de la vision du réel. L’art serait du côté de la vérité et non de l’illusion ou de la pure fiction. Comment est-ce possible ? Comment le regard qui 1) nous détache du réel immédiat et commun et 2) qui crée un artefact (l’œuvre) peut-il avoir une fonction de révélation du réel ?
Autrement dit : quelle réalité plus profonde nous révéleraient – et de quelle manière ? - tel poème de Baudelaire, tel requiem, telle peinture… ?
Ce n’est possible que
si : 1) Ce que nous prenons communément pour le réel n’est pas le tout du
réel mais un réel réduit et appauvri.
2) La distraction vis-à-vis
du réel commun (prise de distance) est la condition d’un regard plus profond
sur les choses.
3) L’œuvre n’est pas pure fiction mais a une signification et un contenu de vérité qui renvoie au-delà d’elle-même.
I. Ce que nous prenons communément pour le
réel n’est pas le tout du réel mais un réel réduit et appauvri
« La vision que nous avons ordinairement des objets extérieurs et de nous-mêmes est une vision que notre attachement à la réalité, notre besoin de vivre et d’agir, nous a amenés à rétrécir et à vider » (Bergson).
Paradoxe : comment la vision ordinaire pourrait-elle être rétrécie et ainsi aveugle à une partie du réel ? Il nous semble, au contraire, que nous voyons les choses telles qu’elles sont en elles-mêmes : ouvrir de grands yeux, c’est, semble t’il voir le monde tel qu’il est hors de nous et sans nous. Telle est l’illusion propre de toute perception qu’il s’agit, tout d’abord, de mettre en cause. Un détour par la perception animale peut ainsi nous montrer que loin de voir les choses en elles-mêmes nous ne les voyons qu’à travers la petite lorgnette d’un regard humain, aveugle à ce que des millions d’autres types de perceptions pourraient nous révéler.
a) Première
réduction : toute perception est
une perception filtrante du réel à travers un monde propre
structuré différemment selon les espèces
Percevoir n’est pas voir le réel tel qu’il est hors de nous et sans nous. La perception suppose : a) un filtrage – une sélection (réduction) de certains éléments dans l’indéfini du réel - le chien est sensible à des ultrasons qui n’existent pas pour notre audition, nous ne voyons pas les ultraviolets que d’autre espèces perçoivent, le crotale est sensible à des variations de températures qui sont pour nous imperceptibles… ; b) la constitution sur cette base d’un monde propre (monde vécu) dont chaque vivant est le centre et qui est inconnaissable (nul ne peut – et ne pourra jamais – savoir ce que vit la mouche, ce que c’est qu’être une mouche – on ne peut que savoir, de l’extérieur, comment elle réagit).
« Vivre
c'est rayonner, c'est organiser le milieu à partir d'un centre de référence qui
ne peut lui-même être référé sans perdre sa signification originale ».
Canguilhem, la connaissance de
la vie
« La meilleure façon d’entreprendre cette incursion, c’est de la
commencer par un jour ensoleillé dans une prairie en fleurs, toute bruissante
de coléoptères et parcourue de vols de papillons, et de construire autour de
chacune des bestioles qui la peuplent une sorte de bulle de savon qui
représente son milieu et se remplit de toutes les caractéristiques accessibles
au sujet. Aussitôt que nous entrons nous-mêmes dans cette bulle, l’entourage
qui s’étendait jusque-là autour du sujet se transforme complètement. De
nombreux caractères de la prairie multicolore disparaissent, d’autres se
détachent de l’ensemble, de nouveaux rapports se créent. Un nouveau monde se
forme dans chaque bulle ».
Uexkull, Mondes animaux et mondes humains
L’exercice d’imagination que nous propose Uexkull tend à nous faire saisir la relativité de notre propre regard. Alors qu’il semble à notre perception que les papillons et les coléoptères sont simplement là dans la prairie entourés de fleurs, nous oublions qu’une telle perception est notre perception, que ce qui existe pour nous n’existe pas pour d’autres bestioles et que ce qui existe pour d’autres bestioles n’existe pas pour nous. En se plaçant au point de vue – possible seulement en imagination – d’un papillon c’est la totalité du monde qui est transformé : des couleurs disparaissent, d’autres apparaissent, des sensations inconnues prennent formes, d’autres réalités se déploient pour la bestiole en question dont nous n’avons nulle idée. En multipliant les êtres percevants ce sont autant de mondes propres singuliers que l’on peut imaginer et dont le vertige nous fait saisir l’étroitesse de notre perspective humaine.
Exemple de relativité perceptive : une mouche ne réagit à un leurre visuel projeté devant elle qu’à partir de sa diffusion à la faveur de 200 images par seconde alors que l’illusion du mouvement commence pour nous à partir de 18 images / seconde (cf. le cinéma ; 24 images / seconde). Autrement dit : il existe un temps propre (vécu) de la mouche qui n’est pas le nôtre – une mouche devant un écran de cinéma verrait des images relativement statiques. Si l’homme araignée, dans Spiderman I, peut ainsi voir le poing de Flash s’acheminer avec une extrême lenteur c’est qu’il a maintenant un temps vécu d’insecte : il vit dans un autre monde (percevant 10 fois plus d’évènements en un instant que nous – évènements qui pour nous n’existent pas) !
L’illusion de notre perception (et de toute perception) consiste ainsi à croire que le monde perçu par nous est perception des choses-mêmes telles qu’elles sont sans nous, hors de nous. Nous oublions alors : a) la pluralité des mondes propres animaux ; 2) l’opération structurante spécifique à chaque espèce de sélection et d’interprétation qui rend possible ces mondes ainsi que notre monde.
![]() Nous avons acquis une première
distance vis-à-vis de l’évidence naturelle (cf. le paradoxe + haut) : le
monde propre de l’homme n’est pas perception immédiate du réel mais sélection
et interprétation particulière de ce dernier. Sur cette première
réduction se superpose une seconde .
Nous avons acquis une première
distance vis-à-vis de l’évidence naturelle (cf. le paradoxe + haut) : le
monde propre de l’homme n’est pas perception immédiate du réel mais sélection
et interprétation particulière de ce dernier. Sur cette première
réduction se superpose une seconde .
b) Seconde réduction :
la perception quotidienne est une perception réduite par l’horizon de l’utilité
et par l’habitude
i) A la différence de
la perception animale, cependant, la perception humaine est potentiellement ouverte :
alors que l’animal, parce que pris dans sa pulsion, ne peut connaître que son
monde, l’homme peut imaginer d’autres mondes et transformer son
rapport au monde : ainsi peut-il tenter de penser le monde de la
souris, celui du chat ou se faire tour à tour, biologiste, artiste ou
entrepreneur (cf. cours sur la conscience) – percevant à travers chacune des
attitudes autre chose du monde – dans le chat, par exemple,
successivement, l’élément d’une espèce, un félin libre et fier ou une
marchandise. La question « qu’est-ce que c’est ? »,
question de la raison qui vise à connaître l’essence de la chose (ce
qu’elle est en elle-même et vraiment – la vérité de la chose) manifeste une telle ouverture. L’homme
seul, en effet, est structurellement ouvert à la question de la vérité, pouvant
chercher par exemple ce qu’est vraiment la souris, alors que le chat
après l’avoir identifié et rangé dans ses catégories figées lui saute
simplement dessus.

Seul l’homme peut avoir un
regard détaché (de ses instincts) et, par là, ouvert à ce qui est. cf. analyse
ii) Mais si l’homme peut
avoir un tel rapport ouvert au monde, une telle ouverture n’est nullement
ordinaire.
« D’ordinaire, en effet, le regard sur le monde ne le
regarde pas. Il est comme absent, hanté par un avenir et un ailleurs. Hanté par
quoi ? Par les objets du souci, de la préoccupation. Le monde est alors un
monde réduit, rétréci, pris dans l’étroitesse d’une perspective. Pour le
paysan, le monde se réduit à sa ferme et à son champ, dit Heidegger. C’est le
monde de la préoccupation. Les choses, alors, n’existent pas, ne valent pas
pour elles-mêmes. Elles ne sont que des pragmata, des «outils ». Le nuage,
pour le paysan, n’est pas ce que voit le poète : il n’est que le porteur
de pluie, ce dont la venue fait craindre ou espérer la pluie »
(Conche, L’aléatoire, p. 43).
Comme l’animal pris dans
sa pulsion ne voit du monde que ce qui s’y réfère, la perception du monde, en tant
que le monde est saisi en référence à notre action, est réduction du
monde. Exemple du paysan : son intérêt est la production agricole – aussi
projette t’il sur les choses l’objet de sa préoccupation, ne voyant et
n’anticipant des choses que ce qui l’intéresse. Exemple des nuages : les
nuages ne sont vus qu’en tant que signes de la pluie, et la pluie n’est
elle-même saisie que sous l’option bon / mauvais dans son rapport aux récoltes.
Autre exemple : en attendant le bus (souci, préoccupation : que le bus
arrive) tout ce qui existe et que nous pourrions percevoir (les visages, les
couleurs, les voitures…) est renvoyé par nous à un arrière-fond flou sur
lequel se manifeste la seule chose que nous voyons (= qui nous intéresse)
: l’absence du bus attendu. Dernier exemple enfin, Manolito dans Mafalda,
métaphore du monde moderne. Ce que le proto-capitaliste Manolito perçoit d’un
monde infiniment riche et divers n’est rien d’autre que l’objet de son
obsession : des dollars. Aussi le paysan, celui qui attend son bus et
Manolito vivent-ils dans des mondes réduits autour de leur intérêt ne voyant
des choses que ce qui leur est utile. Par extension, agissant sans cesse,
courant sans répit après un objet d’intérêt, toujours préoccupé et centrés sur
nous-mêmes, c’est notre regard le plus ordinaire qui est aveugle au monde.

Que ne voyons-nous donc pas à travers de tels regards
? Exemple des nuages : ce que le paysan ne voit pas – n’entend pas : la
musique de la pluie, les formes qu’elle déploie dans la plaine, la tonalité du
monde que les nuages portent. Ce qui est oublié, mis de côté, et que donne, par
exemple à voir les tableaux de Ruysdael c’est l’écrasante pesanteur de
la masse des nuées, la puissance gigantesque du ciel comparée à la petitesse
humaine, au tortueux des arbres tentant avec peine et sans succès d’échapper à
la terre, aux sentiers, tracés sinueux de l’homme déjà gobés par l’ombre… - une
relation vécue de l’homme et de son monde, révélée et intensifiée par la
touche du peintre

Ruysdael, Wheat, 1670
Aussi
pour le paysan pris dans l’attitude utilitaire ordinaire le paysage
n’existe t’il simplement pas. En occitan, « es brave lo païs »
signifie la terre (puissance de production agricole) est bonne (capable de bien
produire) – ce que voit le paysan d’un champs – et non : « le
paysage est beau » (couleurs, formes, tonalités… détachés de la
référence productive). Que suppose, a contrario, une telle perception ?
II.
Seul un regard désintéressé peut voir le monde
Pour que le pays devienne
paysage, pour que la pluie, la terre, le soleil… soient vues pour eux-mêmes
s’unifiant en une unité harmonieuse il faudra un autre regard, un regard désintéressé,
dés-oeuvré, contemplatif (opp. action) qui n’a plus de relation
utilitaire au monde. Tel est précisément le regard de celui qui se distrait (Bergson)
de ce monde commun, qui se met à distance de ce rapport prédateur au monde,
cette mise à distance du regard intéressé sur le monde, étant la condition
d’une vision non réductrice, d’un regard ouvert. Autrement dit pour voir
les choses, il faut arrêter de les manipuler et développer notre attention à ce
qui est, le laisser être sans le réduire ce qui suppose de s’intéresser
à la chose pour elle-même (et non dans la relation à nos intérêts, à notre
ventre). Ce n’est que dans et par la distance silencieuse de l’attention, que
la beauté (du paysage, d’une femme, d’une œuvre d’art…) peut apparaître car « le beau est ce qui peut être objet
d’attention » (S. Weil, La pesanteur et la Grâce). « Beauté :
un fruit qu’on regarde sans tendre la main » (idem.) – en ayant fait taire
ce qui veut consommer, manger c'est-à-dire réduire à soi… C’est une
telle beauté que donnent, par exemple, à voir les natures mortes, telles celles
du peintre Chardin.
![]() Mais
une telle attitude (contemplation désintéressée) suffit-elle à nous ouvrir le
monde ? Ne faisons-nous pas, au contraire, l’expérience, dans notre effort
attentif pour voir, de l’incapacité de percevoir autre chose que ce que nous
saisissions dans l’attitude intéressée ? «Qu’y a-t-il donc à voir ? » : nous ouvrons
de grands yeux, mettant pour un temps de côté nos intérêts, et nous ne voyons
rien. C’est que l’habitude a forgé et figé en nous un regard dont
on ne peut en ouvrant simplement les yeux se débarrasser. Il faudra s’y éduquer,
ce à quoi la pratique de l’art peut contribuer.
Mais
une telle attitude (contemplation désintéressée) suffit-elle à nous ouvrir le
monde ? Ne faisons-nous pas, au contraire, l’expérience, dans notre effort
attentif pour voir, de l’incapacité de percevoir autre chose que ce que nous
saisissions dans l’attitude intéressée ? «Qu’y a-t-il donc à voir ? » : nous ouvrons
de grands yeux, mettant pour un temps de côté nos intérêts, et nous ne voyons
rien. C’est que l’habitude a forgé et figé en nous un regard dont
on ne peut en ouvrant simplement les yeux se débarrasser. Il faudra s’y éduquer,
ce à quoi la pratique de l’art peut contribuer.
III.
L’obstacle formé par les formes habituelles figées de notre perception
a) L’habitude
en domestiquant le monde dans des schémas généraux d’action éteint
notre attention
Si le regard quotidien n’est pas un regard qui saisit immédiatement le monde tel qu’il est en lui-même mais un regard réduit c’est parce qu’il est éteint par l’habitude. Texte de Lucrèce :
Et
tout d’abord contemple la couleur claire et pure du ciel et tout ce qu’il
renferme en lui : les astres errants de toutes parts, la lune, le soleil et
sa lumière à l’éclat incomparable : si tous ces objets aujourd’hui pour la
première fois apparaissaient aux mortels, si, brusquement, à l’improviste, ils
surgissaient à leurs regards, que pourrait-on citer de plus merveilleux que cet
ensemble, et dont l’imagination des hommes eût moins osé concevoir
l’existence ? Rien, à mon avis, tant ce spectacle est prodigieux. Vois
maintenant : personne, tant on est fatigué et blasé de cette vue, ne
daigne plus lever les yeux sur les régions lumineuses du ciel.
Lucrèce, De la nature
On ne voit plus ce qui émerveillait ou étonnait le regard vierge. Celui qui vit depuis des années avec une femme ne la regarde plus (thème on ne peut plus classique des scènes de ménage). Ces paysages et objets nouveaux que notre enfance nous avait découverts et devant lesquels nous nous émerveillions – tel l’enfant devant les couleurs de son caillou - ne sont plus pour nous des objets d’attention : nous y sommes habitués, ils ne nous étonnent plus. S’étonner ou s’émerveiller c’est être saisi par un spectacle inédit – la nouveauté d’un jamais vu – spectacle étrange et étranger qui fait éclater les cadres familiers dans lesquels nous rangeons communément les choses. Ainsi notre regard est-il interpellé lorsqu’au détour d’une rue nous voyons quelques évènement exceptionnel – tel un cracheur de feu ou bien un éléphant faisant des claquettes (plus rare et donc plus étonnant pour nous - mais banal et donc invisible dans un monde de Toon’s, cf. Roger Rabbit) – alors que nous passons devant la scène trop connue des passants au costume gris et à l’air maussade. Si nous ne les regardons pas c’est qu’il nous semble, en effet, déjà les connaître – à l’enfant qui nous montre le ciel, nous sourions complaisamment en songeant « oui, oui, je sais, je connais… ».
Et pourtant, que connaissons-nous vraiment de ces choses que l’habitude et la répétition nous font re-connaître ? Connaître c’est savoir ce qu’est la chose (son essence) et pourquoi elle est ainsi (ses causes) – soit rendre compte de ses raisons d’être. Mais savons-nous pourquoi la rose se déploie en ces mille nuances et parfume les jardins d’insolites senteurs ? Savons-nous pourquoi les astres font ainsi du ciel cet immense luminaire ? Et pourquoi de telles formes, infiniment variées, des insectes, des fleurs, des plantes, des animaux ? Et puis pourquoi encore ces milliards de visages dont pas un n’est le même et qui content chacun un monde propre de douleurs et de joie, d’ombres et de lumières ? Nulle réponse à chacune de ses questions que l’on pourrait encore multiplier à l’infini – ainsi vivons-nous entourés d’innombrables phénomènes dont nous ne connaissons pas la cause, de formes luxuriantes infiniment variées dont l’être et la raison d’être nous échappent totalement. Et pourtant alors même que nous ne les connaissons pas, il nous semble, au sein de notre regard commun, les re-connaître. Que reconnaissons-nous donc si de ce que nous voyons nous n’avons nul véritable savoir ?
Nous ne les connaissons pas mais nous nous y reconnaissons : nous reconnaissons des visages, des roses, le ciel, des astres… et cela nous suffit. Au lieu de saisir l’irréductible individualité des êtres et des choses, nous n’en percevons qu’un schéma général suffisant pour nous y orienter. « Lorsque nous regardons un objet, d’habitude, nous ne le voyons pas ; parce que ce que nous voyons ce sont des conventions interposées entre l’objet et nous ; ce que nous voyons, ce sont des signes conventionnels qui nous permettent de reconnaître l’objet et de le distinguer pratiquement d’un autre, pour la commodité de la vie » (Bergson, Le rire). Ce ne sont donc pas les choses mêmes que nous percevons mais les choses réduites par rapport à l’efficacité de nos mouvements et de nos attentes de façon que nous puissions nous y orienter efficacement pour accomplir nos buts propres : le schéma général ainsi que les mots qui ne saisissent des choses qu’une étiquette vide (il suffit de savoir qu’un chien n’est pas un chat – de ranger la forme perçue dans la catégorie « chien », sans que nous aillons à voir plus avant) ont ainsi une fonction vitale utilitaire inéliminable d’orientation dans le monde (cf. I.b, seconde réduction). Sur la base d’une telle visée réductrice (intéressée, utilitaire), la répétition de l’identification se structure en habitude : nous n’avons plus à être aux aguets devant l’imprévisible mais nous anticipons désormais correctement un monde domestiqué par nos schémas généraux (plan de ville, catégories de choses et d’êtres, manière efficaces de dire et de faire...). Se structurant en habitude une telle identification nous libère pour d’autres actions : une fois la ville reconnue, l’attention que nous portions au repérage et à l’identification des lieux s’évanouit en dehors du champ de notre conscience dans l’automatisme sans effort d’identifications immédiates, nous laissant libres de penser à ou de faire autre chose (en allant au lycée on ne regarde presque plus le chemin – a contrario lorsque l’on est jeté dans une ville étrangère).
![]() Si nous avons donc l’impression
de connaître les choses auxquelles nous sommes habituées ce n’est pas parce que
nous les connaissons (vraiment, telles qu’elles sont en elles-mêmes) mais parce
que nous les avons réduites et domestiquées, nous permettant de
nous y orienter. La répétition a banalisé les choses pour nous de telle
façon que nous ne regardons plus ce que nous sommes habitués à voir. Par
l’habitude, la vision utilitaire et commune s’est ainsi figée en structure
de regard – nous ne voyons plus que ce qu’une longue accoutumance
nous a appris à voir.
Si nous avons donc l’impression
de connaître les choses auxquelles nous sommes habituées ce n’est pas parce que
nous les connaissons (vraiment, telles qu’elles sont en elles-mêmes) mais parce
que nous les avons réduites et domestiquées, nous permettant de
nous y orienter. La répétition a banalisé les choses pour nous de telle
façon que nous ne regardons plus ce que nous sommes habitués à voir. Par
l’habitude, la vision utilitaire et commune s’est ainsi figée en structure
de regard – nous ne voyons plus que ce qu’une longue accoutumance
nous a appris à voir.
b) Dégeler
les schémas habituels afin de voir le monde
Si donc l’habitude a une fonction vitale précise (orientation, repérage)
indispensable et inéliminable (il faut bien vivre), elle est aussi ce qui me
cache les choses. On comprend ainsi que pour voir les choses il
faudra rompre avec l’habitude. Mais comment ? Si l’habitude consiste à
domestiquer ce qui est irréductiblement étranger (puisqu’échappant à ma
connaissance) – il faudra s’éveiller à cette étrangeté des choses et des
êtres. Ainsi deviendrons-nous capables de nous étonner de ce que notre
regard banalisé ne sait plus voir (cf. Lucrèce) : pour cela il s’agit
d’acquérir de la distance / monde trop familier.
C’est ainsi que le voyage dans l’espace ou (imaginairement) dans
le temps peut me faire découvrir la beauté, l’étrangeté et le mystère de ce
qui, aux yeux des autochtones et des contemporains, apparaissait normal,
naturel et banal.
Texte de Proust : « Quand elle [la grand-mère du narrateur] avait à faire
à quelqu’un un cadeau dit utile, quand elle avait à donner un fauteuil, des
couverts, une canne, elle les cherchait « anciens », comme si leur
longue désuétude ayant effacé leur caractère d’utilité, ils paraissaient plutôt
disposés pour nous raconter la vie des hommes d’autrefois que pour servir aux
besoins de la nôtre. (…). Mais ma grand-mère aurait cru mesquin de
s’occuper de la solidité d’une boiserie où se distinguaient encore une
fleurette, un sourire, quelquefois une belle imagination du passé. Même ce qui
dans ces meubles répondait à un besoin, comme c’était d’une façon à laquelle
nous ne sommes plus habitués, la charmait comme les vieilles manières de dire
où nous voyons une métaphore, effacée, dans notre moderne langage, par
l’usure de l’habitude. Or, justement, les romans champêtre de George Sand
qu’elle me donnait pour ma fête, étaient pleins ainsi qu’un mobilier ancien,
d’expressions tombées en désuétude et redevenues imagées, comme on n’en
trouve plus qu’à la campagne. Et ma grand-mère les avait achetés de préférence
à d’autres comme elle eût loué plus volontiers une propriété où il y aurait eu
un pigeonnier gothique ou quelqu’une de ces vieilles choses qui exercent sur
l’esprit une heureuse influence en lui donnant la nostalgie d’impossibles
voyages dans le temps »
(Combray, p. 79 – 80)
Les brocantes sont
propices à la découverte d’anciens objets qui acquièrent à nos yeux un charme
auquel les contemporains, parce que les utilisant, étaient aveugles. Ce charme
– comme face à une vieille lampe à huile, un moulin à café ou quelque objet
dont ne savons pas quelle était la fonction… - est rendu possible par la
distance / son utilisation et le réseau des gestes habituels. Isolé du
réseau habituel de l’utilité – désormais inutile - l’objet peut être vu pour
lui-même. Or voir l’objet c’est, par notre imagination, le lire
et le faire parler : a) tout objet raconte une histoire, celle des
gestes de la vie des hommes d’autrefois. Ainsi, selon Heidegger dans L’origine
de l’œuvre d’a rt de vieux
souliers peuvent-ils raconter un rapport paysan à la terre, tout un monde de
souci, d’angoisse et de joie que l’on peut lire en trace dans l’usure du
bois ; b) nous saisissons sa forme propre, la matière et les lignes
spécifiques qui le constituent dans une harmonie et un style propre
caractéristiques (d’une époque c’est à dire d’un certain mode de vie et
d’une certaine façon de sentir et d’imaginer) : derrière la forme propre
du produit, comme le dit Proust, c’est « une belle imagination du passé »
que nous saisissons. L’objet est la cristallisation d’une imagination
inédite spécifique se déployant en un style soit une certaine manière
d’ordonner les formes, manière qui lui donne son charme propre.
De la même façon le voyage
en d’autres contrées nous fait découvrir combien les lieux communs sont le
produit stylisé d’une certaine imagination humaine – le blanc et bleu
breton, les maisons alsaciennes, les villages blancs sans toit de Grèce, les
églises de Russie, le souk de Tunis… - sont autant de créations humaines qui en
un style singulier disent une manière propre de vivre, de sentir et d’imaginer,
nous donnant à leur tour à penser, sentir et rêver.
Isolées des relations utilitaires, dégagées du plan habituel qui, dans
la vie courante, tend à les effacer, dans la distance du regard étranger
les choses ré-acquièrent par notre regard leur poésie propre, soit leur faculté
de parler : de nous faire sentir, imaginer et penser. Aussi refluant sur
notre propre monde pouvons-nous poser que ce que l’habitude de mon rapport au
monde me fait oublier c’est l’étrangeté du familier, soit derrière ce
qui m’apparaît naturel et allant de soi, de telle façon que nous ne le voyons
plus, des images, des métaphores, des créations : des produits stylisés
de l’imagination humaine sédimentés, gelés en mots, tournures, manières de
dire et de faire, formes architecturales, objets… Aussi la longue accoutumance
à notre monde a-t-elle formé en notre perception autant de cadres et
de grilles d’appréhension des choses, cadres et grilles que nous portons en
nous, avec nous, et auxquels nous sommes quotidiennement aveugles.
Texte de Nietzsche : « Ce n’est que par l’oubli de ce
monde primitif de métaphores, ce n’est que par le durcissement et le
raidissement de ce qui était à l’origine une masse d’images surgissant, en un
flot ardent, de la capacité originelle de l’imagination humaine, ce n’est que
par la croyance invincible que ce soleil, cette fenêtre, cette table, est une
vérité en soi, bref ce n’est que par le fait que l’homme s’oublie en tant que
sujet, et ce en tant que sujet de la création artistique, qu’il vit avec
quelque repos, quelque conséquence »(Le livre du philosophe, III, p.126)
Nous voyons le soleil, nous ne voyons plus les schémas imaginaires
qui l’ont constitué et stabilisé pour nous. Le soleil, en effet, s’il
est pour nous, modernes, boule lumineuse matérielle non vivante produit éloigné
du Big Bang est pour les Incas un Dieu vivant, pour Van Gogh, semble t’il, la
source animatrice de la nature à laquelle cette dernière aspire toute entière,
pour Le Lorrain l’espoir éloigné d’une vie transfigurée… - et qu’est-il donc
pour une mouche ou pour un éléphant ? Que serait encore le soleil pour un
être dont l’œil serait de l’échelle de notre système solaire ? Pour qui un
million d’années dureraient une seconde ? C’est dans chacun des cas un
autre soleil qui apparaîtrait, un autre sens et d’autres images – chacun des
percevants oubliant l’imagination qui l’a constitué et figé en ce
soleil-ci ayant ce sens-ci.
![]() Quel est, dans ce cadre, le
rôle de l’art ?
Quel est, dans ce cadre, le
rôle de l’art ?
L’artiste pourra : 1) nous donner à saisir l’étrangeté de notre monde
familier, en suscitant sur lui un autre regard; 2) développer d’autres
façons de voir c'est-à-dire d’imaginer et de styliser les choses et les
êtres, nous éveillant à notre puissance propre d’imaginer, de penser et de
ressentir.
IV
L’art nous ouvre à l’originaire pouvoir constitutif de mondes de
l’imagination créatrice – trois exemples
Si nous ne voyons plus l’imaginaire
de nos schémas et de nos grilles de lecture gelés dans l’habitude de notre
perception, l’artiste est, au contraire, celui qui va nous donner à voir ce que nous ne
voyions pas en une œuvre qui : 1) est le produit d’un autre
regard ; 2) crée un monde imaginaire propre porté par la matière de
l’œuvre (un monde d’émotions et de significations propres naissant par
exemple du son musical) ; 3) en un reflux sur notre manière de
percevoir notre monde commun, nous fait saisir autrement ce dernier en transformant
nos schémas et nos grilles de lecture.
Trois
exemples : Giacometti (Le chien), Monet (cathédrales de Rouen) et Wim
Delvoye (Cloaca) – voir aussi, analyse du Café de nuit
de Van Gogh.
a) Le chien de
Giacometti
Le regard quotidien range le chien dans ses catégories : « ce
n’est qu’un chien ». L’artiste nous donne à voir en sa sculpture ce
sur quoi notre regard a passé : la présence d’une solitude déchirée,
réduite à l’irréductible unicité d’une présence sans personne, pour personne,
au vide désolé d’une vie abandonnée à la morsure du temps, de la faim, de la
nuit. Tel est le monde donné à voir et à penser par Giacometti.

Alberto Giacometti, Le
chien
b) Monet et l’impressionnisme, une poésie du temps.
L’identification quotidienne des choses par notre regard les cerne d’un
contour et d’une forme fixe : cf. question : « qu’est-ce que
c’est ?», volonté d’identifier = ramener ce qui est vu aux formes
connues et maîtrisées. Nous sommes, par là, insensibles à l’étrangeté des
choses, à leur nouveauté, au temps qui s’écoule à travers elles et qui fait que
tout se mêle, se déploie : nous ne voyons que nos étiquettes (Bergson).
Monet : se rendre sensible aux mille nuances et relations qui s’offrent, à
tout instant, à nos yeux en éliminant ce que la perception commune y dépose
(habitudes, chemins tracés, projets). De là ce nouveau regard sur la cathédrale
de Rouen – forme pour nous fixe, éternelle et solide – devenue vibration,
scintillement, transformation dans l’air impalpable (mouvances amplifiées par
les séries du peintre). Monet : un regard, une tonalité, un monde.



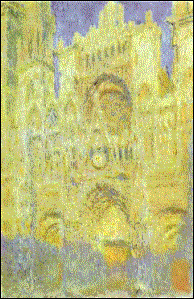
Monet, série des cathédrales de Rouen
. Fonction critique de l’art : « cloaca »
de Wim Delvoye (2000)
Machine complexe – issue d’une recherche
technologique poussée – qui, en une longue chaîne et par des processus
chimiques imitant le cheminement et la transformation des aliments en notre
propre corps, à partir des mets les plus raffinés des plus grands restaurants,
produit à son issue des étrons ayant l’aspect, l’odeur et la taille de vrais
étrons humaine. Cloaca = une machine «à faire de la merde». Quel intérêt
? Enorme effort technologique pour une fin absurde : donne à penser sur
les productions contemporaines de la techno-science dynamisées par le
profit capitaliste : ne sont-ce donc pas, sous des formes plus
affriolantes, de semblables machines ? Cf. le destin de nos biens =
consommation puis mis au rebut = déchet, ordure. Cycle organique infini de
consommation / destruction. Vers : ce monde là a-t-il un sens ? Et encore,
donne à penser sur notre propre corps : comme cette machine, ne
sommes-nous pas pièces extérieures et processus chimiques ? Or le sens duquel
nous vivons et par lequel nous différencions le bon du mauvais, le bien du mal,
et par exemple, l’escalope à la crème de l’étron devenu, ce sens que devient-il
quand tout devient étron, quand tout devient machine, effort absurde pour
produire ce qui n’a pas de sens ?

. Ce qu’ont en commun ces exemples :
1) Mise à distance critique du monde quotidien. Etonnement / ces œuvres
(sentiment d’étrangeté) = par différence avec nos habitudes, montre que le
monde commun quotidien, loin d’être une terre de réalité n’est que la fixation
de nos habitudes et de nos préjugés : libération de nos oeillères.
2) Montre que d’autres regards, d’autres rapports au monde sont
possibles – regards et rapports qui, sans les œuvres, nous seraient à jamais
restés inconnus.
L’art est la révélation qui serait impossible
par des moyens directs et conscients de la différence qualitative qu’il y a
dans la façon dont nous apparaît le monde, différence qui, s’il n’y avait pas
l’art resterait le secret éternel de chacun. Par l’art seulement, nous pouvons
sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le
même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que
ceux qu’il peut y avoir dans la lune. Grâce à l’art, au lieu de voir un seul
monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu’il y a d’artistes
originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les
uns des autres que ceux qui roulent dans l’infini, et bien des siècles après
qu’est éteint le foyer dont il émanait, qu’il s’appelât Rembrandt ou Vermeer,
nous envoient encore leur rayon spécial.
Proust, Le temps retrouvé, GF, p.289-290
Le monde se multiplie alors d’un nombre indéfini de perspectives,
ouvrant notre regard à une multiplicité de mondes et de rapports au monde.
Chacune de ses œuvres, en effet, « donne à penser » (Kant), à
imaginer, à ressentir. Ce qu’elles ouvrent = des mondes propres singuliers,
mondes que nous creusons de la profondeur de nos questions, sentiments et
pensées; monde absurde de la technique de l’univers de Cloaca, monde
miroitant, fugitif et mouvant de Monet, monde enfiévré et solaire de Van
Gogh, monde solitaire et évidé de Giacometti, monde cinglant, plat
et désespéré de Céline mais aussi, par exemple, monde révolté anar et
banlieusard d’un Renaud…
![]() Alors que nos vies quotidiennes sont des vies closes
sur elles-mêmes et spirituellement pauvres, l’art nous ouvre
d’autres mondes et d’autres rapports au monde, enrichissant notre pensée, notre
imagination et nos sentiments de nouvelles valeurs et de nouveaux horizons.
Reste, cependant, qu’un tel enrichissement n’est possible que parce qu’à
travers l’expression subjective propre de l’artiste nous reconnaissons
une valeur (faisant la différence entre un chef d’œuvre et une « croûte »)
qui dépasse sa singularité et qui nous semble dire quelque chose d’essentiel
de sens universel.
Alors que nos vies quotidiennes sont des vies closes
sur elles-mêmes et spirituellement pauvres, l’art nous ouvre
d’autres mondes et d’autres rapports au monde, enrichissant notre pensée, notre
imagination et nos sentiments de nouvelles valeurs et de nouveaux horizons.
Reste, cependant, qu’un tel enrichissement n’est possible que parce qu’à
travers l’expression subjective propre de l’artiste nous reconnaissons
une valeur (faisant la différence entre un chef d’œuvre et une « croûte »)
qui dépasse sa singularité et qui nous semble dire quelque chose d’essentiel
de sens universel.
V)
L’art révèle des contenus spirituels à prétention universelle
Le miracle des grandes
œuvres est qu’à travers le plus singulier d’un regard et d’une création
se dévoile un contenu spirituel qui nous semble avoir valeur universelle.
Quoi de plus singulier, en effet, qu’une œuvre de Van Gogh, de
Giacometti ou Monet ? A l’opposé, les créations des petits peintres,
musiciens et poètes nous semblent relativement impersonnelles, manquant
de l’originalité que marque un grand style. L’œuvre d’art est donc bien
l’expression d’une individualité forte et puissante. Mais une telle expression
signifie au-delà de l’artiste et au-delà de l’œuvre : a) elle parle
et me parle ; b) de telle façon que j’y trouve un contenu puissant qui
me parle de valeurs qui me sont intimes (d’amour, de mort, de passions,
de liberté, de vérité… – à la différence du dialogue quotidien, dialogue de
surface ou du discours scientifique qui ne touche que la matière indifférente
de nos vies) ; c) qui, en même temps, me semblent détenir un sens universel : je pense
spontanément que l’œuvre est puissante et qu’autrui devrait reconnaître la
validité de mon jugement non parce qu’il est mon jugement mais parce que la
valeur de l’œuvre me semble universelle – aussi vais-je tenter d’en
convaincre autrui, ce que je ne ferais pas si je pensais « à chacun ses
goûts », position qui vaut peut-être pour les pizzas aux
anchois (et encore… le maître-cuisinier n’est-il pas mieux éduqué que moi pour
juger – son goût étant plus sûr car plus puissant et fin que le mien ?),
pas pour les œuvres d’art.
Cette rencontre inédite du plus intime et du plus universel nous
unit à l’artiste comme à un frère et crée entre les hommes un lien
essentiel de communion (cf. texte de Proust)
autour de valeurs intimes centrales dépassant la superficialité des liaisons
quotidiennes. Ainsi lorsque je rencontre dans l’œuvre d’un artiste une
puissance qui formule, intensifie et déploie des lignes de force qui se
pressait en moi.
C’est ce que révèle notamment la lecture de ces deux expériences de rencontre
d’une œuvre que sont l’épreuve que Roquentin fait de la musique dans la
Nausée (cf. texte de Sartre) et celle que Swann fait
de la petite phrase de Vinteuil chez Proust (cf. texte).
L’épreuve de la musique vient rompre la vanité ennuyeuse de la
quotidienneté : alors que Roquentin vivait dans « la nausée »,
c'est-à-dire ici, dans cette expérience de la platitude et de l’inanité des
choses et de soi, dans l’absence de désir que caractérise l’ennui, désir sans
désir, dans ce sentiment d’être insupportablement rivé à ce monde et à soi («englué
dans l’être » (Sartre)), la musique entendue vient déchirer la
platitude du monde et la creuser d’une autre dimension (cf. encore texte
de Proust, Swann et la petite phrase de Vinteuil). Baudelaire : « la
musique creuse le ciel » (Fusées) – ce ciel plat et gris s’ouvre vers
quelque autre horizon lumineux : profondeur qui éclaire le monde
d’une autre lumière qui semble la lumière même de la vérité (cf.« oui, c’est
cela, la vie et le monde qu’elle enveloppe, c’est exactement cela »
! : il nous semble que l’essentiel (ce qui est +, ce qui vaut +)
est dit).
C’est ce que nous pouvons à notre tour éprouver à lire un grand poème,
tel le Balcon de Baudelaire. Quoi de plus intime et de plus
impartageable, par exemple, que mes sentiments ? La douleur de l’amoureux
éconduit fait corps avec lui, il ne peut s’en séparer et personne n’en saisit
l’intériorité : il est seul parmi les indifférences. «Allons,
remue-toi ! » - incompréhension : « tu ne peux pas
comprendre », répond le désespéré. Mais le pouvons-nous
nous-mêmes ?
Texte de Bergson
« Nous ne voyons pas les choses mêmes ; nous nous bornons, le plus souvent, à lire des étiquettes collées sur elles. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots (à l'exception des noms propres) désignent des genres... Et ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont d'intime, de personnel, d'originalement vécu. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience avec les mille nuances fugitives et les mille résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre : nous serions alors tous romanciers, tous poètes, tous musiciens. Mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions, pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles. »
Bergson, Le rire
Nos propres états d’âme se dérobent à nous – nous ne savons les dire et
à peine les sentir - ainsi «jusque dans notre propre individu, l’individualité
nous échappe ». Or dans la musique, dans les mots du poète, nous
découvrons exprimé et amplifié ce que nous ne savions, ni ne pouvions dire – et
que, pourtant, nous reconnaissons comme la plainte même de notre âme. Ex. vers
de Baudelaire, Le balcon.
« Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, / Renaîtront-ils
d'un gouffre interdit à nos sondes, / Comme montent au ciel les soleils
rajeunis / Après s'être lavés au fond des mers profondes? »
La langue commune dans sa pauvreté est incapable de rendre l’intensité,
la vie et le monde intérieur portés par ce poème. Disjonction fondamentale
entre l’intensité vécue / pauvreté des mots communs : « on était
heureux ; je suis malheureux ; est-ce qu’on va redevenir
heureux ? » - ni moi ni autrui ne peut me reconnaître dans mes
propres mots. A contrario le musicien,
le poète s’ancre dans le sentiment et les lignes de forces qu’il déploie en moi
pour créer à travers les mots de tous un monde riche et puissant ayant la
couleur de son âme.
Plongeons, en effet, quelque peu à travers ce poème afin de montrer
comment à travers résonances multiples, réseaux enchevêtrés de pensées,
d’images et d’affects, Baudelaire parvient à dire ce que nous ne savons
dire : l’image du gouffre, par exemple, est celle d’une chute infinie –
quelle autre image pour dire la séparation d’avec l’autre aimé ? A la
plénitude d’une vie solaire et indivise dans les hauteurs célestes, vient
s’opposer la chute au fond des ténèbres marins (cf. + loin, la mer et ici la
mer terrible qui engloutit les hommes) : c’est le monde qui vient de
s’écrouler et c’est mon être, par essence uni à elle, qui, d’un coup, perdant
son être même, se disloque. Or un tel gouffre au sein duquel je péris est
« interdit à nos sondes », comme les plus profonds fonds
marins au regard de tout homme. Le caractère insondable dit l’infini
(imagination d’une plongée infinie dans des ténèbres de plus en plus profondes)
et l’indicibilité de la souffrance. Aucun mot ne peut le dire – tous les mots
sont ici dérisoires – et pourtant Baudelaire parvient à imager cette
indicibilité du désespoir suprême. Puis, enfin, magnifique, est l’espoir de la
renaissance. Cette eau profonde, eau ténébreuse de la noyade (cf. Bachelard, l’eau
et les rêves), se transfigure en eau purificatrice et régénératrice :
comme le soleil, chaque matin, renaît lavé et rajeuni, depuis le sein de la mer
où, comme un noyé, il avait disparu pour laisser place aux ténèbres de la nuit,
ainsi notre amour, véritable soleil, illuminera à nouveau notre ciel, ciel
transfiguré de l’éternel été. Seule une telle image cosmique est à la hauteur
de notre espérance, comme seule l’image de l’abîme l’était de mon désespoir.
Chacun sait, en effet, obscurément que nos sentiments ne sont pas dans notre
tête ou dans notre poitrine mais on la dimension d’un monde, monde que crée,
déploie et enrichit l’artiste. Ce pourquoi nous découvrons à travers le monde
imaginaire porté par son art, la jouissance partagée d’une communauté inédite
de pensée et de sentiment – nous ne sommes plus seuls (communion), nous sommes
plus riches (élévation) et davantage conscients (vérité).
Conclusion
générale
Alors que, dans la vie quotidienne,
nous sommes séparés des choses, des autres et de nous-mêmes par
le voile de l’utilité et de l’habitude, à travers la singularité d’un
artiste détaché du rapport quotidien au monde (expression de soi /
impersonnalité du quotidien), l’art semble nous donner à percevoir :
1) la richesse
d’un monde imaginaire propre et singulier.
2) qui résonne
en nous comme :
a) une communauté
spirituelle (sortie de la solitude);
b) qui est
nous (sans quoi nous ne la comprendrions pas, nous ne nous y reconnaîtrions
pas) et plus que nous (sans quoi nous ne l’admirerions pas) ;
c) qui nous
semble parfois dire l’essentiel – vérité et valeur;
d) qui est le sol et la nourriture de nos propres
créations, nous rendant à notre pouvoir propre d’imaginer, de rêver et de
créer…
C’est ce qu’en dernier lieu nous donne à penser ce
texte de Romain Gary (sur l’esthétique de Romain Gary, cf. lien)
« Ce qu’une œuvre laisse comme goût à ses lèvres, c’est le goût et le pressentiment d’un monde qui n’est ni celui de la réalité ni celui du roman. Je l’ai dit : l’art fait toujours de l’homme un personnage futur. C’est ainsi qu’agit la vérité artistique : comme une poussée vers «ce qui n’est pas» au goût de beauté, de plénitude, vers un « ailleurs » qui ne saurait être atteint et qui est la condition même de la course de la conscience-poursuite et de l’Histoire. C’est un ébranlement vers l’avenir sans désignation spécifique de cet avenir : aucun romancier ne le connaît, aucune œuvre d’art ne peut le faire voir. C’est essentiellement quelque chose qui n’existe pas, une aspiration, au sens de la dynamique, mais qui est liée au bonheur, au jouir, à la beauté, à l’assouvissement »
Romain Gary, Pour Sganarelle, p. 105
Eveillé par la force même de l’art, ce sont de nouveaux possibles
qui, en nous, creusent le monde d’un à-venir plus intense :
transformant nos regards, libérant nos désirs de leur gangue quotidienne,
sédiments d’une histoire endormie en nos chairs, «les symphonies font
soudain retentir, hors des salles de concert, des échos et des chœurs» (Romain
Gary) – rendant intolérable un réel figé qui ne sait pas «danser»
(Nietzsche). Par la mise en cause de la clôture satisfaite du réel sur
lui-même – la réalité instituée tendant à saturer les possibles futurs rendant
impensable l’imagination d’un véritable ailleurs (de là la puissance négatrice
de l’art soulignée par Paul Valéry) -, libérant les désirs vers un ailleurs de
beauté, que la puissance de l’art vient, en nos vies, d’éveiller, s’ouvre alors
en nous et pour le monde l’horizon des possibles, condition d’un devenir riche
de création. Aussi, dans et par sa coupure même vis-à-vis du réel commun, par
la transformation des désirs et regards qu’il opère, « ce champ de Van
Gogh, brûlant de génie, est un futur incendie de la réalité » (Gary).

Van Gogh, Reaper, 1889