Cours sur la conscience, deuxième partie
Abordant les notions : l’inconscient, la
société, la liberté, le sujet, le désir, la culture, l’interprétation, la
religion
II. La conscience est-elle une connaissance
de soi – du monde ?
. Si l’on suit les analyses de la première partie, ce qui définit
l’homme, à la différence d’un animal déterminé par une nature duquel il est
inséparé, c’est la conscience conçue comme liberté vis-à-vis des forces
naturelles. Parce que doté d’une conscience, tout homme serait ainsi par
définition un être libre : conscient du monde et conscient de soi,
regardant, jugeant et transformant tant le monde que sa vie depuis la distance
d’une position de surplomb, il serait toujours et nécessairement, acteur
libre de sa vie. Et c’est, de fait, en partie ainsi que nous nous percevons
spontanément : qui ne prétend savoir qui il est et connaître
suffisamment le monde de façon à ce qu’il s’abstienne de se consacrer à de
telles recherches ? Nous vivons la plus grande partie de notre vie dans l’évidence
et ce qui nous semble transparence = sans problème – sans question (cf.
cours d’introduction).
. Mais sommes-nous et le monde est-il, véritablement tels que nous en
avons conscience ? Autrement dit notre conscience est-elle
effective connaissance tant de nous-mêmes que du monde ? Du point de
vue de l’usage de la langue, nous avons vu, en effet, que par-delà l’identité
d’usage (perdre conscience – perdre connaissance), l’idée commune de « prise de conscience » ainsi
que celle de « degré de conscience » laissaient entendre que, loin
d’être effective connaissance, la conscience immédiate (précédant le choc
de la prise de conscience) pouvait être partiellement aveugle sur soi.
On distinguait alors la conscience comme ouverture au monde et à soi
(première partie), de la pleine conscience comme connaissance
effective du monde et de soi. Corollaire : si une telle différence est
avérée on devra distinguer une apparence de liberté (liée à la
conscience immédiate partiellement aveugle sur soi) de la liberté effective
et faire de cette dernière un projet et une tâche.
. Or si un tel problème se pose c’est que dès que l’on nous
interroge sur nos désirs, nos goûts, nos idées, nos amours, nos haines… - nous
apparaissons rapidement incapables de nous justifier, c'est-à-dire de
donner des raisons valables de ce qui pourtant semble nous constituer et
que nous vivons consciemment encore une fois comme faisant corps avec
nous c’est à dire transparent, évident, sans question…(voir sur ce point
les exemples de l’introduction –
Architecture, Terre, désirs ; pour d’autres, cf. + bas)… Etonnons-nous
d’une telle situation : ce qui nous apparaît immédiatement comme le plus
évident est en réalité – cad pour la raison ou la conscience qui réfléchit sur
elle-même - fort obscur.

. De là ces questions : a) comment fonctionne un tel
aveuglement de la conscience sur soi, aveuglement tel qu’il s’apparaît comme le
contraire de ce qu’il est (transparence et clarté) ? ; b) pourquoi donc (c'est-à-dire pour
quelles fins, quelle fonction – s’il y en a) une telle
méconnaissance ?
. De telles questions ouvrent directement sur la thématique de l’inconscient.
Qu’est-ce que (l’hypothétique) inconscient ? a) L’inconscient n’est pas
l’état inconscient (« être inconscient ») de celui qui a perdu
connaissance (sommeil, coma) – il n’est donc pas qu’une simple absence de
conscience. b) Au sens large, ce n’est pas seulement ce qui est non
conscient c'est-à-dire hors du champ de la conscience – ainsi
sommes-nous non conscients des infrarouges ou des ultrasons, de ce qui se passe
sur d’autres galaxies ou du métabolisme propre des milliards de cellules qui
nous constituent… ; c) C’est au sens dynamique ce qui, hors
du champ de notre conscience, la déterminerait à son insu (dans son
champ, dans son contenu).
. Aussi pouvons-nous distinguer trois formes hypothétiques d’inconscients :
a) un inconscient biologique soit l’ensemble des forces et
mécanismes de l’existence organique qui déterminent et limitent à son insu le
champ et le contenu de notre conscience ; b) un inconscient psychique
– celui, thématisé par Freud, que nous avons plus directement à l’esprit
lorsqu’on nous parle d’inconscient = le sens entendu du mot – qui désigne un
ensemble de forces psychiques qui déterminent à notre insu les contenus
conscients ; c) un inconscient social, conçu comme l’ensemble des significations
et des pratiques sociales qui, dans une société donnée, à un moment donné de
l’histoire, forment à notre insu notre corps, nos désirs et pensées.
![]() Posons donc clairement l’ensemble
des problèmes que nous devrons tenter de résoudre. S’il existe ce que nous
pouvons appeler un (ou des) inconscient (s), entendu(s) ici comme des forces
qui hors du champs de notre conscience la déterminent cependant à son insu
se posera pour nous le problème de savoir : 1) comment articuler cette
dimension inconsciente avec les dimensions phénoménales (vécues) de la
conscience reconnues en 1ère partie (distance à soi et au monde,
visée de liberté et de vérité…). 2) Comment penser la liberté, cette exigence
pour l’homme d’être le sujet (l’auteur) conscient de sa vie si la
conscience immédiate (être l’auteur de sa vie) en est illusoire ?
Posons donc clairement l’ensemble
des problèmes que nous devrons tenter de résoudre. S’il existe ce que nous
pouvons appeler un (ou des) inconscient (s), entendu(s) ici comme des forces
qui hors du champs de notre conscience la déterminent cependant à son insu
se posera pour nous le problème de savoir : 1) comment articuler cette
dimension inconsciente avec les dimensions phénoménales (vécues) de la
conscience reconnues en 1ère partie (distance à soi et au monde,
visée de liberté et de vérité…). 2) Comment penser la liberté, cette exigence
pour l’homme d’être le sujet (l’auteur) conscient de sa vie si la
conscience immédiate (être l’auteur de sa vie) en est illusoire ?
Méthode : on procédera dans cette analyse
toujours de même. Dans un premier temps, on en appellera au point de vue immédiat
de la conscience sur elle-même – point de vue duquel, êtres conscients, nous
partons toujours ; dans un second temps, on montrera le caractère
illusoire (c'est-à-dire erroné et cependant nécessaire) de ce point de
vue ; enfin, on analysera les conditions d’une libération vis-à-vis de ce
qui nous enferme et aliène.
A)
Le point de vue de la conscience sur elle-même
.
La conscience tend à se poser comme indépendante du corps et, plus largement, de
la nature, survolant de son regard un monde duquel elle semble détachée :
lorsque je contemple un paysage, j’ai l’impression de n’être pour rien dans le
spectacle que je perçois, pur regard, spectateur survolant le monde depuis une position
de surplomb – conscience détachée, indépendante du corps et de la nature.
.
Encore peut-on pousser plus loin un tel détachement en faisant de la nature
elle-même le songe de la conscience. Descartes : ne
m’arrive-il pas de rêver qu’il y a des corps autour de moi (une chaise, tel
individu…) alors même que ce ne sont rien que des produits de
l’imagination ? Qui me dit alors que je ne rêve pas ici ce que je crois
percevoir ?

.
La seule évidence que je détiens, indubitable, par delà le doute que je
peux poser sur l’existence effective des corps, c’est celle de ma conscience :
même si je rêve au moins est-il certain que j’éprouve un tel rêve = que j’en ai
conscience. Tout serait-il un songe (les autres, le lycée, les plantes
vertes…), resterait cependant, pilier indubitable, l’épreuve que je fais de
ma propre conscience.

.
N’ayant ainsi jamais accès au monde qu’à partir de ma (propre) conscience, je n’ai
en réalité jamais affaire qu’à des objets de conscience : ce que
l’argument du rêve fait déjà comprendre car quelle différence au sein même
de la représentation entre un arbre rêvé et un arbre perçu ? Ne
puis-je tout autant éprouver le rugueux de l’écorce, sentir la douce odeur du
tilleul, éprouver la chaleur du tronc, saisir le vert profond… en songe ?
Ce qui signifie qu’existant ou non en dehors de ma conscience, la seule réalité
de l’arbre à laquelle j’ai accès est ma conscience subjective qu’il y a ici
un arbre. Et que sont le rugueux, cette douce odeur, cette chaleur, la
profondeur d’un vert… hors de l’épreuve que j’en fais, c'est-à-dire de ce
que j’en ressens ? Important : je cherchais une claire
démarcation entre une nature indépendante de moi et moi-même,
sujet séparé la percevant passivement – et je m’aperçois que tout ce qui
m’entoure est d’étoffe subjective (c'est-à-dire dans les termes de
Descartes, « pensée »).

Commentaire rapide : doutant de
l’existence (hors de moi) de toutes choses, je ne peux pourtant douter de
ce que j’éprouve. Doutant de l’existence en soi de l’objet de ma pensée,
je suis cependant certain de son existence pour moi, c'est-à-dire de
son existence en tant que modalité de ma conscience. Ainsi je peux
douter si je marche ou non (je peux toujours rêver) mais je ne peux douter
que j’éprouve et pense marcher puisqu’une telle épreuve fait un avec ma
conscience qui s’auto - éprouve et s’auto - aperçoit.
.
De là l’hypothèse de Berkeley selon laquelle, n’ayant et ne pouvant
avoir nulle expérience de la matière et des corps indépendants (de ma conscience),
il n’y aurait en réalité ni matière, ni corps mais uniquement des
représentations conscientes, soit des réalités spirituelles. Dieu serait
alors cet être purement spirituel qui produit en moi ces représentations et
leur cohérence propre. Et, en effet, de la « chose en soi » –
c'est-à-dire de la chose telle qu’elle en dehors de mon esprit – nous n’avons
jamais que l’idée. Le rugueux de l’arbre ? Subjectif. Les atomes ?
Soit une simple idée – l’idée d’un insécable – et donc de substance spirituelle
(l’idée est un produit de l’esprit), soit quelque chose de perçu et alors,
encore une fois, d’étoffe consciente puisque réductible à l’épreuve
subjective que je fais d’une forme ou d’une couleur. De là à faire de
l’idée de matière ou de « chose en soi » une simple idée,
c'est-à-dire une réalité spirituelle sans répondant matériel,
c’est
le pas que franchit Berkeley. Telle est la position que l’on peut dire « spiritualiste radicale
» selon laquelle n’existe que des réalités spirituelles (pour
l’esprit, c'est-à-dire subjectives et conscientes).

Commentaire rapide : la cerise me
semble extérieure à moi, indépendante de moi, d’essence matérielle. Mais je
ne connais d’elle que mes sensations, c'est-à-dire une réalité
subjective et qui ne saurait exister hors de l’épreuve qu’en fait un
sujet – que serait, en effet, une saveur, une rondeur, une souplesse
hors de l’épreuve ressentie (subjective) qu’une subjectivité peut en faire ? D’une
réalité non sensible (non subjective, non ressenti) je n’ai que l’idée sans
preuve aucune de son existence (hors de moi).
.
Or, une telle position – quoique choquant fortement le sens commun - est
proprement irréfutable. Il se peut – comme dans le film Matrix - que la
vie soit un songe et si cela était n’ayant nulle vue du dehors de notre
conscience nous ne pourrions rien en savoir. Il se peut, encore une fois,
qu’il n’y ait pas d’autre réalité que spirituelle et que n’existe aucun corps
extérieur à notre conscience. Mais – comme le suggère Berkeley dans le texte
plus haut – si « nous ne pouvons être sûr de son existence »,
nous ne pouvons non plus l’être de son inexistence.
. Le fait que nous ne croyons pas à de tels arguments ne saurait
cependant être une preuve de leur non validité. Simplement, un autre discours
est possible qui rend à la fois compte de l’apparence et de l’illusion du
point de vue de la conscience sur elle-même et qui concorde davantage
avec le contenu même de l’expérience humaine (contenu dans lequel il faut
inclure le savoir qu’élaborent les sciences). Expliquant et intégrant
davantage de phénomènes (sans renvoyer finalement au seul inconnu ou à la
volonté de Dieu – ce qui est toujours possible et, encore une fois,
irréfutable), une telle explication me semble bien meilleure.
B) Le point de vue la conscience comme point de
vue illusoire
1) Considérations générales
. Comment la conscience pourrait-elle, en
effet, saisir un contenu qui ne soit pas conscient ? Comment pourrions-nous
donc appréhender quelque chose qui ne soit pas tissé de notre subjectivité, puisque
l’appréhender c’est le saisir avec nos sens, c'est-à-dire premièrement l’éprouver,
et qu’il n’y a d’épreuve de quoi que ce soit que subjective
(c'est-à-dire faite et éprouvée par quelqu’un capable de sentir et de
connaître) ? Comment, encore une fois,
la conscience s’évanouissant ne pourrait-elle vivre et penser cet
évanouissement comme celui même du monde, puisqu’il n’y a de monde pour nous
que sous l’horizon que notre conscience y projette ? Pour une main
consciente, par exemple – celle de la famille Adams - toute chose serait chaude
ou froide, rugueuse ou lisse, molle ou dure… c'est-à-dire de nature
préhensible. Où l’on comprend la nécessité de ce premier point de vue de
la conscience sur elle-même qui conçoit toute chose comme ayant sa propre essence
subjective et consciente, tout ainsi qu’une main consciente concevrait le monde
comme essentiellement pris sous ses manières de prendre.

« La chose » de la Famille
Adams
. Simplement, ce n’est pas parce que la conscience éprouve, perçoit et
pense les choses comme ayant sa propre forme, que les choses en elles-mêmes –
c'est-à-dire indépendamment de notre prise - sont effectivement de forme
consciente. Mieux encore, il se peut que la manière dont la conscience
appréhende les choses et s’appréhende elle-même soit intrinsèquement illusoire.
. Pourquoi donc parler ici d’illusion ? Rappelons tout d’abord ce qu’est
une illusion. L’illusion à la différence de l’erreur, dit Kant, ne disparaît
pas lorsque je comprends sa nature illusoire. Ainsi lorsque je calcule que 3 +
8 font 11, l’erreur antérieure selon laquelle une telle somme faisait 12
disparaît. Au contraire, j’ai beau savoir, par exemple, qu’un mirage n’existe
pas, je n’en continue pas moins de le percevoir.
Lisons sur ce point un texte très suggestif de Spinoza :

Commentaire rapide : nous serions analogues
à ces pierres imaginaires, lancées par des forces que nous n’avons jamais
choisies, que nous ne connaissons pas et que nous ne sentons pas. Ce désir
par exemple qui me pousse en avant vers cet objet d’amour, cette nouvelle
auto ou cette belle situation, je ne le vis pas comme une contrainte :
c’est moi tel que je me désire, tel que je désire être. Au contraire,
opposerait-on des obstacles à ma quête, dans l’insatisfaction je me sentirai
enfermé et non libre. Et pourtant, avons-nous
jamais choisi ces désirs qui font corps avec nous ? Nous savons, par
expérience, que nos désirs surviennent et ne sont guère déterminés
par un choix préalable. Ainsi, comme lancés, l’enfant qui désire son lait
ou son jouet, le bavard qui désire parler, l’amoureux qui désire sa belle…
ont-ils conscience de leur désir et de son objet, non des causes (des
forces) qui les poussent à désirer. A cette conscience immédiate,
conscience aveugle sur soi qui se vivant et s’affirmant libre croit être la
cause de son propre désir (« c’est mon choix ! ») on
opposera la connaissance médiate de la raison à laquelle apparaît le
caractère illusoire d’une telle liberté. Une forme d’inconscient –
au sens vu + haut – détermine et guide notre conscience à son insu.
. Ce qui vaudrait pour la conscience de nos propres désirs, vaudrait
tout autant pour la conscience immédiate du monde extérieur. Ainsi reprenant
notre exemple de la main, pouvons-nous concevoir la subjectivité et la
relativité de ce qui apparaîtrait à cette hypothétique « main
consciente » comme le monde lui-même. Un pur œil, en effet, ne
connaîtrait ni douceur, ni mollesse, ni chaleur – et pour la main seule il n’y
aurait, par exemple, nulle couleur. Autrement dit : ce sont des aspects
que nous pensons être le monde qu’une pure main ou un pur œil vivrait (ou
plutôt ne vivrait pas), faute de pouvoir les prendre, comme inexistants, le
monde se réduisant pour elle à ce qui a la forme de sa prise. Aussi,
écrit Montaigne, avant Kant « les yeux humains ne peuvent apercevoir les choses que par les formes de
leur connaissance » (Essais).
Or, demande t’il dans ses Essais
afin de nous faire saisir la relativité perceptive de ce que notre conscience
vit comme un absolu, en réduisant spontanément le monde à ce que nous pouvons
en sentir (cinq sens), combien d’autres « regards » possibles
n’éliminons-nous pas ? On pensera par exemple à celui du crotale ou de la
chauve-souris…

. Mais il faut mieux dire encore car ces aspects du monde que dévoilent
les sens ne le sont que pour nous c'est-à-dire pour des subjectivités
doués du pouvoir de sentir et de ressentir. « Pour nous »
c'est dire qu’aucune chaleur, aucune couleur comme aucun son… ne sauraient
exister hors de leur appréhension / constitution par une subjectivité. Dire,
par exemple, « le radiateur est chaud », c’est attribuer au
radiateur une qualité qu’il ne saurait en lui-même contenir – pour le
physicien, par exemple, il n’y a aucune qualité de chaleur dans les choses mais
simplement une certaine forme de mouvement moléculaire que nous appelons, parce
que nous sommes des êtres sentants, chaleur ; de même qu’il n’y a
aucun son ni aucune couleur, mais une certaine fréquence ondulatoire. Où
existent donc le son, la chaleur, la couleur… si ce n’est dans les choses
? Dans le cerveau de l’être conscient ? Mais disséquez un cerveau et
regardez si vous trouvez quelque chose comme la conscience du son, de la
chaleur ou de la couleur : de même que votre pensée et vos désirs, tout ce
qui vous est conscient est proprement immatériel n’existant que pour vous, subjectivement, à jamais
invisible à tout autre que vous. Ce que l’encéphalogramme peut dès lors mesurer
ce ne sont que des mouvements, des chocs électriques et des zones actives mais aucune
pensée ni aucun désir, car d’un autre ordre de réalité, invisible et subjective,
n’existant qu’à la première personne de celui qui les vit, ne saurait
apparaître sur son écran. Si donc aucun son ne saurait exister hors d’une
subjectivité, nous devons dire, par exemple, que le célèbre et hypothétique Big
Bang n’a fait aucun bruit… L’étonnement devant une telle conclusion est
important à méditer : c’est proprement inimaginable – nous ne pouvons nous
en faire nulle image, imaginer le Big Bang c’est le penser chaud, lumineux et
bruyant – et c’est pourtant ce que la raison, pensant la relativité subjective
de la perception, nous amène à conclure. Ainsi saisissons-nous sur le vif l’illusion
propre de toute conscience perceptive : croire que le monde est en
soi (en lui-même) tel qu’il est pour moi alors que 1) nous projetons sur la
nature les formes de notre perception, notre point de vue humain ; 2) nous
oublions que la nature en elle-même ne saurait contenir ces formes
subjectives ; 3) nous limitons le monde à ce que nous sommes capables d’en
percevoir.

. Ainsi loin d’être transparence et vision des choses telles qu’elles
sont en elles-mêmes, notre conscience est-elle naturellement auto et
anthropocentrique (se posant soi et l’homme au centre de ce monde) et
anthropomorphique (posant les formes de la perception humaine à même les choses
– ainsi la couleur dans les choses ou, dans un autre registre, les dieux dans
les cieux). Mais, propose Nietzsche en un raccourci fulgurant, « si nous pouvions nous entendre avec la mouche,
nous conviendrions qu’elle aussi évolue dans l’air avec le même pathos et sent
voler en elle le centre de ce monde (Introduction théorétique sur la vérité et le mensonge au sens extra
moral). C’est dès lors l’unicité close de notre monde perceptif humain qui
explose dans la considération de l’existence de millions d’autres mondes
subjectifs (les mondes animaux) et d’une nature qui excède tous nos
regards. « Le monde est redevenu infini », écrira ainsi
Nietzsche – contre une perception anthropo-socio-centriste qui ramène tout à
soi ; contre une science qui ramènerait le monde à un agencement matériel
homogène réduisant la pluralité infinie des apparences à l’homogénéité
quantitative du nombre.

Commentaire rapide : voyant le monde
à partir de soi et projetant sur lui les formes de sa connaissance et de
son attente, l’homme réduit le monde à lui-même. Ainsi, par exemple, juge t’il harmonieux ce qu’il peut
aisément saisir et désordonné ce qu’il ne peut compter ni comprendre. Mais
une intelligence divine ne pourrait-elle juger ordonné ce que nous sommes
incapables de voir ? Et, bien plus encore, cela a-t-il un sens pour la
nature elle-même de parler d’ordre, de désordre, d’harmonie, de perfection,
de beauté, de laideur… ? N’est-ce pas projeter sur elle des
considérations humaines qui ne valent que pour nous ? Or la
considération par la raison (qui questionne et met à distance la seule
perception sensible) des multiples mondes animaux et humains (cf. + loin,
« un inconscient social ? »), des mondes
microscopiques et de la relativité corrélative du jugement humain (« une
belle main », dit Spinoza, serait affreuse vue d’un microscope),
de l’infini temporel et spatial ainsi que de l’enchevêtrement infini des
causes et effets… devrait avoir pour conséquence : 1) de nous faire prendre
conscience des illusions de notre conscience ; 2) de relativiser le
point de vue humain ; 3) de nous mettre aux aguets devant toute connaissance
afin de saisir le champ de sa validité et ses limites ; 4) dans une
visée de savoir, d’ouvrir à notre pensée la considération d’autres échelles
et d’autres dimensions. Ainsi l’astrophysique tente t’elle de reconstruire
le scénario de notre naissance depuis l’explosion du Big Bang, l’éthologie
de nous ouvrir aux mondes propres animaux, la microphysique à la
logique des particules irréductible à notre logique ordinaire… ; 5) de
saisir l’ultime inconnaissabilité du tout, « l’ensemble des
ensembles ». L’univers du Big Bang (avec ses 15 milliards
d’années), demande ainsi le philosophe contemporain Marcel Conche, ne
peut-il n’être encore « qu’un éclair » (Montaigne) dans le temps et l’espace
infinis ? Qui saurait, à de telles échelles, répondre ?
. D’un point de vue général, la méthode utilisée ici pour que notre
conscience prenne conscience de sa propre relativité est le changement de
point de vue.
Ainsi pouvons-nous, avec Galilée, concevoir qu’alors qu’à notre vue, le
soleil semble tourner autour de la Terre – c’est ce que nous voyons, ce dont
nous sommes conscients – il en serait de même sur le soleil ou sur une autre
planète. Autrement dit : pensant par raison la relativité de mon
propre point de vue, je peux dépasser ce dernier et penser la nature
relative du mouvement (conception d’Einstein, déjà développée par
Galilée) : il n’y a absolument pas plus de sens à dire que a tourne
autour de b que le contraire, tout dépend du référentiel que nous
choisissons – et il n’y a pas de référentiel absolu (ce ne serait encore qu’un
point de vue). C’est en faisant le détour par la pensée d’autres points de
vue possibles que notre conscience se connaît elle-même comme point de vue
– alors même qu’elle ne cesse de s’apparaître (de se vivre) comme centre et
mesure de ce monde (ex. je vois le soleil se coucher). On identifiera alors la quête
de connaissance, comme un élargissement continu des perspectives, visant à situer
la validité relative de chacune d’elles en tentant de saisir un éventuel
(c’est une quête) point de vue global synthétique (quête de l’unité)
depuis lequel elles puissent s’expliquer.
. Notre tâche n’est pas pour autant terminée. Car si la conscience est point
de vue et interprétation, s’ouvre à nous la tâche : a)
d’élucidation de nous-mêmes soit la question de savoir pourquoi ce point
de vue-là et cette interprétation –ci ;
Il s’agira alors d’élucider la nature et l’origine des forces
inconscientes qui déterminent la forme particulière que prennent nos
consciences. Où nous allons retrouver nos trois inconscients. b)
d’élaborer une bonne interprétation – soit quelque point de vue qui
soit, d’une manière ou d’une autre, conforme à la vérité.


Analyse rapide 1) Toute existence
(animale, humaine) est interprétative – c'est-à-dire point de vue
subjectif sur le monde (par la structure des sens, de l’imagination, de
la pensée). 2) Si l’intellect humain
(notre raison) – ne saurait par
lui-même reconnaître une telle nature interprétative c’est que tout ce
qui lui apparaît est lui aussi pris sous sa propre perspective. Mais, si
comme tout regard particulier, il est conscient de l’objet situé devant
lui, il n’est pas – et ne peut pas être – conscient de la relativité
perspective de son propre regard. Ainsi projette t’il ses catégories –
c'est-à-dire ses manières de penser – à même les choses, aveugle à sa
propre projection : le monde est ainsi fait pour lui de causes et
d’effets, de substances et d’objets – de logique ! – mais c’est sa
propre logique qu’il lit dans les choses. 3) Certes, c’est bien
par l’intellect que l’on peut penser – en le dépassant – le caractère
perspectiviste des sens. Un pas de plus est à considérer : la mise en
cause de l’intellect par lui-même – par quoi nous saisissons le pouvoir
autocritique de la raison, capable de remettre en question les
conditions mêmes de son effectuation. Où nous sommes, cependant, jetés dans
un abîme car si je ne peux penser que par mes propres catégories -
cause/effet, par exemple- comment penser avec elles ce qui pourtant
leur échappe (- rait) ? 4) Ainsi la perspective
que souligne Nietzsche d’êtres capables de ressentir le temps autrement
(autre sens, variation) dans son caractère inimaginable et inintelligible –
puisque le temps, pour notre intellect, a un sens déterminé et unique –
révèle t’elle les limites de notre propre pensée, sans que, enfermés en
elle, l’on puisse dire s’il s’agit de pure fantasmagories ou de
possibilités réelles. 5) Quoi qu’il en soit,
Nietzsche note un acquis indépassable : nous avons dépassé la naïve
croyance anthropocentrique que portent nos sens et notre raison
humaine. « Le monde est redevenu infini » :
indéfinité des mondes animaux et humains, possibilité de nouvelles
interprétations fluides et légères dont l’art créateur (et la science comme
art !), rendant à notre pouvoir d’imaginer sa puissance, pourrait être
le vecteur. 6) Tout se vaut-il donc,
s’il y a une infinité d’interprétations possibles ? Le risque connu
est celui d’un relativisme à tout va – perdant tout jugement sur la valeur
et la vérité. Nietzsche suggère un critère (cf. notre conclusion plus
haut) : il ne s’agit pas de
suivre toute interprétation – de devenir chat, fourmi, aztèque ou chrétien
– car il y a des interprétations imbéciles – parmi lesquelles pour
lui – les religions. Imbéciles parce que : a) de faible
puissance de vie – on ne vit pas de manière intense et puissante à
travers elles, cf. ses analyses de la religion castratrice ; b) figeant le pouvoir infini de
l’imagination… Où l’on pourra juger qu’une bonne interprétation doit nous
faire vivre intensément et laisser ouvert le pouvoir créateur de
l’imagination, les deux étant intimement liés puisqu’on ne jouit vraiment
de soi qu’en créant (cf. cours sur le désir). Un tel caractère ouvert de
l’interprétation laisse ainsi entendre contre tout dogmatisme un
lien particulier à la vérité : une pensée ouverte, unique
garant contre l’illusion.
Schéma d’inspiration kantienne
mettant en lumière la nature subjective du champ de conscience
La conscience est une
activité subjective qui construit son objet sur la base de schémas et
structures qu’elle reçoit de l’extérieur de soi Le réel tel qu’il est en
lui-même, indépendamment de mon regard sur lui





2)
Un inconscient biologique ? – ce que la conscience doit au corps
. Première considération : la conscience ne naît pas par le
miracle du claquement de doigts de quelque divinité. Montaigne : nous
appelons « miracle » ce que nous ne comprenons pas,
hypostasiant (en faisant un être, ici un « miracle ») ce qui
ne mesure pourtant que le degré de notre ignorance (cela vaut d’ailleurs pour
toute forme de surnaturel). La conscience est une émergence de
l’organisme, lui-même produit de l’évolution du vivant.
« La
conscience n’est pas un empire dans un empire » (Spinoza) – cad cette
puissance cause de soi et de ses représentations, absolument libre de faire ce
qu’elle désire d’un corps que le sujet pourrait diriger tel le pilote et son
navire. Loin d’être un empire – c'est-à-dire souverain et indépendant du reste
du monde – Spinoza réinscrit la conscience dans le corps, c'est-à-dire
dans comme partie de la nature. Nous ne sommes, en effet, dit Spinoza,
conscient que des effets que produit sur notre corps la nature – nous sommes inconscients des causes (c'est-à-dire
de l’ensemble des relations réelles) qui produisent de tels effets.
Quelles seraient donc de telles causes inconscientes ?
a)
Ce qui apparaît à notre conscience / ce qui cause de telles
apparences : l’état du corps
Reconnaissons
l’ancrage de la conscience dans le corps. Le contenu (le nombre 31, un
autre sexué, la parole de Dieu…), le champ particulier (le nombre, le sexe, le
sacré…) et la profondeur intensive et temporelle de la conscience au travers de
ce champ (concentration, conscience fugace, obnubilation…) dépendent de
l’état général actuel de notre corps – 1) état contingent variable, 2) état
structurel.
1)
Etat contingent et variable du corps – quelques exemples
.
Lorsque nous sommes épuisés, nos pensées sont lourdes et pesantes, des champs
particuliers de pensée se rétrécissent et nous deviennent indifférents,
l’horizon est court et la tension peu intense (nous n’y avons
« plus le goût ») ; lorsque nous sommes au contraire « en
forme », nos pensées s’envolent, des horizons de pensée, des champs de
relations se déploient devant nous…
.
L’utilisation de diverses substances chimiques modifie plus ou moins fortement
la conscience tant dans son contenu, son champ que dans sa tension – du café
aux diverses drogues. Ex 1. les médicaments contre la dépression. Dépression =
affect de peine + idées noires (« Encore de la pluie, c’est bien ma
veine… »). Avec certains médicaments – antidépresseurs, euphorisants
- l’état affectif + la conscience que nous avons de nous-mêmes et du monde se
transforme (« O la jolie petite pluie... »). Ex. 2 : l’alcool et
les éléphants roses.
.
Sexualité et désir : le degré d’excitation est directement fonction de la
sécrétion de substances chimiques à l’intérieur de notre corps. Le désir sexuel
inassouvi = conscience obsédée – qui voit du sexe partout. Cf. la
transformation de la conscience de l’enfant à l’adolescent (obsédé) liée à la
transformation du corps. Cf. encore possibilité d’agir par médicaments sur le
contenu, l’intensité et le champ de la conscience (cf. les pédophiles – traitement
diminuant l’activité sexuelle ; la castration et ses effets ; plus
modestement la satisfaction qui laisse ensuite, momentanément, le champ de la
conscience libre pour autre chose, etc…)
.
Les lésions cérébrales qui ont des effets directs inconscients sur la
représentation du monde (cf. « l’homme qui prenait sa femme pour un
chapeau » de O. Sacks), des autres et de soi : incapacité à
saisir l’expression de visages confondus avec des choses, perte du sens de la
droite et de la gauche…
2)
Etat général structurel du corps.
.
Si dans leur variabilité, le champ spécifique, le contenu et l’intensité de la
conscience sont déterminés par des états, par essence, inconscients du
corps, la structure générale et invariable du corps et de ce corps-ci –
notre nature biologique – doit, elle aussi, être déterminante sur notre conscience.
.
La génétique étudie ainsi la problématique « action des gènes »
sur la formation et la régulation des organismes. Les gènes seraient la mémoire
de notre organisme, produit sédimenté en ADN de l’évolution de l’espèce et
d’aléas environnementaux. L’idée de « programme génétique »
selon laquelle notre organisme tout entier dans l’ensemble de ses fonctions –
dont, en ce qui nous concerne ici, la conscience avec ses caractères propres
que sont l’intelligence, le caractère, l’émotion, le désir… - serait le produit
causal de la seule action des gènes aboutit à faire de la conscience le pur
produit épiphénoménal (phénomène dérivé et secondaire) d’un inconscient
biologique : caractères, désirs, émotion, intelligence… et donc
comportement seraient déterminés par un cadrage génétique sur lequel nous n’avons
nulle puissance, la conscience naissant dans une nature vivante qui
la précède et l’excède. De fait, pour une énorme part de ce que nous sommes, nous
ne nous sommes pas choisis ; nous sommes en tant que vivants le produit
d’une longue évolution (3 milliards d’années) et nous portons en nous,
dans nos gènes, la mémoire de cette évolution.
.
Quelle influence des gènes sur nos comportements, nos désirs, nos émotions, nos
pensées ? Les biologistes ont pu, de fait, repérer l’influence de
certains gènes sur la schizophrénie ou le développement de troubles
maniaco-dépressifs…
Reste
que : 1) le repérage de telles influences est encore fortement limité, le programme
d’une détermination intégrale de la relation gènes / caractères – s’il n’est
pas chimérique - apparaît encore de l’ordre de la fiction ; de plus, le
caractère apparemment global des relations génétiques (un gène
n’équivalant pas à un caractère – mais n’ayant de sens que dans sa relation à
un ensemble d’autres gènes) interdirait peut-être en son principe la
possibilité d’établir une telle réduction – de là une première absurdité de la
quête du gène de la criminalité, de la pédophilie, etc. etc. ; 2) l’existence
d’influences ne signifie pas, pour autant, détermination intégrale.
Premièrement, si le gène est la mémoire du vivant, il n’y a de mémoire qu’en
acte. Le gène indépendamment du vivant au sein duquel il existe et se
réalise n’est, en effet, qu’une abstraction. Si l’on ne peut concevoir
l’existence du vivant sans les gènes (où sont engrammées ses structures
propres), la forme phénoménale de cette existence n’est pas une simple réplique
de la structure génétique – s’il n’y a, par exemple, pas deux jumeaux
identiques (et ce pas seulement chez les hommes – ce qui relève encore d’autres
facteurs), c’est parce que la détermination génétique n’est ni univoque, ni
automatique (allant des gènes à l’individu) mais suppose prise, analyse et
synthèse d’informations de la part du vivant au sein d’un environnement
aléatoire. Nombre de caractères qui semble ainsi innés, produits d’une
détermination génétique sont des acquis du vivant co-produits des gènes,
de l’interaction environnementale et de la computation (analyse, synthèse,
calcul) vivante. D’une manière générale la conception rigide d’un strict
déterminisme génétique en réduisant le vivant à la réalisation d’un programme
(celui de l’espèce) qui le précède et le détermine, oublie : a)
l’insertion de l’individu au sein d’un environnement qui le
co-détermine ; b) la plasticité
essentielle du vivant, soit son aptitude stratégique à l’adaptation et à la
résolution de problèmes dans un environnement aléatoire où l’automatisme ne
suffit pas à la survie. Chez l’homme, la part énorme due à cette interaction
environnementale particulière qu’est l’éducation dans la formation de la
conscience individuelle (intérêts, désirs, idées, conscience de soi…) laisse,
quant à elle, sérieusement douter de l’éventuelle omnipotence de la
détermination génétique - nous verrons sur ce point, quelle influence énorme a
la culture sur la conscience individuelle (cf. 4 – « un inconscient
social ? »).
b)
L’amour comme illusion de l’espèce
Prenons
au sérieux, cependant, l’idée d’un inconscient biologique et analysons
sa force et le degré de sa validité dans le champ de ce qui constitue une
expérience majeure de la conscience, celle de l’amour. Dire que notre conscience
de l’amour est le produit d’un inconscient biologique (la déterminant à son
insu) signifie que la conscience que nous avons de l’amour serait intrinsèquement
illusoire. Que servirait-elle alors ? L’espèce, à notre insu.
L’amour ne serait ainsi que la manière illusoire dont apparaît à la conscience
la tension reproductrice de l’espèce, cette dernière tenant alors lieu de cet inconscient
essentiellement biologique qui déterminerait notre conscience. Telle
est la « métaphysique de l’amour » de Schopenhauer :
« L’égoïsme en chaque homme a des
racines si profondes, que les motifs égoïstes sont les seuls sur lesquels on
puisse compter avec assurance pour exciter l’activité d’un être individuel.
L’espèce, il est vrai, a sur l’individu un droit antérieur, plus immédiat et
plus considérable que l’individualité éphémère. Pourtant, quand il faut que
l’individu agisse et se sacrifie pour le maintien et le développement de
l’espèce, son intelligence, toute dirigée vers les aspirations individuelles, a
peine à comprendre la nécessité de ce
sacrifice et à s’y soumettre aussitôt. Pour atteindre ce but il faut donc que
la nature abuse l’individu par quelque illusion, en vertu de laquelle il voit
son propre bonheur dans ce qui n’est, en réalité, que le bien de
l’espèce ; l’individu devient ainsi l’esclave inconscient de la nature, au
moment où il croit n’obéir qu’à ses seuls désirs. Une pure chimère aussitôt
évanouie flotte devant ses yeux et la fait agir. Cette illusion n’est autre que
l’instinct. (…) L’enthousiasme vertigineux qui s’empare de l’homme à la vue
d’une femme dont la beauté répond à son idéal, et fait luire à ses yeux le
mirage du bonheur suprême s’il s’unit avec elle, n’est autre chose que le sens
de l’espèce qui reconnaît son empreinte claire et brillante et qui par elle
aimerait se perpétuer » (Schopenhauer, Le monde comme
volonté et représentation)
Analyse
détaillée
1)
« L’égoïsme en chaque homme a des racines si profondes… ».
Qu’est-ce donc que l’égoïsme ? C’est le fait de n’agir qu’en vue de ses
propres intérêts sans donner au point de vue de l’autre une valeur propre dans
ma prise de décision (altruisme) (ego = moi / alter = autre). Quelles sont donc
ces racines « si profondes» de l’égoïsme ? Elles sont biologiques
c'est-à-dire ancrées dans la vie – ce que Schopenhauer dit de l’homme peut
ainsi se généraliser à tout être vivant. Qu’est-ce qui caractérise, en effet,
de ce point de vue, un être vivant ? Un être vivant – de la bactérie à
l’homme – n’existe jamais que pour lui-même, percevant le monde à partir
de soi, visant des fins (nutrition, reproduction) dont il est pour
lui-même le centre. Aussi, écrit Schopenhauer, « chaque individu,
en dépit de sa petitesse, bien que perdu, anéanti au milieu d’un monde sans
bornes, ne se prend pas moins pour centre du tout, faisant plus de cas de son
existence et de son bien-être que de ceux de tout le reste » (Le
monde comme volonté et représentation). C’est vrai de mon chat - et ici de
Garfield – mais c’est déjà vrai
d’une
amibe, par exemple.





Dit
autrement, selon la catégorisation de Cornélius Castoriadis (Le monde
morcelé), tout être vivant est un sujet – non ici entendu comme cet
être libre cause de soi – mais comme un
être doté de la dimension subjective du « pour soi » :
contrairement à la simple matière qui n’est jamais qu’unidimensionnelle,
sans profondeur, ni dimension intérieure, tout être vivant serait : a)
autocentré – se vivant comme le centre de son monde ; b) autofinalisé
– mue par une tension interne qui fait un avec lui - tout
être vivant se fait et se vise; différence avec l’être matériel qui ne
connaît de causes qu’extérieures ; c) doté d’un monde propre – le
monde de la plante, de la mouche, du chien… Avec le vivant apparaîtrait ainsi
un « mode d’être étranger aux soleils, aux planètes, aux
atomes » (Hans Jonas, cf. tableau résumant sa
philosophie de la vie), celui d’un être toujours en tension, se visant
et se faisant lui-même dans la lutte précaire pour exister.
On
comprend dès lors la raison de la profondeur des racines de l’égoïsme
humain : c’est « dans l’égocentrisme de l’unicellulaire ou déjà l’individu contingent,
périphérique, éphémère, se pose, le bref instant de son existence, au centre de
son univers »
(E. Morin, La vie de la vie) que ce dernier s’enracine. Je ne peux,
de fait, faire autrement que de me vivre au centre de mon monde – même si je
peux penser au-delà ; tout réveil le matin, toute pensée, toute
perception… partent de ce point premier, de ce site autocentrée que j’occupe
toujours ; une douleur aux dents en tant que je l’éprouve et que je suis
le seul à l’éprouver est plus terrible pour moi que n’importe quel
génocide ; de l’autre côté, la douleur de l’autre n’est jamais pour moi
qu’une représentation (image ou idée) à laquelle je puis bien compatir mais que
je ne peux réellement vivre : la baffe que reçoit le voisin est toujours
moins douloureuse et humiliante pour moi ; pour agir il faut enfin
que j’y sois intéressé, c'est-à-dire que les fins que je me
propose me touchent d’une certaine façon – sans une telle condition, pas
d’action possible : on n’agit pas pour rien, sans aucun motif – il
faut que j’éprouve un intérêt pour telle action.


2)
Si, cependant, l’individu vivant est pour lui-même son propre centre,
s’il n’agit que s’il y ressent un intérêt propre, on se demande alors
comment l’espèce peut bien vivre et se reproduire. Une telle
reproduction ne nécessite t’elle pas le sacrifice de l’individu –
comme, à l’extrême limite, ces mâles immolés après l’accouplement par la mante
religieuse ? Pour que l’espèce survive ne faudrait-il pas que l’individu
soit altruiste – c'est-à-dire agisse pour les autres en faisant
abstraction de soi ? Or, du fait de la structure subjective
autocentrée du sujet vivant, c’est ce qui ne se peut. Comment donc l’espèce se
reproduit-elle ? En se servant de l’individu à son insu, nous dit
Schopenhauer : « pour atteindre ce but il faut donc que la nature
abuse l’individu par quelque illusion, en vertu de laquelle il voit son propre
bonheur dans ce qui n’est, en réalité, que le bien de l’espèce ;
l’individu devient ainsi l’esclave inconscient de la nature, au moment où il
croit n’obéir qu’à ses seuls désirs ». Tel est l’instinct et ici le désir
sexuel – l’éros. Eros, ce désir qui, pour le moins qu’on puisse dire,
inonde la conscience, serait le moyen par lequel à mon insu – et à l’insu de
tous les animaux – l’espèce se reproduit. Qu’est-ce qui permet à Schopenhauer
de poser une telle priorité de l’espèce sur l’individu ?
3)
Tout d’abord, un jugement de la raison sur la position relative de
l’individu à l’égard de la nature puis à l’égard de l’espèce. « L’individu est un
quantum d’existence, éphémère, discontinu, ponctuel, un
« être-jeté-dans-le-monde » entre ex nihilo (naissance) et in nihilo
(mort), et c’est en même temps un sujet qui s’auto-transcende au-dessus du
monde. Pour lui, il est centre de l’univers. Pour l’univers ce n’est qu’une
trace corpusculaire, un froissement d’onde. Pour lui il est sujet, pour
l’univers il est objet » (E. Morin, La vie de la vie, p.194).
Celui qui se prend pour un centre n’est, matériellement parlant qu’un vent de
mouche dans le grand univers. De même, celui qui vit le temps et l’espace comme
restreint autour de sa personne, n’est aussi, en tant que membre de
l’espèce, que le nième produit de telle espèce donnée (la 3041003ème
fourmi de la grande fourmilière) ; elle-même étant encore, du point de vue
de la vie – alors même que l’on peut, peut-être, cf. + loin (4), parler d’un sujet
collectif que serait l’espèce – un produit temporairement fixé de
l’évolution des vivants (alors même que telle espèce tend à se reproduire en
tant qu’espèce – et à s’opposer à telle autre espèce, produit de la même
évolution). Face à de telles considérations, notre raison doit redresser
l’ordre des choses et remettre les perspectives tendant à se poser comme autant
d’absolus (le sujet individuel, l’espèce elle-même puis l’évolution du vivant
dans la grande matière) à leur place – et ce, c’est l’immense difficulté, sans
réduire cependant une réalité sur une autre, sans abolir ce qui a une dimension
réelle (par exemple le vécu de l’individu). Aussi, préfigurant un tel
programme, Pascal écrit-il dans ses pensées : « chacun est un tout
à soi-même, car, lui mort, le tout est mort pour soi. Et de là vient que chacun
croit être tout à tous. Il ne faut pas juger de la nature selon nous, mais
selon elle ». Juger de la nature selon elle – c’est tenter par notre
raison, de resituer les perspectives particulières dans les ordres naturels
dont elles dépendent et qui les co-déterminent. Ainsi, du point de vue
de l’espèce, pouvons-nous dire que la mort individuelle n’est rien – alors
qu’elle est tout pour nous - celle-ci n’étant que le moyen par lequel l’espèce se
continue (et ainsi, peut-être, de la mort de l’espèce du point de vue de
l’évolution).
4)
Si donc l’espèce peut être considérée par Schopenhauer comme ontologiquement
(du point de vue de l’être) première par rapport à tel ou tel individu, c’est
qu’aucun individu vivant ne s’est créé lui-même – l’individu en tout son être
est traversé par le genos (« race » en grec) c'est-à-dire par
les lois de l’espèce qui vit à travers lui. Produit de membres de
l’espèce, il reproduit dans son individualité – sa forme, ses facultés,
ses pulsions - la structure de l’espèce. Celle-ci inscrite en lui sous la forme
des gènes est une mémoire – celle de l’évolution – que fait revivre à
chaque instant en lui l’existant singulier pour se former et se re-former. Tous
les actes de l’individu vivant ont ainsi pour condition la formidable
complexité organisationnelle des structures de l’espèce. Aussi, notre regard
délaissant les individualités vivantes pour saisir le flux de leur reproduction
par milliers, millions, milliards, pouvons-nous saisir à travers ce flux même,
une réalité, celle de l’espèce, qui se perpétue. De ce point de vue,
l’individu apparaît comme une simple manifestation, un simple exemplaire de
l’espèce, réalité véritable sous-tendant l’apparence phénoménale de la diversité
individuelle. C’est dans cet ordre d’idée (schopenhauerien) que le biologiste
Dawkin a pu récemment écrire que « l’individu est l’instrument par
lequel les gènes se reproduisent » (Le gène égoïste). Un
inconscient biologique gouvernerait à notre insu la conscience que nous avons
de nous-mêmes.
5)
Mais si n’existent jamais que des individus (je ne vois que des chevaux, êtres
subjectifs, irréductibles en ce que ne pouvant occuper le même site ontologique
– cf. l’impartageabilité d’une douleur -, jamais le cheval), comment la
« pulsion » générique de l’espèce se manifeste t’elle au sein de la
subjectivité vivante ? Schopenhauer fait de « l’instinct »
– et ici de l’éros - le point
de jonction à l’intérieur de l’individu entre le subjectif (éprouvé, ressenti
à la première personne) et la réalité générale et générique de l’espèce. C’est
que l’éros est, en effet, une tension subjectivement éprouvée et de très
forte intensité. Mais, en même temps, c’est une tension folle, une ivresse
d’une puissance telle qu’elle emporte l’être qui l’éprouve et semble le
dominer. Cette puissance semble s’imposer avec la quasi-nécessité d’une loi de
la nature. « Deux bêtes, deux chiens, deux loups, deux renards, rôdent par
les bois et se rencontrent. L’un est mâle, l’autre femelle. Ils s’accouplent.
Ils s’accouplent par un instinct bestial qui les force à continuer la race,
leur race, celles dont ils ont la forme, le poil, la taille, les mouvements et
les habitudes. Toutes les bêtes en font autant sans savoir pourquoi ! Nous
aussi… » (Maupassant, un cas de divorce). Il faut donner à
cette puissance sa juste place dans la nature : « ce n’est pas
seulement dans les armes des hommes à l’égard des belles créatures qu’Eros fait
sentir sa puissance. Il a beaucoup d’autres objets et règne aussi sur les corps
de tous les animaux, sur les plantes, en un mot sur tous les êtres »
(Platon, Le banquet, discours d’Eryximaque) allant jusqu’à donner chez
Maupassant l’image d’une nature emportée dans un rut universel. A
travers un tel rut, hommes et bêtes mêlés accompliraient à leur insu la loi
de la nature. Et,
en effet, à bien regarder les êtres de notre espèce, une multitude de gestes et
de mots semblent pris dans la tension d’éros : approche de
séduction, propos grivois, fantasmes à tout va… « Ils ne pensent qu’à
ça ». Une tension plus forte que nous – « c’était plus fort
que moi » - semble nous conduire inéluctablement de l’attirance à la
jouissance. Ce pourquoi beaucoup s’y laissent prendre – avant, sens calmés et
l’œuvre de la nature à leur insu réalisée, de retrouver leurs esprits et de
« réaliser ».
Ainsi chez Maupassant de la
jeune fille d’Une partie de campagne, séduite et emportée, qui juste
après l’extase fond en sanglots ; ainsi encore de l’amant de la mante chez
qui l’amour aveugle se paye par après de quelque désillusion.
L’absence d’une telle chaîne
d’obsessions chez l’enfant (cf. dessin de Quino) (il en a d’autres, cf. Freud),
sa (relative) disparition chez le vieillard et son explosion dès la puberté,
marquent la nature biologique de cette force d’éros qui envahit notre
conscience.

6) Ainsi par la force d’éros
serions-nous les pantins d’une pièce qui se jouent derrière nous. La beauté
d’une femme, l’idéal amoureux – de Roméo à Arlequin, les poèmes chantant
l’amour … « pures chimères » envoûtant la conscience et puis
qui disparaissent avec la jouissance. L’ennui des vieux amants, les scènes de
ménage et la vaisselle cassée… marqueraient ainsi pour le vieux Schopenhauer,
la fin de l’illusion, parmi une ribambelle d’enfants pleurnichards près,
dès l’adolescence, à reprendre le fleuron…
7) Mise en relation des concepts sous-jacents
de : sujet – liberté – désir – conscience – inconscient – nature.
Alors que la conscience semblait faire de nous des sujets maîtres de leur vie
c'est-à-dire libre vis-à-vis de la nature, Schopenhauer pense ici cette
conscience comme essentiellement illusoire. Elle serait en réalité mue par un
désir reflétant la tension inconsciente propre de l’espèce.
L’arrachement de l’homme à la nature qui définit la
liberté ne serait dès lors que l’illusion par laquelle la nature réalise sa
visée, l’homme n’ayant conscience que de ses désirs mais non des causes qui le
poussent à désirer (Spinoza) – tel serait ainsi l’inconscient biologique,
puissance de l’espèce se manifestant à travers l’illusion d’un désir propre à
soi.

Conclusion
et critique
.
Il est indéniable qu’éros est une force corporelle sexuelle ;
commune aux vivants dont la reproduction nécessite le rapprochement de deux
individus ; qui s’ancre ainsi dans la tension de la reproduction de
l’espèce ; que tout être vivant porte en lui du fait de son
origine dans le genos commun engendrant une nature corporelle
d’exemplaire particulier d’une espèce donnée. C’est indéniable – mais l’amour
humain s’y réduit-il ? Autrement dit : sans nier l’ancrage de l’amour
dans notre nature biologique – n’y a-t-il pas spécifiquement dans l’amour
humain des dimensions qui échappent à une telle
réduction ?
.
C’est notamment le thème d’une profonde nouvelle de Maupassant, L’inutile beauté. En voici la trame : une
belle femme de trente années ayant passé toute sa jeunesse a tenir le rôle biologique
de génitrice imposé par les pulsions sexuelles et jalouses de son mari, se
révolte contre une telle condition. Elle échappe aux étreintes sexuelles de ce
dernier en lui faisant croire que, parmi ses enfants et sans lui dire lequel,
un n’est pas de lui : incapable de vivre dans le doute, le mari quitte alors
le foyer. On retrouve alors cette femme, magnifique de splendeur, libérée du
poids de la grossesse, c'est-à-dire de son corps naturellement animal non pour
porter un corps mortifié et qu’il faudrait nier (cf. la religieuse et l’idéal
ascétique : se libérer du corps biologique par la négation de tout ce qui
rappelle et appelle le désir) mais un corps transfiguré, élevé, magnifié,
d’un érotisme sublime, une beauté inutile et mystérieuse… Un corps qui se
révèle ainsi au regard soudain ouvert de son ancien mari :
« Il
la regardait bien en face, si belle, avec ses yeux gris comme des ciels froids.
Dans sa sombre coiffure, dans cette nuit opaque des cheveux noirs luisait le
diadème poudré de diamants, pareil à une voie lactée. Alors, il sentit soudain,
il sentit par une sorte d'intuition que cet être-là n'était plus seulement
une femme destinée à perpétuer sa race, mais le produit bizarre et mystérieux
de tous nos désirs compliqués, amassés en nous par les siècles, détournés de
leur but primitif et divin, errant vers une beauté mystique, entrevue et
insaisissable. Elles sont ainsi quelques-unes qui fleurissent uniquement
pour nos rêves, parées de tout ce que la civilisation a mis de poésie, de luxe
idéal, de coquetterie et de charme esthétique autour de la femme, cette statue
de chair qui avive, autant que les fièvres sensuelles, d'immatériels
appétits »
Là
où, fait dire Maupassant à l’un de ses personnages, la nature (ici appelée
ironiquement « divine providence ») fait de nous de simples
reproducteurs stupides, nous avons à nous construire dans une dimension que
ne connaît pas la nature, celle de la poésie, de l’idéal, du sens :
« Tout
l’idéal vient de nous, et aussi toute la coquetterie de la vie, la toilette des
femmes et le talent des hommes qui ont fini par un peu parer à nos yeux, par
rendre moins nue, moins monotone et moins dure l'existence de simples
reproducteurs pour laquelle la divine Providence nous avait uniquement animés.
Regarde ce théâtre. N'y a-t-il pas là-dedans un monde humain créé par nous,
imprévu par les Destins éternels, ignoré d'Eux, compréhensible seulement par
nos esprits, une distraction coquette, sensuelle, intelligente, inventée
uniquement pour et par la petite bête mécontente et agitée que nous
sommes ? »
Maupassant
renverse ainsi la thèse de Schopenhauer. Là où l’art - la poésie,
les toilettes, les fards, l’érotisme, les jeux subtils de la séduction… -
n’était qu’un artifice, une apparence ayant la fonction illusoire
de masquer l’essentiel à savoir ce qui se joue dans la nature,
soit la reproduction de l’espèce, Maupassant insiste sur la dimension
nouvelle instaurée par l’homme, celle de la culture, véritable pied
de nez jeté à cette nature stupide et aveugle (que nous sommes certes aussi)
qui ne nous promet qu’un cycle répétitif de besoins et nulle autre issue que la
mort. Profondément inutile, la beauté n’a pas d’utilité masquée –
ce n’est pas le moyen apparemment inutile mais en réalité fort utile par lequel
l’espèce attire entre eux les sexes – comme il le semble encore dans
l’éthologie animale (ou comme on la lit et la construit…) – elle est le
contraire de toute fonction, le gratuit, le « pour rien »
par quoi se révèle le désir humain de hauteur, le refus de la pesanteur
(nature) et, mue par un tel désir, la capacité créatrice de
l’imagination qui sur le corps animal sculpte un corps sublime, sur son cri le
chant, sur ses gestes saccadés la danse… - sur la nature, la culture.
.
Et, en effet, Schopenhauer opère un ensemble de réductions qui le rendent incapable
de penser la spécificité humaine. Réduisant la culture à la nature,
la signification des discours à l’absence de sens d’une pulsion générique, la
poésie au prosaïque, la conscience à l’inconscient, l’individu à l’espèce, le
corps humain au corps animal… il suppose - certes pour de suite les dénier -
des réalités (l’individu, la conscience, la poésie, le sens, la culture…) que
son discours pourtant ne peut pas expliquer. Car qu’éros se thématise chez
l’homme en discours et en sens, qu’il faille « mettre les formes »
et donner un sens à ce qui chez l’animal est vécu sur le mode immédiat d’une
pulsion muette et aveugle, voilà précisément ce qu’il faut expliquer. Le chien
y met un peu moins de fioritures – c’est le moins qu’on puisse dire. Autrement
dit, c’est précisément cette distance – serait-elle apparente -
vis-à-vis de l’immédiateté de la pulsion muette dont il faut comprendre la
possibilité. A la réduire sans l’expliquer, depuis la hauteur (celle de la
vie) où se situe ici Schopenhauer, c’est le jeu de la mise en scène dans
ses multiples variantes créatrices – jeu individuel des hommes pouvant
inventer de nouvelles manières de dire et de faire l’amour – jeu social des
cultures – créant de nouvelles manière de cultiver éros… qui sont proprement
incompris.
.
Le fait supplémentaire et hautement significatif que l’individu, dont on fait
pourtant un agent de l’espèce, puisse chez l’homme détourner la finalité
reproductive de la sexualité au profit du plaisir (invention même de l’érotisme
comme art du plaisir, utilisation de la contraception…) ne marque t’elle pas
qu’avec l’homme éros change profondément de sens ?
.
Or ce n’est pas en expulsant éros de l’humain (en faisant de ce dernier un être
éthéré) mais en creusant sa spécificité humaine que l’on est saisi de son étrangeté
à la simple animalité. Chez l’homme, en effet – et pour quelles
raisons ? – tout semble indiquer une défonctionnalisation du désir
érotique. Alors que, dans l’immense majorité des cas, la sexualité animale est
réglée sur les rythmes de l’espèce (pas de sexualité hors des cycles de
reproduction), l’homme a pour spécificité d’avoir une sexualité débridée -
débridée (libérée) des chaînes de la fonction biologique. Ainsi que le dit un
des personnages de Beaumarchais à qui une dame quelque peu guindée reprochait
la bestialité (c'est-à-dire l’animalité – l’ancrage dans la nature) :
« faire l’amour à tout va et boire sans soif, tel est justement le
propre de l’homme ».
.
Autre caractère d’éros chez l’homme, c’est la totalité du corps qui
devient potentiellement zone érogène – c'est-à-dire source de plaisir (de là
l’art de la caresse). A comparer à la limitation (et à la fixité) de
l’érogénéité du corps animal. Si l’on sait, de plus, qu’une telle érogénéité du
corps n’est pas séparable de la signification de la caresse (qui ?,
comment ? quand ? où ? de quelle manière ?) c'est-à-dire
d’un halo imaginaire de sens dont elle dépend entièrement (cf. une
réponse variable à la question « avec qui ? » peut faire
passer la caresse du magique à l’horreur – notez qu’alors même que
matériellement parlant la caresse est la même, identité des stimuli, c’est le
sens imaginaire donné à cette épreuve corporelle qui la transforme en
expérience sublime ou répugnante), il faut dire que le corps érogène de l’homme
est un corps doté d’une dimension inconnue de l’animal, un corps imaginant
et signifiant.
. Résumons donc la critique que
l’on peut établir de la thèse d’un inconscient biologique déterminant à son
insu notre conscience en faisant du sujet une illusion et un jouet de
l’espèce : c’est la différence spécifique de l’homme et de l’animal qui ne
peut être ainsi réduite. Aucune réduction ne permettra de passer de ce qui est
une nécessité aveugle et muette à l’inventivité des gestes et des discours
poétiques, à la compréhension de l’érogénéité potentiellement totale d’un corps
imaginant et signifiant, aux jeux de l’amour humain. Eros, trace générique
en nous de notre nature animale, dépôt ancré dans le corps individuel de
l’évolution de l’espèce, devient dans et avec l’homme autre chose –
autre chose qui suppose tout au moins, l’apparition d’un mode d’être inconnu
de l’animalité, à savoir l’instance imaginaire psychique créatrice de
significations. Cette dernière est donc non déductible depuis une nature
qui ne saurait la contenir : si un simple « je t’aime »
n’existe pas pour mon chien cela ne signifie pas, sauf à nous réduire à un
chien, que ça n’a pas de sens – mais, tout au contraire, qu’une autre
dimension est ouverte, celle du sens – serait-il mensonger -
inexistante pour l’animal, dimension qu’il s’agit de penser dans sa
spécificité.
Transition : ceci nous amène à reconnaître ce mode d’être particulier qu’est la réalité psychique humaine. Mais l’existence d’une réalité irréductible au seul biologique ne signifie pour autant la totale liberté de l’homme à son égard : on ne comprendrait pas alors comment on peut être assailli par des pensées creusant au sein de notre conscience angoisse et étrangeté. Au contraire, l’hypothèse freudienne d’un inconscient psychique laisse entendre que la pensée humaine « n’est plus maître(sse) en sa propre maison ».
3)
Un inconscient psychique ?
a)
L’irréductibilité du psychisme. Qu’est-ce que la
réalité psychique et en quel sens peut-on la poser comme irréductible à la
nature organique ? Si la réalité psychique est irréductible à la nature
organique c’est qu’on ne peut déduire la première de la seconde. Le
psychisme humain échappe à la réduction à une réalité organique par le
fait qu’une autre dimension, inconnue au niveau de la matière et de la vie
simplement animale se creuse et se déploie. Au niveau de la seule matière,
n’existent ni affect, ni désir, ni perception – aucun monde propre lequel
n’advient à l’être qu’avec le vivant. Mais, à son tour, pour le simple vivant les
formes multiples, mouvantes et contradictoires du désir, des sentiments et des
mondes imaginaires (un Requiem, Guernica, mon rêve d’hier…) qui tissent la
vie psychique de l’homme n’existent simplement pas.
Il
s’agit ici de dimensions nouvelles qu’il faut appréhender pour
elle-même – et qu’on ne saurait réduire (c'est-à-dire en rendre
intégralement compte) même si l’on peut, par la médiation de psychotropes, par
exemple, les détruire ou susciter leur production ; ou bien
analyser la relation entre telles représentations psychiques et les
localisations cérébrales, etc. Du chimique au psychique il y a certes passage,
action effective mais une telle action suscite une réélaboration
imaginaire dont on ne peut rendre compte au niveau simplement chimique. On
aura beau, par exemple, analyser les relations entre tel champignon et telles
hallucinations, cela ne nous fera pas avancer d’un chouya dans la compréhension
du sens particulier de l’hallucination – sens accessible pour nous soit par le
récit de l’halluciné, soit par expérience directe d’un vécu imaginaire.
Fondamentalement : si le processus chimique est un observable localisé
dont on peut analyser la causalité propre, le psychique est une réalité, elle,
non étalée, qui n’existe qu’à la première personne et qui est invisible à tout
observateur. Ce qu’on peut alors observer c’est la concomitance entre le
récit ou l’expérience psychique propre de l’expérimentateur et telle causalité
somatique mais on ne saurait réduire l’une sur l’autre. Aussi un
expérimentateur extra-terrestre qui ne connaîtrait rien du désir, de l’image,
du sens… ne rendrait compte que de relations somatiques, sans les lier à un
quelconque vécu psychique, faute de pouvoir le comprendre c'est-à-dire de
relier les dires de son patient à sa capacité de vivre et d’imaginer son
expérience propre. Bien plutôt que la réduction du psychisme au somatique,
l’extraordinaire est bien plutôt le passage entre ces minuscules transformations
physiques que sont, par exemple, des lésions cérébrales et la transformation
radicale des mondes propres des malades (cf. O. Sacks, L’homme qui
prenait sa femme pour un chapeau), transformations aboutissant parfois à la
création de mondes inouïs et fantastiques dont on ne peut rendre compte sans
prendre en compte la capacité élaboratrice et ré-élaboratrice de
l’imagination humaine.
Si
donc la réalité propre du psychisme humain n’est accessible qu’à la première
personne et compréhensible uniquement par un être doté de vie psychique et de
la capacité libre d’imaginer ce qu’il ne vit pourtant pas, il faut dire avec
Freud qu’une relation directe entre la vie psychique et le système nerveux,
« existerait-elle, ne fournirait dans le meilleur des cas qu’une
localisation précise des processus de conscience, et ne contribuerait en rien à
leur compréhension » (Abrégé de psychanalyse). Comprendre
c’est, en effet, saisir le sens d’un dire ou d’une image, ce qui
signifie éprouver et imaginer ce qu’au-delà de sa trace matérielle, ils veulent
dire. Vouloir dire signifie que : a) la réalité perçue est le signe
d’autre chose que de soi, elle renvoie à un ailleurs (le mot
« chien » à la signification « chien » qui elle-même
renvoie à d’autres significations indéfiniment…) – suppose l’imagination comme
capacité de voir dans ce qui est autre chose ; b) cet ailleurs est la
dimension de la signification – dimension dans laquelle, par
l’imagination, je me projette dès que je comprends par exemple, la
phrase « vivent les éléphants roses » - dimension
essentiellement interprétable puisque je peux toujours me demander, ce
qui est ici entendu par « éléphants roses », les motivations
d’un tel énoncé, si la signification « rose » ne renvoie
pas elle-même à la fleur, aux filles, aux bonbons, à la couleur noire dont il
constituerait la dénégation, etc…
b)
Trois traits du psychisme humain irréductibles à la nature organique
Ceci nous amène à
reconnaître, avec Castoriadis
(philosophe et psychanalyste, 1922 – 1997) une triple spécificité du psychisme
humain :
1) Premièrement une défonctionnalisation
de la représentation psychique vis-à-vis du substrat biologique. A regarder
l’action et la vie des animaux (répétitivité, caractère cyclique, absence
relative d’inventions), on peut sans risque de trop se tromper faire
l’hypothèse que la représentation psychique (images, perception,
anticipations) est quasi-immuable dans ses formes (le chat voit et désire les mêmes
objets, limités, ayant un sens fixe directement relié au besoin)
et sert globalement (fonction) la reproduction de la vie biologique
(celle de l’espèce à travers l’individu). Pas ou très peu – chez les grands
mammifères – de jeu de la représentation. A contrario, tout se passe
comme si chez l’homme les représentations psychiques étaient déconnectées
c'est-à-dire « libres » vis-à-vis du substrat biologique. La
possibilité de se suicider, le déploiement d’une sexualité non reproductrice,
le fait de pouvoir se raconter des histoires imaginaires… indiquent assez par
leur absence de fonction vitale une telle libération.
2) Corollaire, d’une telle
défonctionnalisation, l’autonomisation de l’imagination humaine :
il suffit de faire quelque peu attention à ce qui se passe en nous pour que
nous percevions un flux de représentations illimité et immaîtrisable – en ce
sens au moins qu’on ne peut l’arrêter : il y a en nous de la pensée
(au sens large cartésien incluant images, affects et désirs) et ce constamment.
Le rêve humain dans son infinie créativité marque encore à l’état de sommeil (de
la conscience) une telle effervescence de l’imagination humaine. A
contrario on peut poser que l’imagination rêveuse de l’animal est là encore
ancrée dans le besoin (le chat attaque, tue, mange… et ne rêverait que de cela)
et sans fioritures.
3) Ce qui caractérise
enfin l’homme c’est la domination du plaisir représentatif sur le plaisir
d’organe. Pas de sexualité humaine sans fantasme, par exemple. Lacan : « le
fantasme fait le plaisir propre au désir ». Les grandes quêtes humaines
que sont la gloire, la richesse et l’amour sont, elles encore, clairement
indissociables de la représentation que l’on se fait de l’autre et de soi-même
(et de l’image de soi telle qu’on l’imagine être pour l’autre). Enfin, dernier
exemple, l’homme seul peut prendre plaisir à torturer son prochain – ce qui
montre que je puis prendre plaisir à la représentation de la souffrance de
l’autre (comme à la représentation de la mienne propre :
masochisme), ce qui du point de vue immédiat du corps est inintelligible la
douleur étant l’opposé du plaisir.
c)
Qui dit irréductibilité du psychisme ne dit pas liberté à son égard
Si
l’irréductibilité du psychisme aux phénomènes simplement organiques nous amène
à conclure à l’avènement d’une nouvelle dimension de l’être (imagination
déconnectée tissée de et visant des significations imaginaires), si une telle
dimension peut être dite « libre » (Jonas) vis-à-vis de la
nature biologique dans la mesure où elle s’annonce comme une causalité
spécifique irréductible, nous ne sommes quant à nous pas libres
vis-à-vis de ses productions. Nous allons en effet reconnaître avec Freud
que l’on peut être esclave de sa propre psyché (et non plus seulement de
lois biologiques aveugles, cf.II.2), cette psyché étant intrinsèquement divisée.
Reconnaissons
pour cela d’abord au sein de notre psyché consciente une première
différence :
1)
Il
y a des pensées, des dires et des actes dont je m’éprouve l’auteur (le
sujet) – ici même - les engendrant volontairement et les contrôlant par la réflexion attentive
– il me semble alors que je pense, dis ou fais ce que je veux, pensées,
dires et actions me semblant sous l’entier pouvoir de ma volonté. Je me vis
alors comme le maître de moi-même, maîtrisant tant mes pensées que mon
corps.
2)
Pour autant dès que je relâche mon attention,
un flot incontrôlé de pensées, d’affects et d’images traverse ma psyché (cf. b.
2) ; à la limite d’un tel relâchement, le rêve manifeste une vie psychique
extraordinaire qui, elle aussi, échappe entièrement à mon contrôle. Il y a donc
une vie psychique qui échappe à mes pouvoirs propres et dont je ne suis
pas l’auteur conscient.
.
Rien de bien grave cependant pour ma propre liberté et l’intégrité de ma
personne, s’il suffit d’attention et de concentration pour se reprendre et
devenir à nouveau le maître de soi-même. Ce flux imaginaire ne serait alors
rien d’autre que de la « sous-pensée », un jeu hasardeux,
sans intérêt ni sens d’images - duquel je peux à tout moment me libérer par la reprise
consciente et volontaire de ma propre pensée. C’est bien ainsi que,
communément, nous pensons nos propres rêves ainsi que les associations d’idées
qui nous viennent à l’état de veille : l’essentiel (le véritable,
l’important) est ailleurs.
.
Et pourtant une telle séparation entre une conscience maîtresse d’elle-même
et un flux imaginaire sous-jacent à toute activité psychique et n’affectant
pas la première peut être sérieusement mise en question. En effet :
1)
Dire
que je suis l’auteur et le maître de mes imaginations conscientes, c’est
oublier que, pour une grande part d’entre elles, mes pensées surviennent
(Nietzsche) - et m’étonnent parfois. Ainsi, par exemple, de la venue de tel
« bon mot », mais encore des trouvailles du poète ou du musicien dont
l’imagination, même si elle est reprise, guidée et travaillée, déborde dans la création
toute mesure consciente : il y a plus dans tel vers (ex. « le
soleil s’est noyé dans son sang qui se fige » (Baudelaire)) que ce
qu’on (y compris Baudelaire) pouvait en prévoir – la nouveauté de la pensée
excède son créateur ; mais encore, un tel vers, bien que nous en soyons
conscient, nous échappe encore en partie, appelant un univers indéfini
d’images et de significations non encore présentes… : il y a donc au sein
de la pensée consciente de la pensée qui nous excède.
2)
Ma
conscience est le siège de passions qui s’imposent à moi, malgré moi –
ainsi de l’amour, de la haine, de la vengeance, de l’angoisse… des pensées et
des désirs dont je ne suis pas maître et qui m’assaillent. Au sein de la
conscience, malgré et contre ma volonté, des désirs et des pensées
s’imposent à la conscience éveillée.
3)
Une
telle submersion de la conscience par des forces vécues comme étrangères (« c’est
plus fort que moi ») est aussi caractéristique des névroses. Névroses
(angoisse, phobies, obsessions, asthénie…) = affection caractérisée par des
troubles affectifs et émotionnels dont le sujet est conscient et dont il ne
peut se débarrasser. Ainsi de cet homme qui en conduisant était assailli du
désir de se fondre dans les phares de la voiture devant lui, ou de cet autre
qui dans les mêmes conditions s’imaginait régulièrement écraser une vieille
dame à tel point que l’angoisse l’empêchait de conduire. Ainsi encore de
l’agoraphobe pris de crise d’angoisse, ou de l’individu pris de
« Toc » qui ne peut s’endormir qu’après avoir accompli un rituel
précis…
4)
Le
cas limite des psychoses (maladie mentale affectant de manière
essentielle le comportement, et dont le malade ne reconnaît généralement pas le
caractère morbide (à la différence des névroses)) telle la paranoïa entraînant
un délire de persécution ou/et de mégalomanie – indique comment la
pensée consciente peut être, dans ces cas limites, littéralement submergée par
des forces psychiques non contrôlée.
5)
Qui
de nous encore une fois maîtrise ses fantasmes (ici sens courant) ?
Pourquoi pour l’un les relations sadomasochistes, pour l’autre les relations
homosexuelles, zoophiles ou telles autres pratiques sexuelles…sont-elles des
sources d’excitation, quand pour l’autre elle entraînent des dégoûts
profonds ? Là encore la découverte (et non le choix) que l’on fait
de ces dégoûts et désirs au sein de nous-mêmes indique suffisamment que la
conscience est submergée par des désirs et imaginations particulières dont elle
n’est pas l’auteur.
6)
Enfin,
actes manqués et lapsus ne s’accomplissent ils pas parfois au cœur de la plus
extrême attention, me faisant dire le contraire de ce que je voulais dire ou
faire le contraire de ce que je voulais faire ? Ainsi de ce médecin dont
parle Freud et qui levant son verre pour congratuler un collègue nouvellement
nommé à une place éminente lui dit qu’il a « roté » pour lui
(au lieu de voter)
Dans tout ces cas, c’est une étrangeté de
soi à soi qui se manifeste à notre conscience, des actes, des mots, des
pensées, des désirs excèdent et dépassent la volonté du sujet conscient
et le poussent dans des directions étrangères, incongrues, parfois
contradictoires et souvent douloureuses. Tout se passe ainsi comme si derrière,
sous-jacente à, notre vie consciente bouillonnait une vie imaginaire
dont nous ne sommes pas les maîtres. C’est à la reconnaissance de la puissance
d’une telle vie imaginaire s’imposant à et à l’insu de la volonté
consciente que répond le concept freudien d’inconscient.
d)
L’hypothèse de l’inconscient psychique
i)
L’hypnose comme origine
Freud médite tout d’abord les effets de
l’hypnose. En situation hypnotique : a) Les patients semblent pouvoir dire
et se souvenir de ce qu’ils taisent à l’état conscient – comme si, la
conscience s’endormant, des barrières s’estompaient. b) On peut exiger d’autrui
(avec des réussites variables) un comportement qu’il effectuera une fois
éveillé et dont il donnera une raison étrangère à la véritable raison – qui est
l’ordre donné sous état hypnotique. Ex. ouvrir son parapluie à telle heure,
l’individu interrogé expliquera pourquoi il l’a fait – et, par exemple, la
crainte de la pluie, pour vérifier s’il n’y a pas de trous, etc. L’important
ici est que l’individu conscient i) ne connaît pas les véritables causes de son
geste (le commandement) ; ii) donne des raisons qu’il croit justes
pour rendre compte de son geste. Il s’agit alors d’une rationalisation :
la conscience est trompée et se donne à elle-même de fausses raisons.
ii)
Elargissement du schéma de l’hypnose
Freud
élargit alors ce schéma de l’hypnose : si la conscience peut être trompée à
son insu, les raisons que nous donnons de nos actes, de nos désirs, de nos
pensées, de nos rêves, de nos actes manqués, de nos lapsus… ne sont-elles pas autant
de rationalisations c’est à dire de masques de phénomènes se déroulant hors du
champs de notre conscience ? Si de tels phénomènes ne sont pas de
nature organique, mais de nature psychique – c'est-à-dire évoluant dans la
dimension imaginaire du sens – une telle détermination de la conscience
est la marque de l’existence d’un inconscient psychique, soit d’un
ensemble de forces psychiques déterminant la conscience à son insu. Qu’est-ce
donc qu’un tel inconscient et comment reconnaître sa
présence problématique ?
iii) La décision théorique de Freud
A
tenter de saisir les contenus conscients, nous nous apercevons que « les
données de la conscience sont extrêmement lacunaires ; aussi bien chez l'homme
sain que chez le malade, il se produit fréquemment des actes psychiques qui,
pour être expliqués, présupposent d'autres actes qui, eux, ne bénéficient pas
du témoignage la conscience. Ces actes ne sont pas seulement les actes
manqués et les rêves, chez l'homme sain, et tout ce qu'on appelle symptômes
psychiques et phénomènes compulsionnels chez le malade ; notre expérience
quotidienne la plus personnelle nous met en présence d'idées qui nous
viennent sans que nous en connaissions l'origine, et de résultats de pensée
dont l'élaboration nous est demeurée cachée » (Freud). Alors que
les actes manqués, les rêves, les idées surgissantes, les symptômes somatiques…
qui surviennent au sein de notre vie consciente, sont souvent considérés soit
comme le produit de hasards, soit comme celui de causes organiques inconnues,
Freud prend la décision théorique de faire l’hypothèse qu’ils sont signifiants
= qu’ils veulent dire quelque chose et quelque chose d’important.
Or comme nous n’avons nulle conscience de ce qu’ils veulent dire, un tel sens
(psychique), s’il existe, ne peut être qu’inconscient.
iv)
Justification d’une telle hypothèse
« Tous
ces actes conscients [cf. + haut, rêves, lapsus, etc. ] demeurent
incohérents et incompréhensibles si nous nous obstinons à prétendre qu'il faut
bien percevoir par la conscience tout ce qui se passe en nous en fait d'actes
psychiques ; mais ils s'ordonnent dans un ensemble dont on peut montrer la
cohérence, si nous interpolons les actes inconscients inférés. Or, nous trouvons
dans ce gain de sens et de cohérence une raison pleinement justifiée,
d'aller au-delà de l'expérience immédiate. Et s'il s'avère de plus que nous
pouvons fonder sur l'hypothèse de l'inconscient une pratique couronnée de
succès, par laquelle nous influençons, conformément à un but donné, le
cours des processus conscients, nous aurons acquis, avec ce succès, une preuve
incontestable de l'existence de ce dont nous avons fait l'hypothèse. » (Freud).
Deux raisons donc : a) le gain (théorique) de sens – l’hypothèse de
l’inconscient est supposée éclairer ce qui sans une telle hypothèse reste
inexpliqué et obscur. Une telle hypothèse nous donnerait alors une
compréhension plus large de nous-mêmes. C’est ce qu’il nous faudra
éprouver ; b) argument pratique : l’efficacité supposée de la
démarche psychanalytique.
.
Ne pouvant juger directement de l’efficacité pratique, bornons-nous à analyser
l’hypothèse de l’inconscient et le gain de sens supposé l’accompagner.
v)
Structure du psychisme
En
1915, Dans sa première topique (théorie des « lieux » (topos)
- psychiques – à prendre comme une métaphore puisque le psychisme, avons-nous
vu ne saurait être étendu), Freud distingue trois structures du psychisme
humain : le conscient, le préconscient et l’inconscient. Le conscient est
ce dont seul nous faisons l’expérience, soit tout ce qui apparaît plus ou
moins clairement dans le champ de la conscience éveillée (telle pensée et
ensembles de pensées, tel souvenir, affect, cette salle avec au-delà le savoir
que continue l’espace, etc. etc.). Le préconscient est constitué de contenus
psychiques dont nous n’avons pas actuellement conscience mais dont nous pouvons
à volonté reprendre conscience - il s’agit essentiellement de souvenirs (ex.
possibilité de se rendre conscient d’un souvenir d’enfance, de ce qu’on a fait
hier, etc. ). L’inconscient, quant à lui, ne saurait devenir conscient. Il est
le siège d’une vie imaginaire désirante qui ne se manifeste à notre
conscience que de façon déguisée – soit sous la forme de symptômes somatiques
(douleurs), de l’étrangeté du rêve, de lapsus, d’idées étonnantes, etc. Pour
caractériser l’importance relative du conscient et de l’inconscient dans notre
vie psychique, Freud nous donne l’image d’un iceberg dont seule la face émergée
(le conscient – soit 10 % du « volume » total) nous apparaît, le
reste étant le champ immense de l’inconscient, ce champ dont ne percevons que
les traces et les effets.
Pourquoi
donc un tel déguisement ? A cela deux raisons : a) le refoulement ;
b) l’irréductibilité d’une partie du psychisme à la logique consciente.
a) Une partie des contenus inconscients a été
(et est constamment) refoulé du champ de la conscience vers le champ
inconscient. Refoulé c'est-à-dire expulsé et oublié. Pour quelle
raison ? Parce que le contenu en est insupportable pour notre conscience, contredisant
d’autres valeurs et d’autres désirs auxquels nous tenons. Ainsi, par exemple,
des idées d’inceste et du désir de meurtre du père dont Freud nous dit qu’elle
sont consubstantielles à l’homme (du fait que nous avons tous été enfants
avant que d’être hommes); mais encore de multiples désirs interdits dont
la manifestation nous ferait éprouver horreur et culpabilité. Désirant se
manifester, poussant vers la représentation consciente le désir importun se
voit fermer les portes : Freud appelle censure une telle expulsion.
Mais, dit encore Freud, « l’inconscient n’oublie jamais », et
les désirs refoulés refont surface sous une forme déguisée. Celle-ci est
un compromis : en se déguisant le désir inconscient se manifeste et
se satisfait partiellement ; les forces de censure, quant à elles, acceptent
qu’un tel contenu, en lui-même non choquant, accède à la conscience. Ainsi, par
exemple de tel lapsus – « j’ai roté pour vous » - que le sujet
conscient pourra ramener au hasard (rationalisation) alors même que le désir
d’anéantissement de celui qui humilie « sa majesté le moi »
(Freud) en prenant sa place (toujours la première) se réalise partiellement par
ce bon mot qui signifie « je vous rote dessus ». Ainsi,
encore, par exemple de tel rêve dont le contenu conscient ne semble avoir ni
intérêt, ni queue ni tête, alors qu’à travers lui se manifestent des désirs
refoulés (cf. + bas pour un exemple) : basiquement, on rêve de telle femme
qui n’est pas votre mère – c’est donc votre mère. Pour comprendre les origines
du refoulement, il faudra nécessairement passer par le biais d’une analyse
de l’origine de notre psyché depuis sa genèse jusqu’à l’âge adulte – on
comprendra alors comment le fait de grandir en s’insérant dans une réalité
sociale donnée exige de renoncer à ce à quoi une partie de nous-même se
refusera toujours (cf. + bas).
b)
Mais l’inconscient n’est pas seulement et uniquement un ensemble de désirs et
de représentations qui ont été conscients et qui ont été refoulés de ce
champ. Antérieurement à l’accession au langage (réalité sociale par essence)
auquel nous devons la possibilité de nous dire et de nous penser, la psyché
était quelque chose – ensemble partiellement structuré de désirs, d’images,
d’affects - qui ne pouvaient pas se dire et qui ne peut pas
exhaustivement se dire dans un langage qui n’est pas le sien – celui de la
logique consciente, celui du langage ordinaire. Postulat freudien : une
telle (autre) logique continue son œuvre en une strate de notre être
psychique (« L’inconscient ne renonce jamais » - ici, aucune
phase de notre vie psychique n’est simplement annulée) et se manifeste sous
forme de tensions, d’affects, d’images… L’incapacité de dire exhaustivement
nos angoisses, nos désirs, nos haines… ne provient-elle pas partiellement de
cela – la présence d’un indicible psychique ? (cf. + bas –
d.ii, la généalogie de la psyché).
vi)
Reconnaissance de l’inconscient – rêves, actes manqués, névroses, désirs
ordinaires…
De
telles propositions manquent cependant ici singulièrement de justification.
Seule l’analyse d’expériences réelles nous permettra de tester le « gain
de sens » qu’est sensée nous apporter l’hypothèse de l’inconscient.
Commençons par l’analyse des rêves dont Freud nous dit qu’elle est « la
voie royale d’accès à l’inconscient ». Dans les rêves, en
effet, la force de censure contemporaine de la conscience, s’endort
partiellement. Selon Freud, les désirs inconscients deviennent alors, via
interprétation, partiellement lisibles car « le rêve est la
réalisation d’un désir » et non un amas d’images sans sens ainsi que
le perçoit et conçoit la conscience vigile.
a)
Analyse d’un rêve
Situation :
une femme de trente ans, mariée depuis 10 ans, qui se dit «heureuse en ménage»,
raconte son rêve au psychanalyste, Freud.
« Donc, une dame
encore jeune, mariée depuis plusieurs années, fait le rêve suivant: elle se
trouve avec son mari au théâtre, une partie du parterre est complètement vide.
Son mari lui raconte qu'Élise L. et son fiancé auraient également voulu venir
au théâtre, mais ils n'ont pu trouver
que de mauvaises places (3 places pour 1 florin 50 kreuzer) qu'ils ne
pouvaient pas accepter. Elle pense d'ailleurs que ce ne fut pas un grand
malheur.
La première chose dont la rêveuse nous fait
part à propos de son rêve montre que le prétexte de ce rêve se trouve déjà dans
le contenu manifeste. Son mari lui a bel et bien raconté qu'Élise L. une amie
ayant le même âge qu'elle, venait de se fiancer. Le rêve constitue donc une
réaction à cette nouvelle. Nous savons déjà qu'il est facile dans beaucoup de
cas de trouver le prétexte du rêve dans les événements de la journée qui le
précède et que les rêveurs indiquent sans difficulté cette filiation. Des renseignements
du même genre nous sont fournis par la rêveuse pour d'autres éléments du rêve
manifeste. D'où vient le détail concernant l'absence de spectateurs dans une
partie du parterre ? Ce détail est une allusion à un événement réel de la
semaine précédente. S'étant proposée d'assister à une certaine représentation,
elle avait acheté les billets à l'avance, tellement à l'avance qu'elle avait
été obligée de payer la location Lorsqu'elle arriva avec son mari au théâtre,
elle s'aperçut qu'elle s'était hâtée à tort, car une partie du parterre était à
peu près vide. Elle n'aurait rien perdu si elle avait acheté ses billets le
jour même de la représentation. Son mari ne manqua d'ailleurs pas de la
plaisanter au sujet de cette hâte. —Et d'où vient le détail concernant la somme
de 1 fl. 50 ? Il a son origine dans un ensemble tout différent, n'ayant rien de
commun avec le précédent, tout en constituant lui aussi, une allusion à une
nouvelle qui date du jour avant précédé le rêve. Sa belle-sœur ayant reçu en
cadeau de son mari la somme de 150 florins, n'a eu (quelle bêtise) rien de
plus pressé que de courir chez le bijoutier et d'échanger son argent contre un
bijou. — Et quelle est l'origine du détail relatif au chiffre 3 (3
places) ? Là‑dessus notre rêveuse ne sait rien nous dire, à moins
que pour l'expliquer, on utilise le renseigneraient que la fiancée, Elise L...,
est de 3 mois plus jeune qu'elle, qui
est mariée depuis dix ans déjà. Et comment expliquer l'absurdité qui consiste à
prendre 3 billets pour deux personnes ? La rêveuse ne nous le dit pas et refuse
d'ailleurs tout nouvel effort de mémoire, tout nouveau renseignement » (Conférences sur la psychanalyse).
|
Sens manifeste |
Association
libre |
Sens latent |
|
Au théâtre avec son mari |
Référence à un évènement antérieur. |
Théâtre : mariage et sexualité :
voir le caché. |
|
Une partie du parterre est complètement vide |
La semaine dernière a acheté des billets à
l’avance – paye la location – lorsqu’elle arrive avec son mari : plein
de place. N’aurait rien perdu si elle avait attendu. |
Mariage Temps (trop vite) Argent (trop cher) |
|
Son mari lui raconte qu’Elise et son fiancé
auraient voulu venir mais ils n’ont trouvé que de mauvaise places – refus. |
Son mari vient de lui raconter qu’Elise L.,
une amie à elle du même âge vient se fiancer. |
Mariage |
|
3 places pour 1 fl 50 |
Sa belle sœur ayant reçu un cadeau de son
mari de 150 florins n’a eu (quelle bêtise) rien de plus pressé que de courir
s’acheter un bijou. |
Temps (trop vite) Argent (trop cher). Rapport : 100 x mieux. |
|
|
|
Vengeance / Elise L. ------------------------ Déplacement : le sens latent fait place au sens manifeste
– rêve apparemment sans intérêt, le centre du rêve n’est pas dans le rêve
manifeste. Substitution : bijou = mari ; théâtre =
sexualité ; billet = mariage… Sens du rêve : réaction / mariage d’une amie :
je me suis empressée de me marier avec mon mari – cf. attrait / sexualité –
mais pour le même prix j’aurais eu un mari 100 x mieux. |
A
noter :
1) Le sens manifeste – ce dont se souvient notre conscience (ce qui lui est manifestée)
– se réduit à une histoire sans grand intérêt. C’est bien ainsi que nous vivons
la plupart de nos rêves. Mais le centre du rêve n’est pas là où la
conscience le croît – dans l’histoire manifeste – il est dans ce qui
s’exprime à travers ce rêve, à savoir un désir dont l’analyse met en
lumière le sens latent (caché) = les désirs de vengeance vis-à-vis
d’Elise ; de meurtre vis-à-vis de son mari ; de substitution d’un
autre (le fiancé d’Elise ?) à celui-là. Il s’agit ici d’un phénomène de déplacement
(une des trois lois structurelles de la logique inconsciente – avec la
substitution et la condensation, cf. + loin) : le contenu véritable
(latent) du rêve est inapparent dans le contenu manifeste ; celui-ci sous
la force de censure de la conscience, est déplacé vers le rêve
manifeste ; le contenu du rêve manifeste est alors sans danger pour
la conscience, ne remettant pas en cause ses propres valeurs (j’aime mon mari,
la jalousie c’est mal et idiot, etc. ) ; 2) Le moyen de retrouver le sens
latent est l’association libre : on demande au patient de dire,
sans contrôle ni censure du type « mais ça ce n’est pas important »
ce qui lui passe par la tête à propos de chaque élément du rêve, supposant que loin
d’être libre l’association des idées retrouvera les traces mnésiques ou
/ et les liens imaginaires forts particuliers qui se lient à tel élément du
rêve. De tels traces et liens seront à nouveau à interpréter en tant que
figurant des idées auxquelles un désir est fortement
attaché : ici à travers les idées de « mariage / trop vite / trop
cher payé » = désir d’éliminer ce mari pour un autre et,
éventuellement, de piquer le fiancé de son ami (à voir…). 3) Notons que si
l’interprétation part de l’hypothèse que le rêve a un sens, ce sens n’est
nullement lisible à travers le seul rêve manifeste – de là l’impossibilité
d’une interprétation qui ferait fi des associations propres d’idées du
rêveur (pas de manuel valable référant abstraitement tel contenu à telle
idée) ; qu’un tel sens est supposé, que l’interprétation doit donc être ouverte ;
que tout n’est pas interprétable (cf. + haut, le nombre « 3 »)
– Freud parle ainsi d’un noyau du rêve
qui demeurerait insaisissable à travers les jets de lumière que l’on peut
projeter sur certaines de ses parties (caractère intrinsèquement
indicible ? a –logique ? créativité de l’imagination ?). 4) A
rebours, une fois l’interprétation effectuée on peut retracer la causalité
supposée qui engendre le rêve. Au départ il y aurait un désir. Celui-ci ne peut
se manifester directement sans être refoulé de la conscience. Il se manifeste
donc indirectement et se satisfait par représentation en
utilisant les voies du déplacement, de la substitution (le billet
pour le mariage, le bijou pour le mari) et de la condensation (unir en
un seul être des propriétés diverses – ex. le bijou réunit les notions de
valeur, d’absurdité et de vanité (apparences) et représente un homme désiré).
Ceci constitue ce que Freud appelle la « logique primaire » de
l’inconscient.
Si
la théorie freudienne est correcte ce dont il faut ici s’étonner c’est :
a) que la conscience soit aveugle à la logique d’un désir qui sous-tend
pourtant une partie de sa vie psychique et dont l’inventivité et l’intelligence
calculante sont extraordinaires ; b) qu’elle puisse cependant reconnaître
que tel est bien son désir – reconnaître comme sien ce qui lui apparaissait
comme étranger – et reconnaître par-là même qu’elle peut être divisée,
siège de désirs contradictoires (elle peut aimer et haïr ce qu’elle
aime) reliée à différentes strates de son être, vis-à-vis desquelles il
lui appartiendra de faire la lumière et de tisser sa vie (en choisissant, par
exemple, lucidement de voir un désir et de le refuser – ou bien de
l’accomplir). Important : quel est notre être véritable ? Non nécessairement
celui qui parle par en dessous : ce peut être (et c’est souvent) un
meurtrier, incestueux, etc. (cf. illustration de Voutch) ; celui qui s’y
oppose est tout autant réel. Il ne s’agit pas ici seulement de reconnaître mais
sur cette base de se faire et de se transformer. Etre soi-même = un
projet qui suppose de transformer le rapport de soi à soi, et ainsi de tenter
de s’unifier alors que nous ne sommes premièrement rien d’autre qu’une superposition
de couches psychiques dont nous n’avons guère conscience (sur ces couches,
cf. généalogie de la psyché, d.ii).
b)
Les actes manqués et les lapsus
Cf.
l’exemple plus haut (« roter » - voter) = dire, faire ce qu’on
(une partie de nous) voudrait taire. Ex. 2 – casser le vase de la grand-mère… Pour
une partie de nous-mêmes, peut-être, le vase est-il un substitut de la
grand-mère et c’est elle qu’on tue – n’en déplaise à cette autre partie de nous
qu’est notre conscience morale ou une tendresse éprouvée qu’une telle idée
horrifie. Là encore : le vase est une sorte de compromis – c’est la
grand-mère (substitut inconscient); ce n’est pas la grand-mère et c’est « pas
de chance » (acceptable pour la conscience). Idem / les oublis de la
vie quotidienne…
c)
Les troubles névrotiques
Très
rapidement il apparaît que telle douleur, telle obsession récurrente, tels tocs
(nécessité de se laver les mains, d’effectuer tel rituel avant de se coucher,
etc. )… peuvent être le résultat d’un conflit psychique. Ainsi de cette femme
se plaignant de maux de ventre et dont l’origine est à trouver dans un souhait
antérieur, oublié et refoulé, de mort d’une sœur perdue, souhait dont elle se
punit en se faisant souffrir…
d)
Les amours, haines et désirs ordinaires
Rêves,
actes manqués, lapsus, troubles névrotiques… ne sont finalement pas au cœur de
notre vie consciente – ils indiquent tout au plus que certains de nos actes
psychiques sont déterminés par une logique inconsciente, non la force
sous-jacente de l’inconscient au cœur de toute activité psychique. C’est à
une telle reconnaissance que l’analyse de nos amours, désirs et haines
ordinaires doit cependant nous amener. Nul, en effet, ne choisit ses objets
d’amours et de haine. Ceux-ci – et, antérieurement aux objets, le mouvement
même d’amour et de haine – s’imposent à nous ; et nous ne faisons, pour la
plupart, dans nos vies, que suivre ces mouvements (cf. + haut – Schopenhauer et
l’inconscient biologique). C’est dans cette absence de choix et dans cet
emportement de notre vie consciente que l’on peut reconnaître la force d’un
inconscient qui obéit à une logique psychique propre que l’on peut mettre en
lumière. Une telle aliénation se manifeste couramment à la conscience dans la
mesure seule où elle engendre un conflit psychique – révélant une ambivalence (double
valeur contradictoire). Dans le cas contraire, tout semble indiquer que – faute
de les réfléchir et de les maîtriser - nous sommes et nous ne sommes que les
servants de ces parties de notre être qui s’affirment par et malgré nous.
i)
Haine et désir de meurtre
Pourquoi
cet enfant, doux comme un agneau le jour, décanille t’il hommes, femmes et
enfants dans des explosions de sang sur sa Playstation (ou encore, joue
aux soldats, bat ses poupées…) ? « Il joue » dit-on – et ce n’est pas
important ; « il se défoule » – entend t’on encore ;
« c’est de son âge »… etc. Autant de rationalisations (cf. +
haut pour une définition) qui masquent et relativisent (un jeu ce n’est
pas important !) ce qui se joue ici. Quelle est donc cette jouissance
propre à l’homme qui se satisfait de l’anéantissement des autres ?
Pour l’inconscient, dirait Freud, ce n’est nullement un jeu – c’est le réel
psychique ordinaire d’un être qui se vit et se pose comme le centre tout
puissant de ce monde accomplissant aveuglement des pulsions mues par le seul principe de plaisir et
anéantissant toute réalité qui s’opposerait à leur réalisation.
Je
crois que je n’ai vraiment été moi-même que 3 petites minutes dans toute ma
vie. Bilan : 5 morts et 14 blessés dont 2 graves

« Nous
trouvons toute naturelle la mort d’étrangers et d’ennemis que nous infligeons
plus volontiers et avec aussi peu de scrupules que l’homme primitif. Sur ce
point cependant, il y a, entre l’homme primitif et nous, une différence qui,
dans la réalité apparaît décisive. Notre inconscient se contente de penser à la
mort et de la souhaiter, sans la réaliser. Mais on aurait tort de sous-estimer
cette réalité psychique par rapport à la réalité de fait. Cette réalité est
déjà assez grave et grosse de conséquences. Dans nos désirs inconscients, nous
supprimons journellement, et à toute heure du jour, tous ceux qui se trouvent
sur notre chemin, qui nous ont offensés ou lésés. « Que le diable
l’emporte ! » disons nous couramment sur un ton de plaisanterie,
destiné à dissimuler notre mauvaise humeur. Mais ce que nous voulons dire
réellement, sans l’oser c’est : « que la mort l’emporte », et ce
souhait de mort, notre inconscient le prend plus au sérieux que nous ne le
pensons nous-mêmes et lui donne un accent que notre conscience est prête à
désavouer. Notre inconscient tue même pour des détails ; comme l’ancienne
législation athénienne de Dracon, il ne connaît pas d’autre châtiment pour les
crimes que la mort, en quoi il est assez logique, puisque tout tort infligé à
notre moi tout puissant et autocratique est, au fond, un crime de lèse majesté.
C’est
ainsi qu’à en juger par nos désirs et souhaits inconscients, nous ne sommes
tous qu’une bande d’assassins. »
Freud,
Considérations actuelles sur la guerre et la mort, 1915
Analyse
du texte
.
Le contexte tout d’abord : 1915, première guerre mondiale et fin des
espoirs humanistes cosmopolitiques. A gauche l’idée de l’internationale
communiste – « travailleurs de tous pays, unissez-vous » -
Jaurès qui jusqu’à son assassinat luttait contre la guerre en espérant la
paix ; l’espoir que les soldats jetteraient leurs armes, et se
reconnaissant comme frères d’oppression (par un capitalisme devenant mondial)
s’uniraient. A droite, l’idée d’un éveil des consciences liée à une commercialisation
adoucissante du monde, laissait espérer devant l’image d’un grand
marché mondial que la guerre était d’un autre temps. Des deux côtés les
guerres apparaissaient comme un archaïsme voué à être dépassé dans la
conscience d’une humanité et d’un intérêt commun. C’est cette idée-là qui en
1914 explose : les nationalismes se réveillent, les soldats vont à la
guerre en chantant (en un premier temps), haïssent, comme il se doit, leurs
ennemis, une formidable boucherie commence son travail… Problème énorme :
comment est-ce possible ? Comment les hommes peuvent-ils ainsi
s’identifier à une patrie ? Comment – parallèlement - la haine de l’autre
est-elle possible ? Comment de gentils garçons peuvent-ils devenir des
bouchers ? C’est, répond Freud qu’il y a toujours eu un boucher à la cave
de la maison cherchant à s’affirmer au détriment de tous les autres.
. Les horreurs de la guerre ne feraient donc
que révéler le monstre sanguinaire qui gît au fond de nous. Quelle preuves
avons-nous donc de sa présence ? C’est toujours sous forme masquée,
acceptable pour la conscience que se révèlent ces forces inconscientes.
Il faut donc les débusquer derrière les compromis rationalisants dont se
satisfait la conscience. On repérera alors les lieux et moments d’agressivité
et de violence latente : bousculades, priorité grillée ou
doublage intempestif en automobile, regard ou parole mal interprétée, guichet
fermé, train en retard, lenteur du passant devant moi, réception d’une mauvaise
note, indifférence de l’autre pour moi, profs qui doublent à la cantine,
camarade qui a une bonne note, sort avec une jolie fille ou un joli garçon… On
saisit alors des mouvements d’humeur qui s’expriment dans des regards
(fusillant), des gestes (des crispations de dents aux coups de poing en passant
par les autres doigts d’honneur) ou des phrases (de l’ironie mordante –
« je vous en prie madame » - « sa seigneurie », à
l’insulte…). Notons encore que de tels mouvements s’accompagnent de raisons –
qu’on reconnaîtra dans un instant comme rationalisation - c’est
toujours l’autre qui a tort et on se justifiera (priorité grillée, agression
volontaire de la part de l’autre… = droit bafoué).
.
Freud explicite immédiatement la logique de notre inconscient : pour
l’inconscient, ils sont déjà morts. « Dans nos désirs
inconscients, nous supprimons journellement, et à toute heure du jour, tous
ceux qui se trouvent sur notre chemin, qui nous ont offensés ou lésés ».Tout
ce qui s’oppose à « sa majesté le moi » c'est-à-dire à la
toute puissance et à l’illimitation de mes désirs – marcher droit dans la rue, être reconnu et
aimé, être le premier… - est immédiatement pour notre inconscient annihilé.
Cet ami qui réussit – et pas moi : anéanti. Ce détenteur de BMW – et pas
moi : exterminé. Celui qui me bouscule – éliminé… Qui n’est ainsi sensible
à ces minuscules fantasmes de mort qui naissent en quelques
microsecondes de telles situations ? Si alors on lâchait la bride à
l’inconscient – c'est-à-dire si nous ne nous contrôlions pas – c’est la
violence la plus meurtrière qui se répandrait. C’est pourquoi les situations
limites sont propres à révéler (plutôt qu’à produire) un tel fond
inconscient : les guerres où la morale sociale ne défend plus de tuer
autrui mais exige de tuer celui qui est devenu un « ennemi »
vis-à-vis duquel, pour la plus grande joie de cette partie obscure de
nous-mêmes, il n’y a plus d’interdits. Notons ici encore que la conscience se
satisfait par autant de rationalisation : l’autre est l’ennemi de
la patrie, etc. – il faut ainsi que le
meurtre soit justifié, rationalisé pour notre conscience. Dans les rêves a
contrario, les forces de censure de la conscience étant davantage endormies,
nul besoin de tant de rationalisation : réalité fantasmatique où
l’ego, centre tout-puissant ignorant la réalité (du monde, des autres,) réalise
immédiatement sans (trop d’) entraves ses désirs…. le rêve suppose sa dose de
meurtres, de soumission et d’incorporation sexuelle - l’inconscient s’y laisse
ainsi davantage lire (quoique de façon encore chiffrée, cf. + haut, analyse
d’un rêve). Le jeu quant à lui est un moyen symbolique de réalisation
des désirs. L’enfant
qui lance et tire une bobine de fil en disant successivement «fort – da»
(ici – là) joue et maîtrise ainsi imaginairement le départ et le retour de sa
mère, mouvements vis-à-vis desquels il n’a nul pouvoir réel. L’enfant qui joue
« se crée un monde à lui, ou plus exactement, il transpose les choses
du monde où il vit dans un ordre nouveau tout à sa convenance » (Freud,
Au-delà du principe de plaisir). Aussi les jeux de guerre, vidéos, les
films où nous sommes les héros… sont-ils autant de moyens pour nos désirs
inconscients de se réaliser. Au total, « c’est ainsi qu’à en juger par nos désirs
et souhaits inconscients, nous ne sommes tous qu’une bande d’assassins »
(Freud).
.
Freud renverse ainsi la thèse classique selon laquelle l’homme civilisé aurait
depuis longtemps dépassé et anéantit le primitif – à comprendre comme une étape
posée comme encore quasi-bestiale de l’évolution de l’humanité ; puis
comme les étapes individuelles du devenir grand où, l’on devient un autre être, un grand, un être moral. L’homme
archaïque – le primitif – centre tout-puissant du monde réduisant toute chose à
ses désirs - est à l’intérieur, toujours là, près à faire sonner sa voix, à
frapper de son poing – parfois sous les plus beaux vêtements moraux (l’amour de
la patrie, le bien commun), parfois sous ceux du droit (ma place, ma priorité).
Certes alors nous ne sommes plus des enfants, ni des primitifs en ce que chez
l’homme éveillé cette puissance inconsciente doit coexister avec cette autre
part de nous-même qui exige des raisons et des justifications morales, en ce
que nous avons appris en partie à nous maîtriser. Mais la manière dont
la conscience se laisse prendre à ses propres rationalisations montre
combien nous pouvons être les jouets de ces forces obscures qui poussent
à l’intérieur de nous vers leur réalisation.
ii)
Nos amours.
Les divers amours conçus comme autant de
formes d’attachement particuliers à un être, une situation, un objet, un
pays, un dieu… s’imposent à nous - nous ne les choisissons pas - et déterminent la visée essentielle de notre
vie consciente. N’est-il pas ici aussi possible que derrière la logique
consciente et la justification que nous donnons à nos amours, d’autres
visées, elles aussi plus obscures, se réalisent ?
C’est
ce que soupçonne ainsi Nietzsche après Pascal derrière l’amour de la patrie, de
sa ville comme de ses enfants… :
« Le
désir d’appropriation du sentiment de moi est sans limites ; les grands
hommes parlent comme si tous les âges se tenaient derrière eux et s’ils étaient
la tête de ce long corps, et ces chères femmes se font un mérite de la beauté
de leurs enfants, de leurs vêtements, de leur chien, de leur médecin, de leur
ville, à ceci près qu’elles n’osent pas dire : « tout cela, c’est
moi » » (Nietzsche, Aurore, IV, § 285).
.
Alors que les grands hommes pensent se dévouer pour leur patrie, tiennent pour
les autres et pour eux-mêmes un discours pur et désintéressé sur le bien
général ; que les femmes vantent les mérites de ces autres que sont leurs
enfants, leur chien, leur médecin, leur ville (qui est toujours, où qu’on se
trouve sur Terre, la plus belle ville du monde) ; que, pourrait-on avec
Nietzsche ajouter, le croyant plie le genou devant un dieu qu’il aime… alors
que tous pensent et disent aimer un autre que soi, Nietzsche soupçonne
que ce qu’on aime, désire et admire à travers ces autres n’est autre que
soi-même. L’amour désintéressé de l’autre ne serait ainsi qu’une
manière inconsciente de jouir - par procuration - de la
représentation d’un soi tout-puissant et centre de ce monde.
. Comment une telle logique est-elle
possible ? L’autre n’est pas moi et je ne suis pas l’autre. Comment ce qui
n’est pas moi – ce dieu, cet enfant, cette ville – peut-il bien être analysé
par Nietzsche comme une excroissance du moi ? Il y a certes
paradoxe. Et pourtant à voir comment d’aucuns se gonflent de raconter les
histoires des autres, de vanter leur médecin, leur ville, leur nation…
tout se passe, en effet, comme si c’était bien eux-mêmes qui à
travers ces autres étaient glorifiés. Ce qu’il s’agit ainsi de penser c’est
le processus d’identification : l’autre devient ce à travers
quoi je me lis, désire et pense ; comme si le moi, de son centre,
développait des tentacules sur le monde s’appropriant l’autre que soi et y
posant sa marque : « c’est moi, c’est à moi ».
. Pour comprendre une telle logique, il faut
revenir à l’histoire de la psyché humaine (généalogie de la psyché).
Généalogie
de la psyché humaine
.
Posons avec Freud qu’à sa naissance la psyché de l’infans (celui qui ne parle
pas) est une boule autocentrique, « autistique » qui réduit le
monde à soi-même ne connaissant de ce dernier que l’épreuve immédiate qu’il en fait, à savoir le plaisir
ou la douleur. Autrement dit, pas encore de représentation
(conscience au sens étroit) d’un monde extérieur à soi et différent de soi,
mais un monde réduit à l’expression (positive ou négative) de ses désirs.
Concrètement, le lait pour le bébé ce n’est pas ce que nous, adultes, en
pensons dans le langage vigile à savoir le lait qu’une mère, la mienne, me
donne en réponse à mes cris ; les autres n’existent pas encore en tant que
tels pour lui. Ainsi le lait comme les caresses de la mère font-il corps
avec lui et sont vécus comme une partie de soi qui engendre plaisir.
Freud peut ainsi écrire à la place de l’infans : « je suis le
sein » - autrement dit, cette réalité sentie et ressentie qui engendre
le plaisir c’est moi-même, clos sur moi-même et réunifié (et non encore,
ce qui appartient à un autre et qu’il me donne selon son bon vouloir). Lorsque
le sein, en effet, ne vient pas ce n’est pas pour le bébé un évènement mineur
qu’il pourrait mettre à distance et relativiser. C’est son monde qui se
brise – l’horreur du cri du bébé, inédit dans le monde animal, semblant
montrer combien ce manque est vécu dans l’aveuglement comme une désunion,
une brisure, une perte de soi. Au contraire le lait réunit enfin
l’enfant désuni et assouvissant momentanément le désir, réengendre la clôture
de soi sur soi qui semble le but premier du désir : ne pas manquer,
être réuni à moi-même dans la plénitude de la satisfaction.
.
L’on saisit alors comment l’autre que soi (le sein, la mère, le lait) est dés
l’abord appréhendé comme une partie de soi. Les autres n’existent tout
simplement pas. Mais c’est à travers le manque que, pour donner sens
à son monde, la figure d’un autre que soi va pouvoir se constituer.
.
Grandir c’est ainsi reconnaître que le réel ne répond pas à mes désirs,
autrement dit qu’il y a de l’autre que moi (une mère qui ne fait pas ce que je
désire, puis une mère qui désire un autre que moi, à savoir le père, etc.,
enfin des autres qui se fichent royalement de moi, etc.), un autre qui résiste
à mes désirs et autres tentatives d’assimilations réductrices = que je ne
suis pas le centre tout-puissant d’un monde qui se réduit à mes désirs. Or
une telle reconnaissance est toujours douloureuse et doit, pour être
effectuée, être compensée par quelque gain psychique : telle est la
fonction générale de ce qu’on peut appeler une domestication ou appropriation
de l’altérité du réel (le fait qu’il soit autre que moi), par quoi le réel ne
m’apparaît plus seulement dans une étrangeté radicale mais aussi comme un lieu-mien
où je me réfléchis, où je suis reconnu et où je puis vivre, recréant un cosmos
(monde ordonné et centré) c'est-à-dire un foyer pour mes désirs.
.
Telle est l’histoire psychique de ce qu’on peut appeler nos chutes
et nos recréations de monde. Reprenons donc (très grossièrement)
l’histoire de la psyché où nous l’avions laissé. 1) Dans une première phase
donc, le bébé se vit comme centre autistique tout-puissant d’un monde réduit à
son plaisir. 2) C’est le manque (ici comme besoin) qui vient tout d’abord
briser cette clôture satisfaite. Le bébé apprendra (s’il l’apprend et ne
s’enferme pas en un monde autistique – cf. l’anorexie du nourrisson) qu’il
n’est pas tout puissant mais qu’un autre être détient la
toute-puissance : la mère détentrice du sein dispensateur de
plaisir. Première chute donc : nous sommes deux ! et je ne suis
pas maître de la réalisation de mes désirs. En ce qu’elle s’oppose au désir que
je suis cette chute est nécessairement une souffrance – qui s’exprime en haine
de ce qui s’oppose à moi (cf.+ haut sur la haine, d.i). Mélanie Klein fait
ainsi l’hypothèse que l’enfant dissocie alors le monde entre un mauvais monde
qu’elle appelle « mauvais sein » (le sein qui ne vient pas,
qui n’obéit pas à mon désir) sur lequel afflueront les fantasmes de destruction
et un bon monde (« le bon sein » - celui qui dispense le
plaisir) que l’enfant pourra là encore fantasmer (cf. le bébé qui
s’endort le pouce dans la bouche). Très important : le monde reconnu en
son extériorité (relative) par rapport à moi devient dès sa
naissance psychique ambivalent (double valeur contradictoire) : à
la fois ce qui me fait chuter (et donc que je hais) mais aussi ce qui permet à
mon désir de se réaliser (et donc que j’aime). Où l’on reconnaîtra l’origine
très lointaine d’une vision manichéenne du monde scindé entre ces
deux principes différents que sont le bien et le mal, ainsi par exemple des
oppositions : ma patrie / l’étranger ; ma ville / les autres… qui fonctionnent
selon une séparation du monde en ami / ennemi = mien / autre. Ainsi de
la mère – qui est à la fois celle que j’aime par-dessus tout et celle que je
hais parce qu’elle ne répond pas à mes désirs (et plus profondément parce que
sa genèse psychique en tant qu’autre que moi coïncide avec la perte de la
toute-puissance de la psyché). A travers cette première scission (moi / autre =
mère) l’enfant peut, en effet, recréer un monde-mien : cet autre je
l’aime et je dois m’en faire aimer – toute puissance aimante et protectrice
avec laquelle je vise un état impossible de fusion (cf. le bébé « collé »
à sa mère, les jeux de séduction, etc.), la fusion (impossible) avec la
toute-puissance de l’autre étant maintenant vécue et visée comme
réalisation du désir (après ma première chute). A contrario – on comprendra
comment l’autre (ici la mère) peut en cette phase du développement psychique
être constitué comme une toute-puissance étrangère, crainte et haï. Une mère
non aimante, non caressante, par exemple, une nutrition « mécanique »
indifférente et sans échanges (voire pire haineuse et violente) – peut ainsi se
voir constituer dans le sentiment général de terreur devant celle que je
désire pourtant. On conçoit alors comment cette première constitution de
l’autre que soi peut engager des constitutions psychiques psychotiques
désormais incapables de relation « normales » à l’autre
c'est-à-dire ouvertes, de plaisir et d’échange (cf. le personnage principal
du film psychose d’Hitchcock) : le monde peut ainsi être constitué
par le paranoïaque comme radicalement étranger, terrifiant, soumis aux
volontés d’une force étrangère toute-puissance qui m’opprime et me surveille.
3) Le bébé peut trouver un nouvel équilibre psychique dans un tel monde relativement
maîtrisé, un monde à soi re-centré sur soi avec une mère à soi. Mais c’est
ce monde-là qui doit encore une fois être brisé. Car cette mère que le bébé
veut tout pour soi, dont il veut être l’objet d’amour, avec laquelle il désire
faire un – cette mère en désire un autre (papa). Troisième phase donc :
nous sommes trois ! Cet autre, le père, vient briser l’univers clos de la
relation duelle de l’enfant à la mère et vient par la réprobation, le « non »
(l’enfant dans la chambre) interdire la relation fusionnelle qui est, à
cette phase, l’essentiel du désir de l’enfant.
De là encore une fois la haine et le désir de
meurtre (s’exprimant dans les dires, les gestes, les fantasmes…), cette fois-ci
de cet autre étranger qu’est le père. Tel est le complexe d’Œdipe (Œdipe dans
la tragédie de Sophocle tue son père et épouse sa mère). Il sera résolu (dans
quelle mesure cf. + bas, note sur le renoncement) lorsque l’enfant acceptera
l’interdit – et donc un amour limité de la mère – ce qui se produira en
faisant du père une figure idéale, celle que je veux et dois être (« je
veux être comme mon père », « grand »…).

A l’expulsion du père comme autre mauvais
suit donc, si tout se passe bien, une identification-appropriation qui
est intégration de ce dernier comme « mon père » en tant que
je désire être sur son modèle : suit donc une nouvelle restructuration
du monde où le père apparaît comme la nouvelle figure désirée de la toute-puissante
(« mon père, ce héros »…) – le monde s’accroît
d’horizons temporels désirables (je ne suis pas tout – je le serai !).


4)
Mais ce n’est pas terminé – loin de là ! Le « cocon familial »
doit être brisé, la toute puissance de papa relativisée : l’enfant
s’était, en effet, recrée un monde, un monde à trois (j’oublie ici pour simplifier
les petits frères et sœurs – qui engendrent un identique mouvement
d’annihilation et/puis d’appropriation – on pourra parler d’un complexe de
Caïn), un chez soi où il continuait à avoir une position relativement
centrale. C’est ce que l’école – par exemple – va briser : il faudra
découvrir et reconnaître qu’il y a des autres que moi, d’autres familles que la
mienne et que je n’ai pas la priorité. Nouvelle souffrance, nouveau coup dur
pour celui qui veut être le centre et qui désire être tout. Là encore, une
double solution est possible (et souvent alternativement vécue) – soit
l’investissement et l’appropriation de ce nouvel espace, à travers la lutte
pour la reconnaissance, la camaraderie, etc. = l’appropriation -
création d’un nouveau monde doté de nouvelles valeurs, relations et de
nouveaux horizons ; soit son refus, l’enfermement dans la « timidité »,
l’investissement quasi-exclusif de la famille (« veux maman… !
»), la volonté de retour au monde sécurisé de l’avant… 5) Suivent alors
d’autres types de chocs et brisures suscitant un renoncement correspondant à la
brisure d’un monde et à la création-appropriation d’un nouveau (chez
nous, le collège, le lycée, les concours, le monde du travail, la maladie et
l’hôpital…). Sur ces derniers exemples, l’on voit combien il est difficile (et
peut-être ultimement impossible – c’est ce qu’affirme Freud) de faire
pleinement sienne la réalité extérieure (ici sociale).
Petite
note sur le renoncement
.
L’immense difficulté est qu’on ne renonce jamais totalement à être le
centre-tout du monde. C’est d’ailleurs ce que nous tendons à redevenir dans
le sommeil (du monde, de l’autre) et la situation de rêve où nous nous
repositionnons au centre. Freud : « l’inconscient ne renonce
jamais » et « l’inconscient n’oublie jamais ». La
première phase du développement de la psyché (je = tout = plaisir) à la
domination de laquelle nous avons du renoncer continue son travail en
sous-œuvre ; et ainsi dit Freud de toutes les phases de notre
développement psychique… Autrement dit : loin d’être dépassées et
annihilées, l’organisation du psychique est feuilletée de strates,
sédiments vivants plus ou moins profonds de notre histoire, coexistantes et
conflictuelles.
.
C’est bien ainsi que nous pouvons lire des phénomènes qui sans cette hypothèse
demeurent inexplicables (cf. argument de Freud, d.iv). En vrac : i)
les haines (cf. comment les adolescents
parlent à leurs parents) voire les meurtres envers les mères (en 2002 par
exemple, le cas d’un fils, 40 ans, en Seine et Marne qui a fait sauté la cage
thoracique de sa mère en lui sautant sur la poitrine avec des chaussures
cloutées) par leurs enfants sont parmi les plus violents que l’on puisse
observer. Ce sont aussi les amours les plus puissants (ambivalence).
Pourquoi ? La relation particulière entre l’enfant (serait-il déjà vieux –
« l’inconscient ignore le temps » (Freud)) et la mère n’est
pas compréhensible de l’extérieur – la folie de tels comportements ne peut être
comprise qu’en la référant à une relation invisible fortement et très
profondément ancrée dans la psyché de l’enfant, cette époque jamais oubliée
pendant laquelle cette dernière était, de façon ambivalente, la toute-puissante
haïe et aimée. Autrement dit : il y a plusieurs mères pour le
même être – la mère de l’amour-fusion, la mère haïe, la mère tendre, celle dont
on s’est partiellement détaché, celle avec qui l’on est sur un pied d’égalité,
etc. et ces mères coexistent parfois conflictuellement au sein de la même
psyché ; ii) le lien puissant au père – de l’extérieur (pour le regard
détaché qui est aussi l’un de nos regards), individu comme les autres,
peut-être insignifiant – et pourtant qui reste celui dont on veut se faire
reconnaître, qu’on imite ou/et avec lequel on rivalise, doté d’une autorité que
n’ont pas les autres hommes, etc. Cette appréhension du père ne peut là encore
se comprendre qu’en référence à ce qu’il a été et continue d’être à un stade de
notre constitution psychique – ce père c’est encore en partie le véhicule de
l’interdit, celui qui porte autorité et jugement ; c’est aussi celui que l’on admiré et qui a constitué notre
idéal ; iii) le comportement de l’enfant « très sage » à
l’école, obéissant aux règles, investissant le travail – et « impossible à la maison » :
c’est qu’il s’agit pour lui de deux mondes – monde qu’il investit comme
un petit tyran, c'est-à-dire ce qu’il reste aussi, un tout-puissant
manipulant les êtres selon son bon plaisir, (phénomène contemporain d’un défaut
de l’autorité et donc de l’interdit lors de l’éducation) alors même qu’une
autre partie de lui-même connaît les règles (et il a du renoncé au
moi-centre-tout pour les faire siennes) ; iv) etc. etc.
Notes
sur la pluralité des mondes
.
On pourrait multiplier les exemples… tous manifestent que nous vivons dans une pluralité
de mondes : autant de mondes que de strates psychiques. Du point de
vue de l’épreuve qu’en fait un sujet, un monde, en effet, est l’horizon qui
se déploie autour d’un sujet et dans lequel apparaissent des objets constitués
selon des schémas, des relations et des valeurs spécifiques à ce monde. Dans
ce cadre, le rêve, bien sûr, est un autre monde ; mais encore le
psychotique, le névrosé, ceux qui jouent, fantasment … constituent à chaque fois des monde
propres, mondes subjectifs privés incompréhensibles pour le regard
rationnel – mondes qui coexistent plus ou moins conflictuellement avec ce
qu’on appelle le monde et qui est lui aussi un monde subjectif
mais, lui, commun et partagé, monde pour la conscience éveillée (cf.
première partie) visant les objets sur l’horizon langagier (donc social) du
partageable et de l’universel (monde dont on va voir, cf. « l’inconscient
social » qu’il n’est lui-même pas unique puisqu’il y a autant
de ces mondes sociaux et partagés que de sociétés). De là la possibilité de décrire
chaque relation, geste ou mot… dans des
langages différents tentant de correspondre à cette pluralité des
mondes psychiques : ainsi Miguelito sur son toboggan est à la fois un
simple enfant sur un toboggan parmi une pluralité d’autres ; un maître du
monde tout-puissant qui réduit l’univers à son plaisir ; un être en
relation (à ses camarades, aux adultes) qui veut être reconnu…
Reste
que si des désirs archaïques continuent leur œuvre en sourdine, nul ne peut –
sauf folie - échapper à la nécessité douloureuse de renoncer partiellement à
l’objet de ses désirs en acceptant et faisant partiellement sienne la réalité
extérieure. Jusqu’où une telle appropriation est-elle, cependant,
possible ?
5)
Jusqu’où pouvons-nous, en effet, et à quelle condition faire du monde notre
monde, un lieu approprié où l’on puisse vivre chez soi ? Toute
renonciation, avons-nous vu, peut être en partie compensée par la possibilité
de s’approprier ce nouveau monde, de s’y faire une place en lui donnant sens et
valeur. Mais quelle devrait être la dernière étape sinon la reconnaissance
dernière que par delà la pluralité des sociétés humaines, l’immensité infinie
de la nature fait de nous des points condamnés à la mort ? Comment faire
sienne, comment investir et s’approprier une telle révélation ? Une telle
vérité auprès de laquelle tout désir est immédiatement annihilé ne saurait être
désirée : aussi ne peut-elle faire sens puisque la mort est l’abolition de
tout sens – montrant l’irréductibilité dernière et inappropriable,
l’étrangeté radicale, de la nature à notre subjectivité.
Mais,
psychiquement immensément douloureuse puisque demandant de renoncer à soi
c'est-à-dire à tout, une telle étape n’est presque jamais psychiquement
franchie (et, en ses strates les plus anciennes, jamais – ma mort est
l’extinction du monde, cela reste vrai quelque conscience lucide que je
puisse avoir de ma mortalité) dans l’histoire humaine. L’institution religieuse
de la société (qui représente la quasi-totalité des sociétés humaines - pour le
détail, cf. + bas, 4. l’inconscient
social) en posant l’existence d’un sens dernier (contre l’absence de sens)
c’est à dire en relativisant la mort qui n’est pas anéantissement sans reste
puisque l’essentiel (le monde sacré, mon âme ou / et Dieu…) est sensé perdurer,
en nous posant (nous les bons, les justes, les fidèles) au centre des
préoccupations d’un ou de dieux (figure du Père), en scindant l’humanité en
nous et en eux (fidèle / infidèle, ami / ennemi…) garantissant ainsi pour notre
plus grande joie que nous sommes les premiers - constitue pour la psyché
humaine un immense bénéfice, moyen dernier d’investir et de s’approprier
un monde qui n’apparaît pas radicalement étranger à notre désir.
Bilan sur l’appropriation –
expulsion du monde
|
Etapes de constitution
de la psyché dans sa relation à l’extériorité du monde. |
Monde approprié =
« autre mien » |
Mauvais monde =
« autre étranger » |
|
Clôture primordiale
autistique d’un être autosuffisant. |
Pas encore de monde extérieur
à soi : « je = tout = plaisir » « A l’origine le
moi contient tout, ultérieurement il sépare de lui un monde extérieur »
(Freud) |
Pas encore de monde extérieur
à soi : « je = tout = plaisir » |
|
Brisure de la clôture Nous sommes deux. |
« Le bon sein ».
La bonne mère – le bon lait… = le bon monde |
« Le mauvais sein ».
La mauvaise mère = le mauvais monde |
|
Nous sommes trois. Interdit de fusion,
reconnaissance de l’interdit et de sa place dans la structure
familiale. |
Identification – création
de l’idéal du moi : le père tout-puissant aimé et pris pour idéal :
ouverture de nouvelles relations prises dans un nouvel horizon (futur) du
monde. |
Complexe d’Œdipe :
« Le père haï et expulsé ». Re-centration sur la mère. Expulsion du
corps étranger. |
|
Nous sommes plusieurs et
ma famille est une famille parmi d’autres dans l’espace social. |
Investissement du monde
social, de ses valeurs et de ses buts,
de ma définition (rôle, situation) sociale. |
Reflux
vers le monde clos familial. Les autres = angoisse et peur. |
|
Il y a plusieurs sociétés,
irréductibles à la mienne. |
Cosmopolitisme :
« citoyen du monde ». |
Séparation
de l’ami (nous = les bons, les justes) / ennemi = l’étranger, l’infidèle –
selon une pluralité de cercles concentriques (le village, la patrie,
la religion, la race…). |
|
Je ne suis rien dans le
grand univers. |
???? pb du sens de la
vie ???? Accepter la mortalité |
La mort, le néant de nos
vies = horreur et angoisse. = « l’immonde »
(ce qui ne peut faire monde) |
Retour
sur le texte de Nietzsche
.
C’est dans ce vaste mouvement d’introjection (tirer vers soi = faire sien) du
monde social et de projection de soi sur le monde qu’est l’appropriation
affective du monde que l’on peut maintenant resituer le propos de Nietzsche.
Les exemples qu’il déploie se situent à une phase tardive du développement
psychique : l’académicien parlant comme s’il était éternel, les femmes et
leur enfant, leur ville, leur chien – ont tous, pour une part, accepté la
réalité sociale, ses valeurs et ses buts. Ils s’y reconnaissent – cette
réalité est la leur. Lorsqu’on imagine par exemple le propriétaire
terrien regarder sa terre, le villageois sa ville ou même la réussite de son
enfant ce n’est nullement un pur sentiment désintéressé de contemplation
esthétique (cf. I. 2 – la contemplation) qui explique le profond sentiment
d’expansion et d’attachement qui
est relié à cette contemplation – c’est que cette terre qui s’en va au loin par
delà les montagnes, cette ville et sa grandeur, cet enfant et son avenir de
médecin (cf. Susanita, plus bas) « c’est moi » = la représentation d’un objet (posé devant
moi, à distance de moi, devant mon regard : celui de la perception, comme
celui de l’imagination) dont je projette devant moi le sens et
les schémas constitutifs (cette ville est, par exemple, tissée de mille
souvenirs et mille attachements qui n’appartiennent qu’à moi), ces schémas de
constitution et de lecture profondément ancrés dans l’histoire de mes affects me
dispersant et me déployant à travers la campagne, la ville, cet enfant… De
tels objets sont constitués comme un miroir expansé du moi (cf. Lacan et
le stade du miroir – découvrant son image dans le miroir, le petit
enfant, se projette pour la première fois dans l’image et, sous le
regard de l’autre aimé qui le désigne, s’y voit, dans la jubilation, comme
une totalité parfaite et maîtrisée ; mais ce n’est là qu’une image,
ainsi de ce tout ce que nous investirons comme nôtre) figurant une quasi-totalité
parfaite à travers laquelle je me/les (projection / introjection)
lis comme la réalisation de mon désir central, celui d’être le centre-tout.
.
Que cependant une telle représentation ne soit pas totale et véritable
réalisation de ce désir mais simplement un substitut partiel, c’est ce
que montre le fait que nul ne saurait vivre entièrement satisfait sa vie durant
en une telle contemplation (il y a donc encore désir et désir d’autre chose)
et, qu’ainsi, dans les exemples que prend Nietzsche, la contemplation
silencieuse et solitaire fait place à la parole c'est-à-dire au désir de
se dire appelant la reconnaissance des autres. Ces grands hommes,
tels des académiciens, qui « parlent comme si tous les âges se tenaient
derrière eux et s’ils étaient la tête de ce long corps » - se projettent,
se disent et se lisent sur la scène imaginaire majestueuse de la science ou
de l’art, parmi un panthéon de quasi-divinités parmi lesquelles humblement il
s’inscrit comme une continuateur, vivant ainsi par procuration la vie
imaginaire de la Science ou de l’Art hypostasiés (transformés en êtres
transcendants et éternels) ; cette scène imaginaire où ils se projette ne
se suffit pourtant pas de la seule imagination privée, elle se dit et se
cherche devant un public dans les yeux duquel on cherche l’approbation. Les
autres deviennent alors les milles yeux à travers lesquels se répercute et
s’amplifie l’image que j’ai et désire avoir de moi-même – les
applaudissements sont alors vécus comme une entrée dans l’éternité. Qu’ils n’en
soient pourtant qu’un substitut partiel, fragile et temporaire c’est ce
que le doute, le changement de regard d’autrui, la nécessité de se convaincre à
nouveau et d’en convaincre d’autres en élargissant le cercle de la
reconnaissance montre suffisamment. Davantage, le fait que dire « tout
cela, c’est moi » apparaîtrait ridicule aux autres et très douteux à
soi-même fait apparaître la fragilité de cette appropriation pourtant
véritablement vécue. C’est que, fondamentalement, l’image de moi-même est séparée
de moi – c’est un autre que moi, succédané de ce que je
voudrais être : être le centre-tout, faire corps avec la totalité
dont la représentation (devant, distance) qui me relie pourtant, me sépare (en
me dédoublant).
.
La même logique d’appropriation fragile est lisible dans ces autres
exemples de Nietzsche – celui par exemple de la relation de la mère et de son
enfant.

Il est classique, en effet, de dire que l’on éduque
ses enfants et que l’on désire pour eux tout ce que nous n’avons pas pu être – mon
enfant devient ainsi le miroir à travers lequel se projette mon désir
d’être le centre-tout, tous ces désirs
de grandeur qui, toujours là, ne trouvent pas encore en ma propre image
réalisation. Ainsi de l’enfant rêvé de Susanita (ci contre) : elle le voit
c'est-à-dire s’y voit, se/le berçant, se/le coiffant, moi/lui réussissant. Dans
ces trois premières images elle est avec, la coexistence et la proximité
imageant dans la réalité la fusion qu’elle désire et vit par imagination
à travers elles (« mon enfant c’est moi »).
La quatrième image vient briser cette illusoire
fusion – ce corps à corps avec l’enfant, ce corps à corps avec l’image de
soi, révélant l’impossible fusion, l’impossible position d’être ce que l’on
désire, à savoir ce centre-tout parfait. L’autre est un autre que moi :
l’enfant s’en ira avec une autre, en aimera une autre, il ne sera plus tout à
moi, il ne sera plus ce regard qui me confirme dans mon être en me donnant pour
moi-même l’image de l’indispensable, de celle qui est « tout »
pour un autre (à savoir l’enfant). De là (cf. d. i – la haine) la
transformation en haine (de tout ce qui s’oppose à mon désir) : haine de
la belle-fille, haine de l’enfant aimé magistralement broyé avant même d’être
né par une Susanita ne supportant pas de pas être le centre-tout du monde.
. On pourrait ainsi, depuis la perte première de la
position de centre, depuis la déchéance de la naissance, dresser une petite
liste de tous ces substituts au désir que nous nous recréons afin de
pouvoir vivre : il s’agit toujours de réductions de l’infinité du
réel (les milliards et milliards d’autres, l’infinité du temps et de l’espace)
à un monde vécu comme une totalité centrée. Si une telle réduction est
inhérente à la vie et au désir qui la meut, on peut dire ainsi avec Cioran que
« vivre c’est s’aveugler sur ses propres dimensions ».
Dressons un petit catalogue de ces micro-totalités, de ces « bulles »
quasi-fermées au sein desquelles nous nous resituons : i) le sommeil comme
effacement du monde extérieur, retour autistique à la totalité close ; ii)
le rêve comme constitution d’un monde centré sur mes désirs ; iii) le jeu
(cf. + haut) comme recréation sur l’espace imaginaire du comme si d’un
lieu pour le désir ; iv) les fantasmes comme satisfaction imaginaire du
désir ; v) la constitution d’ « objets transitionnels » (Winnicott)
c'est-à-dire d’objets, d’espaces ou de personnes que nous nous sommes
appropriés et qui nous servent tant de protection que de transition pour aller
vers le sauvage, étrange et étranger monde extérieur. Ainsi du doudou de
l’enfant, de sa chambre, de la famille, de la maison, du village, de la patrie…
comme objets ou lieux avec ou dans lesquels nous vivons, où nous sommes chez
nous – « où nous nous retrouvons » - dans un monde clos à la
mesure de notre désir ; ainsi peut-on penser la constitution de ces
micro-totalités dans lesquelles nous vivons comme si elles étaient tout
– le bureau et ses hiérarchies (« je veux être chef de service » =
vécu comme être tout, alors même qu’il y a des millions d’autres chefs…), les
salles d’école ou de sport et leur compétition (« être à la place de
Mireille » - alors même qu’il y en a des millions d’autres dans l’espace
et le temps), la famille où le petit employé redevient pour un temps le
centre-tyran-maître, etc. Ainsi à chaque niveau de la hiérarchie sociale (elle
aussi reconnue et importante pour l’image de soi) se recréent des niveaux
hiérarchiques où chacun – serait-il simple employé – se constitue un
micro-système de différence et de position où il peut se lire comme occupant
quelque position dans la totalité (de là le zèle, la concurrence, la jalousie…
à tous les niveaux de l’échelle sociale) ; vi) enfin indissociable de ces
dernières micro-totalités, la recherche de la reconnaissance de l’autre (cf. analyse
+ haut) : l’acquiescement de cet autre étant vécu dans la plénitude comme
une confirmation de soi (alors même que nous vivons dans l’indifférence
généralisée parmi des milliards d’êtres aux identiques désirs, aux mêmes
illusions).
Conclusion sur l’inconscient psychique
.
Alors que la conscience naïve croit s’appartenir et se maîtriser dans
l’immédiateté d’une cohérence et d’une adéquation de soi à soi, l’analyse nous
révèle que nous sommes étrangers à nous-mêmes : loin d’être un tout
unifié et conscient de soi, nous sommes divisés en différentes strates
psychiques inconscientes, souvent conflictuelles tirant à hue et à dia notre
petite vie et qui se manifestent indirectement à une conscience qui en
semble le jouet.
.
Quel autre but alors de l’analyse philosophique et de la psychanalyse (où
l’autre apparaît comme le miroir à travers lequel j’apprends à me voir) que de
se libérer ? La
psychanalyse vise ainsi à se connaître soi-même, à connaître les forces
qui nous constituent de façon à nous transformer c'est-à-dire à
changer le rapport que nous avons avec elles. Alors que le propre de la
conscience est de refouler ce qu’elle ne supporte pas et de suivre en
petit chien rationalisant les pulsions inconscientes, la psychanalyse
vise à les mettre à jour pour savoir ce qui me constitue et décider,
le mieux possible, en connaissance de cause, autant que cela m’est possible, de
ce que je veux être. La psychanalyse vise ainsi à rendre conscient et à
substituer – autant qu’il est possible - à l’ensemble de forces qui déterminent
ma vie et que je n’ai pas choisies, une activité consciente de soi,
réflexive et volontaire. « Là où ça était Je doit advenir» :
telle est ainsi la formulation générale du but de la psychanalyse que Freud
nous propose – le ça étant l’ensemble des forces impersonnelles inconscientes
(« ça désire »), le Je étant l’instance que nous devons faire
naître afin de devenir les sujets de nos vies. A l’image d’un
sujet dominant immédiatement sa vie par son caractère conscient et sa dotation
immédiate d’une volonté libre (première partie) nous devons ainsi substituer
celle d’un sujet divisé qui a à se construire, se faire et se
vouloir : la conscience et la liberté sont une tâche bien plutôt qu’un
donné.
.
Si, avons-nous vu, notre genèse psychique est indissociable d’un processus d’appropriation
qui est à la fois une ouverture et une réduction de l’altérité du
réel, quelle relation devons-nous établir à l’autre que nous-mêmes (la
nature, les autres, les sociétés) ? Si ultimement l’altérité de la nature se manifeste
par notre mort, on voit difficilement comment une relation vraie et libre à
l’autre que soi pourrait se déployer sans une reconnaissance et une acceptation
de notre mortalité. N’est-ce pas alors sur le fond d’une telle conscience de
notre finitude, du non-sens dernier d’une nature qui n’est pas faite
pour nous et dans laquelle nous avons laborieusement à construire du
sens, contre toutes les tentatives de re-totalisation et de clôtures du monde
sur l’ego-centre, que nous devrions penser notre relation au monde ?
Certes alors il ne s’agit pas de nier et d’abandonner ces espaces
intermédiaires où nous nous construisons des foyers de vie – le rêve, le
jeu, la famille, la ville, le monde du travail, la patrie… - mais, au moins
pour les derniers, de cesser de les absolutiser en les situant
hiérarchiquement les uns par rapport aux autres. Ainsi, à rebours du
mouvement spontanément égocentrique de la psyché, Montesquieu peut-il
décider : « si je connaissais quelque chose qui fût bénéfique à ma
famille mais préjudiciable à ma patrie..., bénéfique à ma patrie mais
préjudiciable au genre humain... je le rejetterai de mon esprit » - ce qui signifie
articuler hiérarchiquement les espaces de valeur et de vie en leur
préservant une indépendance relative sans simplement nier l’un pour l’autre (la
famille pour la patrie, par ex : toute action pour la famille n’est pas
négation de la patrie).
Transition : mais un tel
projet de réflexivité et de libération suppose que nous réfléchissions,
maîtrisions et transformions ces autres forces, qui, introjectées au sein de
notre vie psychique, s’imposent à nous et font de nous les valets du « gros
animal » (Platon) social.
4)
Un inconscient social ?
Si la conscience est spontanément aveugle sur les désirs inconscients
qui la tiraillent et la déterminent, désirs qu’il faut en dernière instance
référer à la psyché de l’individu et à son origine dans la chute de la position
de centre-tout-puissant, ces désirs sont, cependant, dans l’histoire du sujet,
indissociables de la dimension sociale que le sujet, avons-nous, vu introjecte
en se l’appropriant et en en faisant un élément de son monde (qui, dès la
rupture de la clôture primordiale, perd ainsi en partie sa dimension
privée). La pluralité irréductible des mondes sociaux (cultures), l’unité de
signification et d’organisation de chacun de ces mondes (le système
aztèque ; capitaliste ; l’Ancien-Régime, etc…) qui donne un sens à
l’idée de parler de la société comme totalité, l’incrustation profonde
et cependant invisible à l’individu de ces mondes sociaux irréductibles dans le
regard, la pensée, le désir de l’individu… formant autant de quasi-exemplaires
d’individus sociaux suggèrent l’idée d’un inconscient social qui, à
notre insu, déterminerait la conscience. Inconscient : puissances
structurées déterminant la conscience à son insu. Social : réalité
transindividuelle – quoique n’existant qu’à travers les individus (tout ainsi
que l’espèce, le genos) - artificielle (non naturelle, à la différence
de l’espèce) du « collectif anonyme » (Castoriadis), produit
de l’histoire humaine, constitué d’une unité de significations imaginaires
(Dieu, l’argent, Quetzalcóatl…) indissociables d’une organisation et d’une
structuration du monde humain et naturel, s’imposant à l’individu en mettant
en forme ses pensées, ses désirs, ses affects.
Tentons donc une première reconnaissance d’une telle détermination.
Notre premier étonnement est que justement elle n’apparaît pas.
a) Le point de vue de la conscience sur elle-même – retour à la
conscience naïve
Il me semble, en effet, que ma conscience = indépendante de la
société : a) que je vois ce qui est tel que cela est ; b) que mes
désirs, mes goûts, mes haines... sont miens et me définissent. Autrement
dit : a) la conscience vit comme naturelle c'est-à-dire allant de
soi - et ayant une valeur en soi (opp. « contre nature » :
malaise et révolte / contraire) – certaines pratiques et perceptions communes
(par exemple, chez nous la douceur d’une mère, le respect des vieux… ; une
musique « harmonieuse », des notes « justes »…) ; b) je vis
mes pensées, mes désirs, mes goûts, mes haines… comme définissant ma nature
propre indépendamment de toute médiation sociale. L’idée d’un inconscient social
ne saurait donc apparaître à ma conscience immédiate.
b) Le point de vue de la conscience est illusoire : présence et
invisibilité de la culture
Et pourtant il n’y
a pas une pratique, une pensée, un affect, un regard qui ne soit structuré
socialement. Montrons-le en nous décentrant de notre point de vue spontané
(social) et en éclairant ce dernier depuis d’autres points de vue, celui des
autres cultures.
i) La culture
est en nous : reconnaissance du fait.
Rappel : il y
a des pratiques humaines que nous vivons et pensons comme « naturelles »
= i) vont de soi (être quasi-spontané) ; ii) ont une valeur (malaise voire
révolte / contraire). Ex : nourriture (quoi ? comment ?),
rapport mère / enfant, mari / femme, jeunes / vieux, musique, l’accent (langue)
(notre accent nous paraît naturel, nous n’avons pas d’accent… ce sont
les autres), etc, etc. Mais – texte de Malson – dans d’autres sociétés
ce qui nous choque, nous dégoûte, ce qui paraît étrange… = la norme (normal,
valeur) vécue tout aussi naturellement que nous vivons les nôtres.

Conséquences :
délocalisation - nous vivons comme évident, « naturel »,
immédiat et éternel une réalité culturelle historique variable dans le
temps et l’espace : une culture – soit un ensemble de pratiques normées
socialement et historiquement déterminées – est inscrite dans notre chair, nos
perceptions, nos pensées, nos désirs. Tel serait l’inconscient social
s’inscrivant en nous malgré nous. Alors que la conscience se vit comme
transparente, croyant que sa perception immédiate de soi, des autres et des
choses est aussi connaissance (c'est-à-dire savoir de ce que sont les choses en
soi), force est de constater qu’elle ne perçoit, désire et ressent le monde
qu’à travers le prisme de structures et de schémas sociaux qu’elle a
incorporés. Aussi, notant la puissance formatrice de la culture sur les
hommes, Montaigne pouvait-il écrire : « la coutume est notre
seconde nature ».
ii) Impossibilité
de dissocier le culturel du naturel en l’homme
Mais si la coutume
est une seconde nature (vécue dans la spontanéité et l’immédiateté comme si
c’était naturel) y en a-t-il une première qui soit encore humaine ? C’est ce
que l’on pourrait imaginer en tentant de séparer une nature humaine
biologique – le corps - de la culture qui se surimpose à une telle nature
(l’esprit, le sens). C’est ce qui est, cependant, dans l’immense majorité des
cas impossible : le corps biologique de l’individu social est
culturellement formé, la culture est ancrée dans le corps de l’homme.

Analyse rapide : la critique de
l’artificialisme culturel – des formes et des normes arbitraires et
artificielles nous tenant lieu de pseudo-nature - engage souvent l’idée
d’un retour à la nature, à une nature humaine non corrompue
en-deçà de l’arbitraire culturel (cf. une certaine interprétation de
Rousseau, mais encore le naturisme, les hippies…). Mais montre
Merleau-Ponty, il n’y a pas d’homme naturel (et donc plus naturel
qu’un autre) auquel on pourrait revenir – sinon à redevenir (ce qui est
impossible, sauf lobotomie) animal aveugle et stupide. Il n’y a, en effet,
pas un geste, pas une fonction, pas un désir qui ne soit, en l’homme,
détourné de son sens simplement biologique. Pensons, par exemple, à la
sexualité qu’on veut inscrire dans la seule biologie parce que commune à
l’animal et nous – elle se double toujours chez l’homme d’une mise en
scène et d’une signification imaginaire dont on ne saurait abstraire la
forme précise des schémas sociaux propres à telle culture : « embrasser
dans l’amour » comme dit Merleau-Ponty n’est nullement naturel,
cela n’existe pas dans certaines cultures, cela change de sens selon
les lieux et les personnes ; nul doute cependant que ce n’est pas un
geste instinctif mais un acte intensément signifiant engageant l’imagination
d’un rapport particulier à l’autre. Mais, inversement, de telles conduites
ne sont pas des conduites purement spirituelles : elles s’ancrent dans
le corps. Ce qu’il faut donc concevoir avec l’homme c’est que tous ses
gestes et conduites sont du sens (de l’esprit) incarné ou bien, c’est la même chose, du corps
spiritualisé. L’entrée dans l’humanité signe ainsi la sortie de la
simplicité et de l’immédiateté de la vie animale et l’entrée dans l’équivocité
(interprétable, variable, modifiable, donnant à penser) d’un monde
imaginaire de la signification qui double maintenant sa vie.
iii) La perception
humaine fait de la nature une « forêt de symboles »
(Baudelaire)
Si le monde humain
n’est plus un monde immédiat – les choses perçues se doublent maintenant d’un
sens imaginaire, elles deviennent ainsi des symboles. Symbole = unité d’un
signifiant (matérialité, corporéité visible de la chose ou du mot –
« l’eau », par exemple ou le son « o ») et de
significations imaginaires (ce que cela veut dire). Le monde humain devient un langage,
et est ainsi tissé d’imaginaire, la substance même du rêve. Descartes et l’eau
de la source / cruche : « De l’eau toujours de l’eau ; mais
elle a toujours aussi un autre goût, quand on la boit à la source même, plutôt
que dans une cruche ou à la rivière » (Descartes, Lettre à
Beeckman, 17 oct. 1630). Le goût d’une eau identique est ainsi différent.
Etonnement : le goût nous semble adhérent à la chose, immédiat, sans
lien à tout imaginaire. En réalité : notre plaisir est indissociablement
tissé de l’imaginaire de significations (Pureté, Nature…) – cf. encore boire après
un autre, dans un verre sale, seul ou avec d’autres etc… L’eau est le symbole
incarné d’un autre monde (qui est ce monde humanisé) que la matérialité
du contact humain vient éveiller en notre esprit et projeter sur la nature.
Nous buvons en poète : cf. Holderlin : « l’homme habite en
poète sur cette terre » - c'est-à-dire transforme la matérialité
muette du monde en significations (imaginaires, spirituelles). Texte de White –
tentant poétiquement en imageant le passage de l’animalité à l’humanité de révéler
un tel changement de monde. « Ce n’était pas le même soleil » :
désormais symboles, les éléments de la nature se mettent à parler, à
dire nos espérances, nos joies, notre destinée… Cf. texte de Maupassant, Le
Lorrain, Van Gogh.



Claude Lorrain, L’embarquement de la
reine de Saba Van Gogh, Champ de blé

On comprend ainsi
la vérité propre de ce poème de Baudelaire : « La Nature est un temple
où de vivants piliers ; laissent parfois sortir de confuses paroles ;
l’homme y passe à travers des forêts de symboles ; qui l’observent avec
des regards familiers » (Fleurs du mal, Correspondances). Si,
en effet, la poésie apparaît souvent au regard prosaïque comme un doux
mensonge ou une fioriture posée sur la matérialité vraie des choses – de là le
fait que le regard quotidien ne comprend simplement pas ce que veut dire ici
Baudelaire – ce n’est pas que la prose du langage quotidien s’ancre dans un
contact direct et immédiat avec la Terre (ce que croient le paysan, le
banquier, etc.) c’est qu’il utilise pour voir, indissociable de sa
conscience des choses, d’ancienne métaphores, sédimentées et figées
en lui sous formes de schémas imaginaires de perception. La grande
poésie, au contraire, vise à réveiller les imaginations figées, à faire
revivre et à déployer les métaphores derrière les liens rigides et
quasi-univoque qui lient le sens imaginaire et les choses (cf. « c’est
de l’eau »). Le poète – plus largement l’artiste, quand il est bon -
c’est ainsi celui qui vient amplifier notre regard : derrière le
dégoût de boire après un autre, il dévoilera et développera le
sens imaginaire qui s’y cherche – celui d’un mélange des chairs, le
corps infect d’autrui, par l’humidité lourde et huileuse de ses lèvres
bouffies, venant imprégner mon corps et souiller sa pureté en une
sombre intrusion…; a contrario, c’est un tout autre poème qui se rêve déjà
au contact du verre effleuré par l’être aimé…
c) La culture
met en forme l’homme
Si la culture est
en tout homme imprégnant ses pensées, ses gestes, ses affects et ses
désirs il faut dire que la culture met en forme l’homme. Mettre en
forme = comme le sculpteur avec la terre informe, ordonner, donner sens et
structure. Texte d’Aristote : en dehors de la société qui, par
l’éducation, opère cette mise en forme, l’homme est un « dieu ou un
monstre ». Dieu = autosuffisant; monstre = difforme : qui n’a pas
été formé. Ex. des «enfants sauvages» : forme
extérieure (corps, stature, visage) et intérieure (pensées, désirs,
affects) = animale. A contrario, par l’éducation, la société met en forme
(spiritualise, socialise) l’enfant humain, le fait sortir du caractère privé,
asocial d’un monde réduit à son désir chaotique pour lequel n’existe nulle
autre réalité (cf. généalogie de la psyché) et l’ouvre en lui-même à la
communauté humaine qu’elle inscrit dans son corps, ses désirs, ses pensées.
Aristote : « la Cité (ici la société) est antérieure à l’individu »
comme l’organisme à l’égard d’une main (qui n’est vivante et fonctionnelle
qu’insérée et intégrée dans la totalité vivante). Comme le corps vivant n’est
pas, en effet, une somme de parties mortes (cf. Frankenstein), la société n’est
pas une somme d’individus asociaux. Bien que n’existant qu’à travers des
individus qu’elle excède pourtant infiniment (langue, institutions, mémoire
sociale pratique et langagière : notre pensée, par exemple, est bruissante
de mots c'est-à-dire de la pensée de tous ces autres qui nous ont précédés), la
société précède l’individu particulier et est la condition interne
de son humanité (donc de sa conscience et de sa liberté).

Ce lien particulier
de la société humaine et de l’homme, Aristote le cerne ici à travers le parole.
Pour l’homme, en effet, parler ce n’est pas proférer un cri, reflet immédiat et
privé d’un rapport interne à mon propre corps, c’est déployer sa pensée sur un horizon
social commun de compréhension. Dès que je parle, en effet, dès que je dis
quelque chose, je sais, pense et attend qu’autrui me comprenne, ce pourquoi
devant son incompréhension je lui donnerai des raisons que je n’imagine pas
miennes et privées mais communes et communicables (cf. cours sur la raison,
textes de Marc-Aurèle et Malebranche). Pensant avec les mots communs dont le
sens ne m’appartient pas – « nous pensons dans les mots »
(Hegel) - mots introjectés et
appropriés lors de la socialisation de la psyché, la pensée n’est donc pas
privée, elle est sociale par essence. De là le fait, souligné par
Aristote, que le juste et l’injuste, le bien et le mal… soient des valeurs
communes sur lesquelles nous pouvons, grâce à cette communauté de langage, qui
est aussi communauté de raison (logos = parole et raison), nous entendre et
fonder ainsi un monde commun. Le problème qui reste ici, cependant posé, est
celui de savoir pourquoi, nous ne nous entendons pourtant pas – si l’on
s’accorde, par exemple, sur l’exigence de justice, nous ne lui donnons
cependant pas le même sens (cf. droite / gauche / religieux, etc.): il s’agira
alors de penser les conditions (individuelles, sociales) de la séparation des
hommes (sociaux) et de leur union.
d) La mise en
forme de l’homme par la société est normalisation
Mais si la société
est, par l’éducation (qui est permanente et jamais terminée), la condition de
la conscience et de la liberté humaine, elle en est aussi un obstacle. La mise
en forme de l’individu par la culture est aussi mise en norme, soit normalisation
rigide de son comportement, de ses désirs et de ses pensées. Ce pourquoi loin
d’être le spectacle de la liberté, l’histoire humaine peut tout autant
apparaître comme celle de la servitude (cf. texte de Kant sur les Lumières),
les sociétés pouvant être imagées comme des immenses machines poursuivant leurs
propres fins à travers la production en série d’individus qu’elle socialise,
met en forme et normalise. Ainsi la société aztèque produit-elle par millions
des petits aztèques ayant les mêmes désirs, goûts et pensées ; ainsi des
chrétiens de l’Ancien régime ; ainsi, avec des nuances qu’il nous faudra
poser, de la société capitaliste contemporaine, etc. C’est que l’institution de
l’immense majorité des sociétés de l’histoire humaine est une institution
rigide et incontestable c'est-à-dire religieuse.
i) L’institution
religieuse de la société
Religion = ensemble de
mythes et de rites structurant et normant la vie sociale sous leur ordre
rigide (cf. première partie du cours) : exemple de la société chrétienne
du Moyen Age où toute la vie : les corps (statut normé de la chair
et du désir), la structuration du temps de vie (l’église rythme la vie des
champs – la cloche; le dimanche, jour du Seigneur ; les prières du
repas ; les temps de la vie = inscrits dans le sacré – baptême, fêtes
religieuses, mariage, mort et sacrement) et de l’espace (séparation des espaces
sacrés et profanes – l’église, Jérusalem, les chemins de croix… comme
autant de lieux où se manifeste par excellence le sacré), la hiérarchie sociale
(le roi de droit divin, la prêtrise, les nobles et le sang bleu…) incarnent et répètent
un modèle religieux (que celui-ci ne soit pas strictement adéquat aux
Evangiles mais résulte d’une histoire propre n’a ici nulle importance, si les
hommes croient – et c’est le cas – qu’un tel modèle est divin et éternel). Les
sociétés religieuses sont des sociétés de répétition (répétition d’un
modèle divin posé comme véritable réel) qui se caractérisent par le fait que
les hommes posent à l’extérieur d’eux-mêmes, de leur liberté et de leurs
désirs, la source de l’institution. Autrement dit : l’origine des
valeurs et du sens qui structurent la société est posée et vécue comme transcendante
(au-delà) aux hommes et non immanente (provenant d’eux-mêmes) – nous ne
sommes pas les maîtres et les créateurs du sens de nos vies. En saturant le
monde de réponses inquestionnées et inquestionnables, l’institution religieuse
de la société redonne aux hommes le repos (quelque, physiquement et moralement,
éprouvante soit la vie du religieux) dont le mythe de la Genèse (cf. première
partie) nous avons cependant appris que la perte était contemporaine de
l’avènement de l’homme (l’arbre de la connaissance est celui du doute).

Analyse rapide : à l’opposé de l’homme
libre sartrien pour qui « l’existence précède l’essence »
(cf. première partie), « pour l’homo religiosus l’essence précède
l’existence » - autrement dit : loin de vivre dans l’interrogation
sur ce qu’il est et ce qu’il doit être, ce dernier vit dans les
réponses : l’essence (ce que je suis, ce qu’est la vie, le monde, les
autres et ce que je dois y faire… – ce qui est vraiment et ce qui vaut
vraiment, le tout inscrit et défini dans le livre divin) précède
son existence. Avant d’être et de se faire, un modèle le précède qui
est une norme antérieure et supérieure à lui. La vie de l’homme
religieux doit donc être la répétition de ce que le modèle sacré pose
en tant qu’essence et essentiel. Le rite qui ponctue la vie du croyant
constitue ainsi cette répétition incarnant la vérité du mythe dans la chair
du présent. Cf. baptême comme répétition du baptême du Christ par
Jean-Baptiste et entrée dans la communauté chrétienne ; le dimanche
chômé = répétition du jour du repos du Seigneur : « Dieu acheva au septième
jour son oeuvre, qu'il avait faite: et il se reposa au septième jour de
toute son oeuvre, qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le
sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son oeuvre qu'il avait
créée en la faisant » (Genèse), etc.
Si nous
philosophons c’est donc que nous avons perdu la certitude de la religion –
alors même que toute société tend à clore
et à absolutiser les significations imaginaires qu’elle porte et qui la
meuvent. Présentons ici trois modes d’institution de la société (parmi une
multitude possible) comme réponses dogmatiques – posant l’essence et
l’essentiel - aux questions que pose la philosophie, c'est-à-dire à l’esprit
qui connaît le caractère partiellement (ou totalement) illusoire et erroné de
l’orientation socialement imposée et qui cherche, au-delà, une juste et vraie
orientation (cf. cours d’introduction). Notons pour le moment (avant l’analyse,
cf. d. ii) que si la société contemporaine n’est plus fondée sur une
institution religieuse de la société (cette dernière est référée à la volonté
des hommes et non aux dieux) elle impose, comme toute société, ses réponses et
ses orientations – pour le distrait qui ne l’aurait pas remarqué, nous ne
vivons pas, en effet, dans une société de philosophes...
. Notons aussi
qu’un tel modèle est simplificateur en ce qu’il met de côté les tensions
internes existant à l’intérieur des sociétés religieuses et expliquant en
partie la dynamique historique (cf. Moyen Age et la synthèse problématique des
deux modèles : César et Dieu ; l’épée du conquérant et le royaume de
Dieu… la difficile et mouvante synthèse de la noblesse), l’important
étant ici cependant la non-liberté à l’égard des modèles qui sont en
concurrence – et l’absence (là encore relative) corollaire de véritable
politique et de philosophie radicale.
|
Questions
philosophiques de l’orientation (sens) |
Aztèques |
Monde
chrétien du Moyen Age |
Société
capitaliste contemporaine |
|
Qui
suis-je ? |
Un enfant du
Soleil |
Un membre du
corps du Christ, fils du Dieu incrée, père du Ciel et de la Terre ; un
descendant d’Adam, créature pécheresse de Dieu rachetée par le Christ. |
Un produit
du hasard de la nature et un homo oeconomicus, cherchant à jouir en
consommant le plus possible et en travaillant le moins possible |
|
Qui est
l’autre ? |
Un
frère ; un supérieur hiérarchique (prêtre, prince) en communion privilégiée
avec le sacré ; un ennemi ; un dieu (cf. les espagnols) |
Tantôt un
frère issu de la même communauté (l’Eglise comme corps du Christ) ; un
infidèle (qu’on tolérera ou combattra mais avec lequel il ne saurait y avoir
égalité) ; un supérieur hiérarchique (prêtre, évêque, roi) en
communion privilégiée avec le sacré. |
Un égal que
je peux, si je suis le plus fort, exploiter ou, si ce n’est pas le cas, avec
qui je peux me lier par contrat. |
|
Qu’est-ce
que le monde ? |
Le cinquième
voué à périr (cycle de 6000 ans), monde du soleil du Dieu Quetzalcóatl. |
Une création
de Dieu, création transitoire vouée à disparaître lors de l’Apocalypse, où
règnera à nouveau le Christ. |
De la
matière dont la science nous donne les lois d’interaction. |
|
Comment
vivre ensemble ? |
Obéir aux
ordres du prince et à une hiérarchie de prêtres sous les lois coutumières
aztèques. |
Obéir aux
princes et à une hiérarchie de prêtres, sous les lois coutumières
chrétiennes. |
En cherchant
pour chacun à s’enrichir ; en constituant démocratiquement des lois
communes. |
|
Que
dois-je désirer ? |
Régénérer le
Soleil – s’offrir en sacrifice |
Le royaume
de Dieu – la vie éternelle par une vie pieuse. |
Consommer,
maîtriser (technique) et s’approprier le monde |
Ce dont il faut ici à nouveau
s’étonner c’est de l’irréductibilité des mondes imaginaires sociaux. En
entrant par la pensée dans chacun de ces mondes, nous entrons encore une fois
dans d’autres univers : les choses, les êtres humains, les valeurs,
les affects et les désirs, le corps matériel du monde (architecture, manières
de dire et de faire) et le corps même de l’homme (on reconnaît la culture des
hommes rien qu’en regardant leur corps) se transforment c’est à dire prennent
la forme qu’un imaginaire social spécifique leur a imposé.
ii) Les sociétés
libérées de l’institution religieuse rigide de la société ne sont pas pour
autant libres
Nous, modernes, à des degrés
variables, avons jeté les dieux à la porte : ce n’est plus, ou tendanciellement
plus, un principe divin inquestionné qui gouverne tant notre être-ensemble (la
religion a été reléguée dans la sphère privée) que nos vies personnelles. De
plus en plus, c’est le principe du libre choix, qui gouverne tant la
sphère publique (nous sommes les maîtres de nos valeurs communes) que la sphère
privée (je suis le maître de ma vie). Pour autant, il y a loin d’une telle
affirmation et d’une telle croyance en notre liberté à une véritable et
effective liberté – comme l’avait, par exemple, déjà souligné Tocqueville, un
rapide regard sur les hommes de notre temps montre que, contrairement à ce que
l’affirmation de leur radicale liberté devrait entraîner, leurs pensées, leurs
désirs et leur manières d’être sont quasi-identiques. Des normes, des valeurs =
des significations imaginaires sociales elles aussi inquestionnées nous
gouvernent à notre insu en prenant, cette fois, la forme apparente de notre
liberté.
1) Le système
production / consommation
. Appliquons ce
modèle à une signification imaginaire majeure de la société occidentale
contemporaine : celle selon laquelle le sens de la vie et donc le bonheur
serait à rechercher dans l’accumulation toujours plus grande de biens
matériels. Ancrage d’une telle signification dans la réalité : puissance
réelle de l’imaginaire de l’« american way of life » - partout
autour du monde, on ne recherche que ça ; la dynamique générale de la
société (entreprises, travailleurs, productions) vise une telle accumulation
(toujours plus – la croissance). Si, a contrario, un tel imaginaire historique
(il n’a pas, cf. + haut, toujours existé ) était désinvesti une grave
crise s’en suivrait : les entreprises ne pourraient plus vendre leurs
gadgets, des millions de travailleurs se retrouveraient à la rue, etc., etc. Et
pourtant un tel système est intrinsèquement absurde, illusoire et
mensonger : course en avant sans horizon, se payant de l’exploitation et
de la souffrance de la grande masse de l’humanité perdant la majeure partie de
leur vie dans un travail absurde pour un but insipide, il ne produit cependant
ni le sens ni le bonheur qu’il est censé promettre.
. Montrons-le tout d’abord en mettant en lumière ce
qui ne peut apparaître à celui qui est pris dans le jeu social :
que l’argent et l’accumulation de biens matériels ne puisse apporter le
bonheur, mieux que sa quête, qui consume toute une vie de labeur, soit une
quête sans fin ni sens, c’est ce que l’humanité sait depuis longtemps – le
livre de l’Ecclésiaste (Bible) disait déjà, pour un roi, c'est-à-dire pour
celui qui est allé au bout de nos plus grands désirs, la vanité de l’accumulation des biens (comme celle de la
gloire) ; ainsi d’un film tel Citizen Kane ; ou aujourd’hui des
revues People où les grands de ce monde exposent leur non-bonheur…
- ; l’étonnant est bien plutôt que
personne n’y croit, que l’individu éclairé par de tels exemples (cf. « l’argent
ne fait pas le bonheur », etc.), continue à suivre sa route et ne
change pas de chemin : pourquoi et comment fonctionne une telle
fascination aveugle ?
. Elle fonctionne
sur la base d’un quadruple aveuglement : sur la nature de l’objet,
sur le rapport à autrui, sur le rapport à soi-même et, plus globalement, sur la
logique sociale qui détermine de tels rapports.
. Sur la nature de
l’objet d’abord – on ne se jetterait pas sur tel nouveau bien, consumant le
produit de sa vie de travail, si un tel bien n’apparaissait pas intensément désirable.
Qu’il n’apporte nullement ce que le désir avait posé sur lui, c’est ce que le
cycle sans fin des achats montre assez : on est, finalement,
toujours déçu. Comment l’objet peut-il alors bien nous apparaître ainsi ?
En mentant sur lui-même, en apparaissant comme plus que ce qu’il n’est. Telle
est, premièrement la fonction générale de la publicité : « La
trahison est l’essence du discours publicitaire : celui-ci doit provoquer
le désir pour un produit avec des éléments rhétoriques [art de bien parler]
qui n’appartiennent pas au produit. La publicité pratique l’ironie [ici,
discours à double sens] afin que la chose présente ne soit pas seulement ce
qu’elle est, mais plus que ce qu’elle est (…). La publicité enveloppe l’objet
d’une idéalité [sens idéal imaginaire – cf. l’amour, la beauté, la
réussite, la puissance, etc.] qui le rend présentable au sujet dans des
termes où celui-ci, comme être de désir, puisse l’entendre. Elle doit ainsi
trahir ou aider à trahir l’objet pour qu’il devienne un produit. Le produit
ainsi conçu serait un objet recouvert d’une idéalité dite en mots, qui trahit
l’objet afin qu’il puisse être désiré par le sujet » (Quessada, L’esclavemaître,
p. 93). La publicité – pollution omniprésente et parfaitement légale – a ainsi
pour objet de transmuter ce qui n’est tout d’abord qu’une chose indifférente
extérieure à moi-même en objet de désir c'est-à-dire que je puisse, en termes
freudien (cf. II. 3) introjecter comme
mien. Or pour que je puisse l’introjecter ainsi il faut que je m’y
reconnaisse. C’est en théâtralisant c'est-à-dire en mettant en scène
l’objet à vendre de telle façon qu’il se mette à me dire moi-même - tel
que je suis et ne suis pas encore - et ainsi à devenir mon indispensable
complément que la publicité opère.


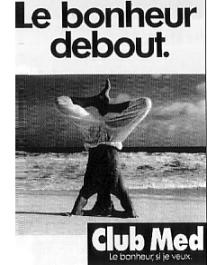
. On saisit alors comment une telle relation illusoire à l’objet est, à
travers l’introjection de l’objet en soi et la projection de soi sur l’objet,
une relation indirecte, tout aussi illusoire, à nous-mêmes. A
travers ces avoirs (biens extérieurs) je cherche à être davantage c'est-à-dire
à exister plus intensément, à être plus heureux, à me réaliser (ce qui
suppose que je ne suis pas vraiment, la tension vers un ailleurs qui définit le
désir et pose mon être véritable dans un à-venir). Ce monde à la fois idéal et
en même temps accessible, là sous la main – c’est ce que promet la publicité,
me promettant qu’en ayant davantage je serai davantage. Tocqueville notait
ainsi qu’alors que l’homme des civilisations antérieures (l’indien d’Amérique,
le guerrier aztèque, l’aristocratie d’Ancien-Régime…) polarisait sa vie sur
l’imitation de modèle difficiles (Jésus, le chevalier, le grand chef, etc.)
qu’il lui fallait conquérir, et ainsi se transformait et s’élevait lui-même
pour devenir « quelqu’un », l’homme des temps modernes pose
que sans avoir à se conquérir et à se changer, il peut dans l’immédiateté d’une
relation consommatrice à l’objet se réaliser. Malheureusement – cf. cours sur
le désir, le bonheur et le travail – sans travail de soi sur soi, sans conquête
de sa propre liberté et de son propre bonheur, le consommateur n’a d’autre
réalité que la nullité de sa propre impuissance – qui se révèle à lui dans la
frustration, l’insatisfaction et l’ennui.
. Si le mode de vie du consommateur / travailleur repose sur une
illusion concernant le rapport à l’objet (avoir=bonheur) et le rapport à soi
(avoir=être), de telles illusions sont, elles-mêmes, indissociable d’un rapport,
tout autant illusoire, aux autres et à autrui. Dans la publicité, ce
sont tout d’abord ces autres que sont les modèles publicitaires à travers
lesquels nous nous lisons : cet autre – et par exemple, ce bel homme
parfumé et les femmes à ses pieds, cet autre beau musclé nageant dans le
bonheur du Club Méditerranée … - : c’est moi (identification) et ce n’est
pas moi puisque c’est un autre. Je dois donc faire comme lui (avoir) pour être comme
lui ; mais c’est aussi le regard des autres que nous cherchons
par nos biens à subjuguer : l’admiration ou l’envie que nous projetons
sur ces regards (nous regardant) nous confirme dans notre propre existence.
-
Logiquement, ça devrait vous plaire. Le segment marketing de ce véhicule
c’est : nain, quinqua, agressif, sexuellement frustré, avec un imper
ridicule.

Analyse rapide : chacune des ces
publicités dépose sur un produit matériel – le téléphone, une crème, une
boisson… - un sens idéal. Les biens deviennent alors le signe
d’autre chose que d’eux-mêmes : ce
que l’on voit à travers eux ce n’est plus seulement le produit, mais
le monde imaginaire auquel il donne accès – la liberté, le bonheur,
la vie, l’existence, etc. ; autrement dit, tout ce dont nous sommes et
nous sentons frustrés dans nos vies. On saisit alors la logique du système
publicitaire : un tel système ne peut fonctionner que dans et par la
frustration et le mécontentement (qu’il doit donc susciter et
entretenir)– contrairement au discours explicite, la publicité n’a aucun
intérêt à ce que nous soyons heureux, car l’homme heureux n’a pas besoin de
consommer. Cf. dessin de Voutch – la vérité du 4x4 ce n’est pas la
puissance mais la frustration qui rêve de cette dernière.
Etre
médecin, avocat, juge, chef d’entreprise et s’afficher tel… c’est aussi être pour
soi-même ce que l’on croit être – et que l’on est en partie - pour
les autres. Autrement dit l’image que je me fais de moi-même (« je
suis médecin ») est fonction de l’image que je projette être pour les
autres, cette image étant elle-même fonction de l’image socialement
reconnue (dans cette société, à un moment donné de son histoire) liée à ma
profession ou à mon titre. De là ce théâtre social où chacun très
sérieusement joue pour soi-même et devant les autres un personnage qu’il
tient pour son être réel.
Qu’il
n’y ait ici personne de consistant, que tel individu ne soit pas réellement
ce qu’il croit et prétend être, c’est ce que montre le changement immédiat
de sa propre image lorsque changent les termes de comparaison. Ainsi tel
médecin, « Médecin » devant ces employés deviendra pour lui-même et
pour les autres « petit médecin de campagne » face à des
spécialistes. Ce que ne voit pas alors celui qui se prend au jeu social et qui
joue très sérieusement son rôle c’est l’inconsistance de sa propre
image, reflet imaginaire du regard des autres sur soi, intrinsèquement variable
et relatif en fonction du jeu des différences dans lequel il s’insère. Ce qu’il
faut alors saisir c’est que cette identité – qui devient ce que je crois être
mon essence (Qui êtes vous ? « Je suis Monsieur Chopart, Médecin »)
– est vide de contenu, n’étant rien d’autre que la cristallisation
relative et variable d’un jeu de différence sans sens intrinsèque (être médecin
ce n’est pas être quelque chose c’est ne pas être employé, ni prof, ni
etc. – l’identité se construisant par la seule différence ).

Or
c’est aussi un tel jeu de différenciation que Marx peut lire dans la
logique de la consommation :
![Zone de Texte: Qu’une maison soit grande ou petite, tant que les maisons d’alentour ont la même taille, elle satisfait à tout ce que, socialement, on demande à un lieu d’habitation. Mais qu’un palais vienne à s’élever à côté d’elle, et voilà que la petite maison se recroqueville jusqu’à n’être plus qu’une hutte. C’est une preuve que le propriétaire de la petite maison ne peut désormais plus prétendre à rien, ou à si peu que rien. […] Ses habitants se sentiront toujours plus mal à l’aise, toujours plus insatisfaits, plus à l’étroit entre leur quatre murs, car elle ne cessera de devenir plus petite à mesure que grandira le palais voisin, et dans les mêmes proportions.
Karl Marx, Travail salarié et capital](./Conscience2_fichiers/image066.gif)

Dessin
de Quino
De la même manière que je crois que mon statut social est mon essence,
je crois que cette maison, cette voiture, ce portable, ce jean, ces Nike… sont
intrinsèquement beaux, bons, désirables. Voilà les biens pour l’achat
desquels je dépense l’essentiel du temps de ma vie qu’est le temps de travail.
Et pourtant, montre Marx une telle valeur n’est pas une valeur substantielle
(leur appartenant en propre), c’est une valeur relative et différentielle.
Ainsi de cette maison, de cette voiture… - de tous les biens proposés
comme succédanés du bonheur par la société de consommation – qui n’ont de
valeur désirable qu’à mesure de la rareté relative de leur possession (cf.
dessin de Quino : peu importe ce que l’on a, du moment que ce l’on a soit
différent de ce qu’ont les autres et désiré par les autres - de là une course en avant sans fin où l’on
peut déjà lire quelque chose comme l’absurdité de la croissance). Dès lors, l’illusion d’un tel désir
est dans la croyance en la valeur intrinsèque du bien désiré.
.
Course en avant sans fin vers des biens et des places censés me donner le
bonheur que j’attends alors même qu’il s’éloigne à mesure de mes possessions,
reposant sur un rapport illusoire à moi-même, aux autres et aux objets,
la dynamique du monde contemporain est intrinsèquement absurde. Ce que nous
donne, par exemple, à voir l’installation « Cloaca » de Wim
Delvoye.

Delvoye,
Cloaca, 2000
Une image de notre
monde : « cloaca » de Wim Delvoye (2000). Machine
complexe – issue d’une recherche technologique poussée – qui, en une longue
chaîne et par des processus chimiques imitant le cheminement et la
transformation des aliments en notre propre corps, à partir des mets les
plus raffinés des plus grands restaurants, produit à son issue des étrons
ayant l’aspect, l’odeur et la taille de vrais étrons humains. Cloaca = une
machine «à faire de la merde». Quel intérêt ? Enorme effort
technologique pour une fin absurde : donne à penser sur les
productions contemporaines de la techno-science dynamisées par le
profit capitaliste : ne sont-ce donc pas, sous des formes plus
affriolantes, de semblables machines ? Cf. le destin de nos biens =
consommation puis mis au rebut = déchet, ordure. Cycle organique infini de
consommation / destruction.
.
A cet aveuglement sur la logique de nos propres désirs, répond celui sur la nature
du système productif qui organise et rend possible la société dite de
consommation. Rappelons que nous vivons dans une société dont la nature a été
qualifiée par Marx de capitaliste. Qu’est-ce que le capitalisme ? C’est un
système global d’organisation des relations humaines et techniques, fondé sur
l’appropriation privée des moyens de production par une classe sociale, celle
des possédants (les capitalistes), la vente de la force de travail de la part
de ceux qui n’ont rien d’autre pour vivre (les prolétaires) et visant
l’accumulation du capital (le but d’une entreprise c’est d’accroître son
profit, ainsi de toutes les entreprises et, par là, de la société toute entière
– la croissance !). Marx pouvait ainsi formuler le dogme central qui
gouverne l’époque en le comparant à la foi religieuse : « accumulez,
accumulez, c’est la loi et les prophètes ! » - nouvelle loi du
monde, nouveaux prophètes qui annoncent qu’il en sera ainsi jusqu’à la fin du
monde – il faut croître, il faut accumuler : fin absurde puisqu’à la
question de savoir pourquoi la seule réponse possible est « pour
croître ». Où le comique tourne cependant au tragique c’est lorsque
l’on perçoit que la contrepartie d’un tel système est l’exploitation – donc le
gâchis et la souffrance - de la vie des hommes à l’échelle mondiale. Partout à
travers le monde, dans des conditions plus ou moins abominables, des centaines
de millions de travailleurs vendent et perdent la partie principale de leur vie
pour la production de gadgets qu’ils vont, dans le meilleur des cas, passer
leur vie à tenter d’acheter. Le capitalisme ne se contente pas, en effet, de
contraindre les corps à un travail absurde, il a du inventé pour survivre,
l’exploitation des désirs : afin d’éviter les crises de surproduction qui
ponctuent son histoire, l’invention géniale du capitalisme au 20ème
siècle a été de vendre aux travailleurs les produits de leur travail – on
comprend ainsi que pour s’assurer une production croissante, il faille nourrir
les désirs humain. De là ces entreprises de production des désirs que
sont les publicités pour des individus qui, faute d’éducation à la liberté,
n’ont nul autre horizon de vie. C’est un tel système global de production des
biens et des désirs à travers l’exploitation mondiale des corps qui vient se
sédimenter sous la forme d’évidences et de pratiques inquestionnées dans
la conscience immédiate de l’individu moyen – ce dernier apparaissant lui-même,
dans sa pratique et ses désirs, analogue à un véritable produit
d’industrie.

2) Généralisation :
la conscience immédiate est toujours une conscience serve
Répétons : ce à quoi la conscience immédiate est alors aveugle c’est à la chaîne de médiations qui la rendent possible et la produisent. La conscience immédiate n’est alors rien d’autre qu’une conscience serve, aveugle sur elle-même et sur les forces sociales inconscientes qui la déterminent. Plongé dans un monde tissé de relations sociales et techniques (un milieu socio-technique), la conscience immédiate ne perçoit son monde qu’à travers le prisme d’un discours socialement légitime qu’elle a intégré au cours de son éducation (école, parents, médias, etc. : l’éducation – c'est-à-dire la formation de soi - dure toute la vie) : comme le prisonnier de la caverne elle ne voit du monde réel que l’ombre projetée par la « matrice sociale ». Comme le notait Jean Jaurès si on ne voit pas alors les chaînes, c’est que ces dernières sont à l’intérieur – intégrées à notre regard, notre pensée, nos désirs, elles sont leur inconscient :

Analyse rapide : étonnement de Jean
Jaurès – comment des hommes dans des conditions de vie misérables
peuvent-ils accepter la donne, continuer à travailler pour de richissimes
industriels et ne pas se révolter. Comment une société – et un monde -
aussi inégalitaires peuvent-ils tenir et ne pas exploser sous les cris des
« damnés de la Terre » ? « Par quel
prodige ces milliers d’individus souffrants et dépouillés subissent-ils
tout ce qui est ? ». Les chaînes sont à l’intérieur, produit
de l’incorporation par l’habitude d’une manière de vivre et de se
penser adéquate à la perpétuation de leur exploitation : si les hommes
ne font pas face au système social pour le mettre en cause, c’est,
note Jaurès, qu’ils se confondent avec lui, leur conscience immédiate en
est produit.
. Ce qu’opère une
telle idéologie sociale c’est une naturalisation de l’ordre historique des
choses, corollaire d’un aveuglement sur la dimension politique des
institutions et de toute institution. Comme l’écrit, en effet, Pierre Bourdieu
cet « inconscient » (social) qui forme notre manière socialement
déterminée de voir, de désirer et de penser « n’est jamais que l’oubli de l’histoire que l’histoire elle-même produit
en incorporant les structures objectives qu’elle produit dans ces quasi-natures
que sont les habitus »
(Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique) [les habitus, c'est-à-dire ces
schémas sociaux de perception et d’action qui font corps avec nous]. Loin
d’être naturelles nos manières de dire, faire, penser et désirer… sont
l’incorporation (introjection) d’une structure (unité d’un ensemble pratique –
technique – signifiant) historiquement déterminée. Une fois incorporée,
c'est-à-dire faite nôtre, nous voyons à travers elle et ne voyons plus sa
propre historicité (et donc relativité).
. Application :
ainsi peut-on comprendre la situation contemporaine. Deux caractères liés
: privatisation et
individualisme. Individualisme : « sentiment réfléchi et paisible
qui dispose chaque citoyen à s’isoler de la masse de ses semblables et à se
retirer à l’écart avec sa famille et ses amis (…) [les hommes de notre
temps] s’habituent à se considérer toujours isolément. Ils se figurent
volontiers que leur destinée est toute entière entre leurs mains (…). [Ils] ne
doivent rien à personne, ils n’attendent rien de personne » (Tocqueville)) ; privatisation = reflux sur
la seule sphère privée, évacuation du champ politique de notre pensée (pensé
cyniquement comme milieu obscur de dirigeants ne cherchant que le pouvoir). Et
pourtant tous marchent d’un même pas sous les mêmes chaînes (exploitation et
consommation). Comment ? « La chaîne était au cœur (…) la pensée
était liée » (Jaurès) : la réalité extérieure (l’entreprise,
l’Etat, les règles de l’échange, les inégalités…) apparaît comme de l’ordre de
la nature (nécessité, fait irrémédiable, éventuellement
transhistorique). La nature – incontestée, incontestable - est l’alibi des
pouvoirs (cf. Rousseau, Contrat Social et Kant, texte sur les lumières).
Car de telles réalités sont des produits historiques qui ne tiennent que
par le consentement tacite des individus qui vivent en elles. Ce sont
des institutions et toute institution humaine est la matérialisation de
réponses à des questions que nous n’avons tout d’abord jamais posées(comment
vivre ensemble ? quelles relations entre travailleurs ? quelle entreprise
et pourquoi ?, etc.). Etre libre, au contraire, c’est alors ouvrir et
reprendre la dimension politique (visant notre
« être-ensemble » global : ce que nous devons consciemment viser
et faire) de notre existence, interroger, penser et changer les institutions en
fonction d’un projet commun de liberté (cf. analyse du Contrat Social de
Rousseau). Faute d’une telle ouverture nous ne sommes que les jouets aveugles
de rapports de force historiques que nous n’avons ni pensés ni choisis. Telle
est la situation aliénée de toute conscience immédiate.
Conclusion générale – Synthèse :
les conditions de la liberté
. A la différence de l’animal qui n’est que nature – c'est-à-dire enfermé
en des pulsions qu’il ne peut réfléchir et un monde qu’il ne peut transformer –
l’homme est un « animal dénaturé » (Vercors) soit un être de culture
construisant sa vie dans la dimension non naturelle de l’artifice signifiant
(une maison, par exemple, est un produit artificiel qui signifie
quelque chose – par ex. la chaleur du « chez soi », etc.) doté
d’une conscience qui le distancie tant de ses pulsions naturelles que de
la nature extérieure qu’il peut voir (savoir) et changer (travail et technique).
Telle est sa liberté constitutive – capacité de s’arracher aux
déterminations naturelles pour accomplir des actes dont il se veut le sujet (l’auteur).
. Ainsi détaché des chaînes de la nature, regardant, jugeant et
transformant le monde depuis une position extérieure, peut-il s’imaginer être
le maître parfaitement conscient et éclairé de la nature (Descartes), de
son histoire et de sa vie – ces dernières apparaissant transparentes à
son regard surplombant. La conscience de soi et du monde serait alors
synonyme de connaissance (savoir de ce que je suis et de ce que sont les
choses). C’est bien ainsi, en effet, dans l’évidence, le sans
question… que nous nous apparaissons. Telle est la position métaphysique
(au-dessus de / irréductible à / transcendante à la nature (= phusis))
du sujet.
. Aussi, le monde perçu par lui étant nécessairement pour lui
d’étoffe subjective (son objet de conscience de substance
imaginaire analogue au rêve), peut-il, à la limite, penser que parce
que s’éprouvant lui-même (et ne pouvant éprouver de l’intérieur les
autres) il est la seule réalité certaine (le cogito cartésien, « je
pense, je suis »), le monde extérieur n’étant rien d’autre que son
rêve ou bien, s’il se refuse au solipsisme (= rien n’existe d’autre que
moi) celui de Dieu. La matière ne serait alors que le songe de l’esprit
(Berkeley), le corps celui de l’âme.
. Mais un tel sujet libre et conscient est beaucoup plus
plausiblement un point de vue, une interprétation (Nietzsche) et,
en tant qu’aveugle sur la réalité totale depuis laquelle il se
détache comme point de vue, une abstraction. L’illusion de
toute subjectivité (être vivant se sentant lui-même, se vivant
comme le centre depuis lequel apparaissent pour lui les choses) est, en
effet, de croire que le monde en soi (telle qu’il est en sa réalité
totale) est identique à la manière dont il lui apparaît (ainsi je crois que ce
mur est rouge, cette qualité épuisant son être (avec le son, etc. – le tout
limité à mes facultés sensibles) ; oubliant qu’il ne saurait y
avoir de couleur hors de sa constitution et de sa projection par une
subjectivité ; que ce mur apparaît autrement à d’autres types de regard
(cf. la mouche, le daltonien…) ; que d’autres qualités existent et sont
constituées pour et par d’autres êtres vivant dotés de sens différents, etc.).
Or le sujet n’est pas libre de la manière dont est constituée sa
perspective (son interprétation) propre : antérieures et
conditions de nos manières de voir, de penser et de désirer des structures
particulières s’imposent à nous, de telle manière que nous voyons à travers
elle mais que nous ne les voyons pas. Tels sont les inconscients.
. Nous avons ainsi pu distinguer trois types d’inconscients –
c'est-à-dire de forces structurées déterminant la conscience à son insu :
un inconscient biologique, l’inconscient psychique – ce que, depuis Freud, nous
entendons couramment, par
« inconscient » - et un inconscient social.
. En tant que la conscience est, elle-même, une émergence de
l’organisme, lui-même produit de l’évolution des espèces, l’hypothèse d’un inconscient
biologique pose ainsi qu’en sa tension essentielle, ses structures propres
et ses contenus, notre vie consciente serait constituée et traversée
à son insu par des forces ancrées dans le corps vivant. Ainsi, par exemple avec
Schopenhauer, du désir sexuel : ce désir qui naît en nous au sortir
de l’enfance et que nous vivons intensément comme nôtre n’est-il pas la manière
dont s’exprime et s’imprime en nous, comme en tout vivant, la tension
reproductrice de l’espèce ? L’illusion de l’amour, selon Schopenhauer,
serait alors de vivre comme sien et comme uniquement sien, un désir qui
naît des profondeurs de mon ancrage génétique (genos = genre, espèce) :
l’individu, son vécu et ses puissances propres, ne serait alors que le moyen
par lequel à l’insu du sujet l’espèce se reproduit.
. Si l’on ne peut nier notre ancrage dans une nature biologique à
laquelle nous devons maintes structures par et à travers lesquelles nous
percevons le monde (cinq sens ; structure temporelle et spatiale propres ;
tensions émotives de type sexuelle, faim, peur…), si l’on ne peut ainsi nier
que le monde pour nous est dès l’abord construit, appréhendé,
interprété et limité en fonction de structures biologiques rendant possible
notre conscience, que la vie déborde donc, porte et rend possible
la conscience que nous en avons, nul doute cependant qu’une approche qui
voudrait réduire l’humain (sa perception, son imagination, son désir…) à
son substrat biologique ne manque cependant la spécificité humaine (reconnue en
première partie). Dans le cas de l’amour (mais c’est tout aussi vrai de la
perception, de la faim, etc.) ce qui est, en effet, irréductible à une simple
actualisation dans un corps singulier des lois génétiques de l’espèce, et qui
différencie fondamentalement les amours humains des amours animaux, c’est que,
chez l’homme, le désir acquière un sens indissociable du jeu
mobile et variable d’une mise en scène imaginaire ; or un tel sens
bouleverse (et parfois inverse) les finalités de l’espèce puisqu’il existe une culture
et un jeu (liberté) de l’amour irréductibles à toute visée reproductive,
que l’on peut aller jusqu’à se tuer par amour, etc. A l’opposé d’une
détermination rigoureuse de l’homme par les lois de l’espèce, il faut pour
comprendre l’homme, penser ce que l’homme fait de ces lois et
structures – on comprendra ainsi qu’il les détourne de leur sens
simplement biologique en les faisant entrer dans une nouvelle dimension
spécifiquement humaine, la dimension imaginaire de la signification.
. Ceci nous a amèné à reconnaître ce mode d’être particulier qu’est la réalité psychique humaine. Mais l’existence d’une réalité irréductible au seul biologique ne signifie pas pour autant la totale liberté de l’homme à son égard : l’hypothèse freudienne d’un inconscient psychique suppose au contraire que loin d’être transparente et maîtresse d’elle-même, notre vie consciente est traversée par des flux et des structures psychiques inconscients qui la déterminent à son insu. Ainsi avons-nous pu voir combien nos aversions et nos amours ordinaires loin d’être librement choisis suivaient des logiques multiples et contradictoires d’appropriation et de rejets, logiques se structurant au cours de la genèse psychique en autant de strates porteuses de mondes imaginaires conflictuels dont nous continuons à subir la puissance au cœur de notre vie.
. Mais une telle genèse psychique ne s’effectue nullement dans un ciel
éthéré selon la fiction d’un individu posé comme seul face à une nature
sans forme propre qu’il devrait s’approprier. Une société - c'est-à-dire
un ensemble anonyme et particulier de relations pratiques entre les
hommes et avec les choses unifié selon des significations imaginaires centrales
– précède la venue au monde de l’individu et définit pour lui ce qu’il
s’appropriera comme étant la réalité. Tel serait l’inconscient social –
ensemble imaginaire socialement structuré, mettant en forme à son insu
les facultés de l’individu à partir desquelles ce dernier percevra et agira
dans le monde.
. Loin donc d’être cet être détaché de toute nature et surplombant le
monde depuis les hauteurs d’une conscience transparente et libérée, le sujet
concret est un être pris dans une multitude de réseaux – biologiques,
psychiques, sociaux – réseaux qui, conditions intérieures de son regard, de sa
pensée et de ses désirs lui sont, dans l’attitude non réfléchie de la
conscience immédiate, invisibles. Percevant le monde à partir de
structures qu’il n’a jamais ni interrogées ni choisies, on comprend ainsi
comment l’individu intérieurement enchaîné peut méconnaître ses chaînes et se
croire pleinement libre alors même qu’aliéné, il ne fait qu’obéir à des forces
extérieures (intériorisées). Aussi la conscience dans son immédiateté
n’est-elle pas connaissance (c'est-à-dire savoir vrai) mais bien plutôt méconnaissance
et illusion de connaissance puisque ne saisissant pas sa propre
relativité.
. Comment dans un tel cadre penser la liberté ? Loin
d’être immédiatement donnée – sinon comme potentialité qui différencie, en effet,
l’humanité de l’animalité – cette dernière est une tâche. C’est la tâche
(longue et difficile) et le projet de réfléchir par la raison sa
vie c'est-à-dire de prendre du recul vis-à-vis de nous-mêmes, de notre regard,
de nos désirs, de nos pensées en les interrogeant afin d’éclairer ce qui nous
constitue (connaissance) et de nous construire selon un choix lucide de vie qui
ne soit pas déterminé par des forces inconscientes. Certes alors il ne s’agit nullement
de nous libérer du corps, de l’inconscient psychique, de la société, selon
la fiction d’un sujet sans attaches. Ces derniers sont au contraire les conditions
internes de ce que je suis donc de ma conscience et de ma liberté : la
pensée qui pense le cerveau le fait par son propre cerveau, la pensée qui pense
le psychisme le fait dans et par ses propres productions psychiques, la pensée
qui pense la société la pense à travers les mots et les schémas sociaux qu’elle
a incorporée. Il faut cependant reconnaître l’ambiguïté
constitutive de notre rapport au corps, à notre psychisme, à la société car ce
qui est la condition de notre existence et de notre liberté est aussi celle de
notre servitude. Il s’agit dès lors pour devenir libre de tenter de transformer
le rapport immédiat à notre corps, à notre psyché et notre société de façon
à y faire advenir la dimension réflexive à partir de laquelle nous
pourrons partiellement nous choisir et nous faire. Une telle
transformation du rapport à ce qui nous constitue substituant par le travail,
l’activité à la passivité, la puissance à l’impuissance, la lumière à
l’obscurité, unissant puissance de faire (corporalité de notre liberté) et
maîtrise éclairée (réflexion et lucidité) n’est autre que le devenir réel de la
culture.

Unité de la culture : son sens =
progrès vers une vie éthique substantielle (plénitude existentielle
d’une vie spirituelle commune). La culture n’est donc pas un donné mais un
travail, travail de libération / donné qui nous limite (formes politiques,
morales, techniques, artistiques…) = humanisation croissante de la nature
(ici à comprendre comme ce que nous sommes = tissés des déterminismes qui
nous font) motivée par l’inadéquation +/- clairement perçue de la forme
sociale existante au sens visé. Chez le sujet individuel, la culture est un
travail de libération / impuissance et indétermination première = éducation
(humanisation, spiritualisation) des pouvoirs propres du sujet
indissociable des formes culturelles socio-historiquement déterminées
(nourriture spirituelle). Critiques de la culture cependant :
l’effort, la fatigue, la vie immédiate mais aussi, avons-nous vu, le désir
de servitude.
Rappel essentiel : « il faut choisir : se reposer ou
être libre » (Thucydide).
La liberté est donc le travail de la culture, soit
ce projet d’éducation des puissances humaines substituant la conscience
à l’inconscience, la maîtrise à l’immaîtrisé, la puissance à
l’impuissance, l’activité à la passivité – la liberté à la servitude.